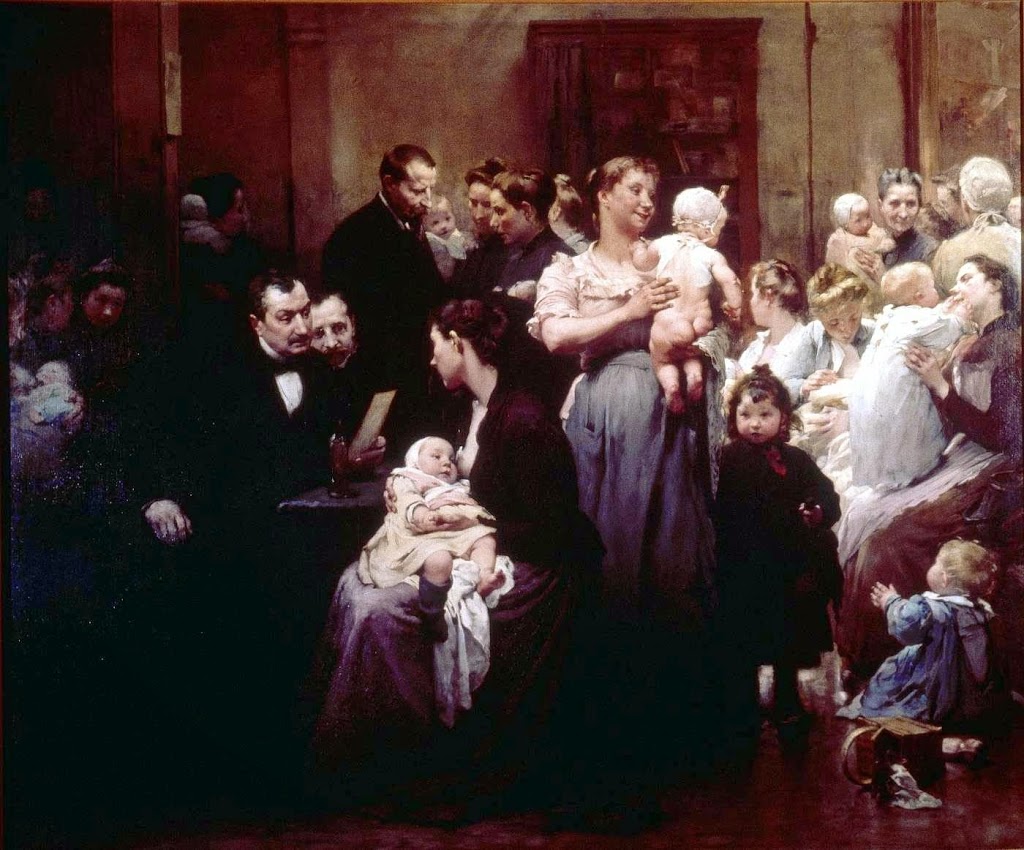Gilles Dostaler, historien du temps présent
13 min
Par Martin Petitclerc, professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Version PDF
D’abord, j’aimerais dire que je suis très heureux d’être ici, même si je ne suis pas trop sûr de la raison qui explique ma présence… En fait, je blague à moitié, car j’ai été invité pour donner suite à l’article que j’ai publié l’année dernière dans la Revue d’histoire de l’Amérique française au sujet du projet d’une histoire sociale critique qui accorderait une place importante à l’étude de l’économie. Comme je le soulignais dans mon article, il me semblait que si l’histoire sociale, qui a toujours prétendu avoir quelque chose à dire non seulement sur le passé, mais également sur le présent et l’avenir, désirait réaffirmer sa pertinence sociale — et on a vu récemment que cette pertinence est férocement contestée —, elle devrait nécessairement s’intéresser à l’économie en plus de la politique…
Or, il se trouve que mon regretté collègue de l’UQAM, Gilles Dostaler, un économiste passionné par l’histoire des idées, était l’un des rares chercheurs à réfléchir d’un point de vue critique à l’économie actuelle en s’appuyant sur une réflexion historique. C’est pour cette raison, bien que je ne crois pas être la meilleure personne pour parler ni de Dostaler ni même de l’histoire économique, que j’ai accepté d’être ici aujourd’hui. Dans cette présentation, je vais aborder successivement deux points. J’évoquerai d’abord un phénomène qui m’apparaît finalement assez étrange, soit le déclin de l’histoire économique au cours des deux ou trois dernières décennies. J’aborderai ensuite le problème d’une histoire économique critique, un aspect qui me permettra de souligner ce que m’inspire la carrière de Gilles Dostaler.
Le déclin de l’histoire économique
Il est inutile ici de s’attarder à prouver le déclin irrémédiable de l’histoire économique au Québec, comme partout en Occident d’ailleurs. Plusieurs historiens, dont Paul-André Linteau, Gérard Bouchard, José Igartua, Joanne Burgess et bien d’autres ont bien souligné ce déclin. Très récemment, William Sewell a démontré ce même phénomène dans les départements d’histoire aux États-Unis. Évidemment, cela ne veut pas dire que l’économie a complètement disparu des textes d’histoire, ce qui serait nettement exagéré. Les histoires régionales en sont un bon exemple.
Malgré cela, très peu de publications se réclament directement d’une histoire économique. De plus, et je suis conscient que tout cela est très impressionniste, lorsque l’économie est abordée, elle ne semble l’être que pour dépeindre un tableau contextuel qui n’a plus qu’un rôle très limité dans l’explication causale du changement historique. Tout se passe comme si l’économie était considérée comme un secteur séparé de la société, un système autonome et cohérent, répondant à ses propres règles et n’ayant qu’un impact sur lui-même. Le corollaire de cela est que le reste de la société (le politique, le social, la culture, les idées) peut être analysé, de son côté, en toute autonomie à l’égard de l’économie. En somme, l’économie est en voie de devenir quelque chose qui est pratiquement hors de propos pour l’analyse de la plupart des phénomènes sociaux, politiques, économiques, culturels, etc.
Tout cela pour dire qu’il y a un parallèle à faire, à mon sens, entre l’affirmation, d’une part, de l’autonomie du système économique régi par ses lois (assimilées habituellement au marché) et, d’autre part, de l’autonomie des idées, de la culture, de la politique, du social, etc. On peut penser que d’affirmer par exemple que les « idées mènent le Québec » permet de fonder une position forte sur le caractère non déterministe de l’économie, mais une telle affirmation, en plus d’être à mon sens naïve, concoure paradoxalement à valider la thèse d’un système économique autonome, détaché du monde politique, idéologique, culturel, etc., et régi par ses propres lois.
À mon sens, le déclin de l’intérêt des historiens pour l’économie appauvrit à la fois le savoir historique et sa contribution à nos débats de société (la fonction sociale). Je crois en ce sens qu’il est absurde de penser que l’histoire comme savoir pourra se développer encore longtemps sans prendre au sérieux le problème que pose l’économie dans les sociétés occidentales, et notamment le capitalisme dans les sociétés contemporaines. Il y a, par ailleurs, quelque chose qui est pour le moins surréaliste de voir s’accumuler les preuves de l’impact des impératifs de l’économie dans nos vies personnelles et collectives, alors que comme historiens nous avons à peu près relégué l’économie à un vague contexte plus ou moins pertinent pour l’analyse du changement historique.
Une histoire critique de l’économie…
Tout cela pointe donc vers la nécessité de refaire de l’histoire économique, peu importe d’ailleurs ses inspirations théoriques. À cet égard, et même si je ne suis pas spécialiste de la période, l’histoire économique de la première moitié du XIXe siècle est l’exemple même d’un débat historiographique d’une grande profondeur qui a bénéficié de l’apport de plusieurs approches différentes de l’économie et de son impact important sur la société, que ce soit les rapports sociaux, la culture ou la politique.
Si je souhaite le retour de l’histoire économique en général, et qu’une plus grande attention soit portée à l’économie dans l’ensemble des études historiques, j’aimerais tout de même insister, ici, sur la pertinence d’un projet historiographique plus précis, soit la constitution d’un savoir critique sur la forme historique spécifique qu’a prise l’économie au cours des derniers siècles : le capitalisme. Ce savoir critique, pris dans sa globalité, serait centré sur les formes particulières que prennent les conflits et les luttes (politiques, sociales, culturelles, etc.) dans une société qui tend à subordonner de grands pans de la vie collective aux exigences de l’accumulation privée du capital, ce qui est d’ailleurs indissociable d’une pénétration considérable de la logique marchande dans les activités humaines. À l’heure où le sort de l’humanité est totalement confondu avec le sort de quelques grandes institutions financières, il me semble qu’une telle réflexion est pour le moins pertinente.
Bien sûr, et on me l’a rappelé récemment dans la RHAF, Marx est bien mort. Et malheureusement, ceux qui ont fait et qui font une lecture intelligente de Marx, et qui ont tenté et tentent toujours de s’en inspirer pour développer un programme de recherche critique, comme l’a fait Gilles Dostaler pendant toute sa carrière, sont de plus en plus rares. Si bien qu’on a aujourd’hui, notamment chez les historiens plus jeunes, une vision bien caricaturale de cette tradition de pensée. D’une part, on considère généralement que cette dernière était imprégnée de structuralisme qui niait toute capacité aux acteurs de participer activement au changement historique. D’autre part, et cela est l’envers de la médaille, on considère que cette tradition de pensée était profondément idéaliste, rêvant d’un grand soir utopique qui ne pouvait que se changer en cauchemar totalitaire.
Comme je vais tenter de le montrer, Gilles Dostaler est l’exemple même d’un chercheur critique qui ne basculait dans aucun de ces extrêmes. Il n’avait pour objectif que de penser les conditions de possibilité d’un approfondissement de la démocratie. À cet égard, en relisant quelques publications de Dostaler, j’ai retrouvé un texte concernant la crise économique du début des années 1980 au Québec, une crise qui favorisera la montée du néolibéralisme et le désencastrement du capitalisme financier de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’économie réelle ».
Je vais mettre en parallèle l’interprétation de Dostaler avec celle de Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, ce qui me semble intéressant puisque ceux-ci ont joué un rôle très important, comme chacun sait, dans le développement de l’histoire économique au Québec. Ces derniers, dans un article du début des années 1980 dans la RHAF, tentaient, à partir d’entrevues avec des dizaines d’historiens, d’établir objectivement les grands consensus de l’historiographie relatifs à la socioéconomie du Québec, une socioéconomie qu’ils considéraient être « régie par ses propres lois », lois qui ne pouvaient être violées impunément par les sociétés. S’inscrivant dans une perspective libérale, ce qu’ils appelaient leur perspective « entrepreneuriale », ils affirmaient clairement les leçons qu’il fallait tirer de la crise économique du début des années 1980 : « Le grand jeu québécois est en train de chercher ses règles nouvelles, lentement, car pour le moment, malgré le déclin de la productivité, la chute des investissements, le chômage élevé et l’inflation institutionnalisée, personne n’en est arrivé à croire qu’il faudra abandonner en fait certains de ces droits [sociaux] acquis dans l’après-guerre ».
Comparons maintenant avec le texte de Dostaler, qui s’inscrit clairement dans une perspective marxiste, mais qui ne débouche pas sur le même constat normatif visant à convaincre la population qu’elle devait abandonner ses droits sociaux pour se conformer aux nouvelles règles du jeu néolibéral. Même si Dostaler écrit sur des événements qui lui sont contemporains, il les envisage, comme il l’a d’ailleurs toujours fait dans son œuvre, comme des processus historiques non déterminés. C’est pourquoi les leçons à tirer de la même crise étaient très différentes.
D’abord, en bon économiste, Dostaler reconnaît bien sûr la structure particulière de l’économie québécoise, qui repose sur les secteurs économiques « mous » à faibles investissements. Cela explique que la crise frappe plus fort au Québec qu’ailleurs. Malgré cela, ajoute-t-il, la « crise n’est pas inéluctable, et sa voie de sortie n’est pas prévisible ». Et cela s’explique, selon lui, parce que la crise, comme toutes les crises économiques, est un « événement historique et non un processus mécanique comme le croient souvent les économistes ». En fait, et cela correspond bien à ce que nous avons dit plus haut, « ce n’est pas uniquement une crise économique », ajoute-t-il. C’est une conjonction d’événements politiques, économiques, sociaux et idéologiques qu’il est artificiel de vouloir séparer et compartimenter, puisqu’ils participent d’un même mouvement historique.
Parmi cette conjonction d’événements qui caractérise la crise du début des années 1980, Dostaler s’inquiète principalement de la montée « d’un discours économique encore plus conservateur que celui qu’on entendait au début des années 1930 ». Ce discours n’est pas un simple reflet de la réalité matérielle, mais plutôt une stratégie du pouvoir qui vise à « forcer le consensus » sur la voie particulière à suivre pour sortir de la crise. Ce discours s’appuie sur « une conception autoritaire de l’économie, de son enseignement et de son fonctionnement […] Il s’agit d’imposer les politiques découlant de la théorie pure », c’est-à-dire, et c’est moi qui ajoute cette précision, une théorie pure détachée de la trame historique. En d’autres mots, ce discours vise à imposer certaines leçons à tirer de la crise, et donc à discréditer d’autres leçons que l’on pourrait tirer de cette dernière.
C’est cette conception autoritaire de l’économie qui informe désormais l’ensemble des actions du Parti québécois, dont Dostaler dénonce le virage conservateur néolibéral. En effet, le gouvernement de René Lévesque s’en prend dès 1981 au « corporatisme syndical », aux « chômeurs et assistés sociaux […] [qui profitent] des largesses de l’État » et plus largement aux « acquis, dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux et culturels ».
Pourtant, affirme Dostaler, une autre sortie de crise est possible, une sortie qui serait « axée sur la satisfaction des besoins et des revendications du plus grand nombre ». À court terme, et je cite, « il faut d’abord se battre pour défendre les droits acquis […] et contre la détérioration du pouvoir d’achat [car] il est faux de prétendre que les hausses de salaire ou la sécurité d’emploi […] sont la cause de la crise au Québec ».
À long terme, la tâche est certainement plus difficile, mais selon Dostaler elle est néanmoins nécessaire pour éviter d’autres crises économiques à venir qui risquent bien d’être aussi graves que celle des années 1930. Cette tâche, toujours actuelle à l’heure du Gaz de schiste et du Plan Nord, il la présente ainsi : « C’est une transformation de l’organisation sociale qu’il faut viser. Un certain nombre de décisions de nature économique doivent être prises, dans toute société. Quoi produire? Comment le produire? Comment fixer et répartir le travail? […] Comment contrôler les ressources naturelles? Ces choix sont actuellement le résultat de décisions privées prises en fonction des intérêts d’une minorité possédante. […] Ces décisions devraient être prises collectivement, selon des modalités à inventer, par la majorité de la population ».
Ainsi, parce que l’économie est partie intégrante de l’histoire, et pas un système régi par les lois immuables qui lui sont propres, une telle sortie de crise ne peut « passer [que] par l’action politique », qui est ici la prise en main, par les femmes et les hommes, du changement historique.
Ce qui m’incite à penser, et je terminerai par-là, que Gilles Dostaler doit être considéré non seulement comme un véritable historien de la pensée économique, mais également comme un authentique historien du temps présent.
Pour en savoir plus
PAQUET, Gilles et Jean-Pierre WALLOT. « Sur quelques discontinuités dans l’expérience socio-économique du Québec : une hypothèse ». Revue d’histoire de l’Amérique Française, vol. 35, no 4 (1982). p. 483-521.
Articles sur les mêmes sujets