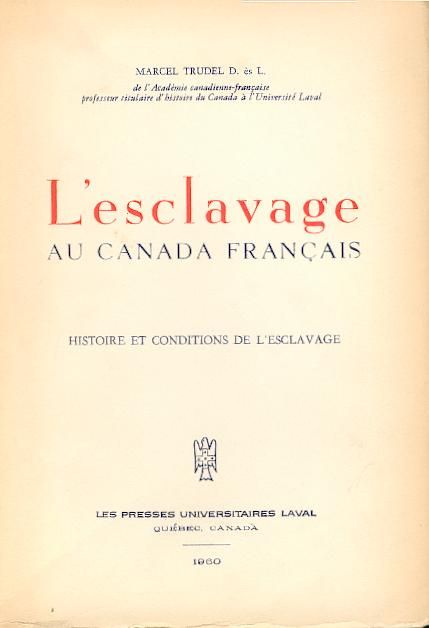Histoire, engagement et militantisme en Acadie. Entrevue avec Nicole Lang
Par Julien Massicotte, professeur d’histoire à Université de Moncton, campus d’Edmundston, et Philippe Volpé (transcription), étudiant de premier cycle en histoire à l’Université de Moncton
Version PDF
Julien Massicotte : Nicole, quels sont tes principaux champs d’intérêt, en tant qu’historienne, et y a-t-il des points de rencontre entre ces champs?
Nicole Lang[1] : […] Comme universitaire, je te dirais qu’il y a eu trois grands champs d’intérêt tout au long de ma carrière. Il y a l’histoire du travail, il y a l’histoire des femmes et puis l’histoire acadienne qui est toujours aussi un domaine qui m’intéresse beaucoup. L’Acadie est mon laboratoire et va le demeurer. […] Je m’intéresse à l’histoire de l’Acadie en général, mais je me suis penchée sur des problématiques bien précises. Je dirais que le travail est un point de rencontre. Je me suis vraiment intéressée à l’analyse du travail en Acadie : l’expérience des hommes et des femmes, l’évolution du travail et des revendications, le syndicalisme, etc. Je pense qu’il s’agit d’un volet important. Je dirais qu’il y a la question nationale, qu’on ne peut évacuer, qui est omniprésente. Pensons à tous les efforts qui sont déployés par les Acadiens et les Acadiennes afin de pouvoir vivre en français, avoir des services et une éducation en français, de pouvoir travailler dans un milieu de travail francophone, en Acadie du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une question importante pour moi, ça constitue un point de rencontre. Dans tout ce que je fais, même dans le mouvement des femmes, la question nationale est toujours très présente. […] Quand on parle des revendications des femmes, il y a toujours le volet «service en français.» […] L’engagement m’a conduite à m’intéresser à l’histoire des femmes. Le fait de siéger au sein de différents comités et de s’engager dans différents dossiers m’a fait réaliser qu’il y a des militantes actives en Acadie depuis des années. Donc, je me suis intéressée à ces femmes-là, pourquoi elles se sont engagées et quel était le profil des militantes, quelles ont été leurs grandes revendications, pour mieux m’aider dans le fond à comprendre les grandes problématiques. […]
Julien Massicotte : Tu as été impliquée dans l’enseignement de l’histoire acadienne au secondaire durant ta carrière. Pourrais-tu m’expliquer les grandes lignes de cette implication, et décrire l’évolution de la présence de l’histoire acadienne dans l’enseignement au secondaire?
Nicole Lang : C’est souvent la communauté qui se tourne vers nous. Il s’agit ici d’un dossier qui illustre très bien cette façon de procéder de la communauté, ainsi que les besoins qui s’y font sentir. Au cours des années 1990, à chaque réunion annuelle de la SAANB (Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick) [NDLR : Jusqu’en 2008, on parlait de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB). L’organisme est aujourd’hui connu comme la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)]. Il y avait des membres qui soulevaient la question du peu de place que l’on accordait à l’Acadie dans les cours d’histoire et de littérature française, dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Les manuels qui étaient utilisés dans les classes étaient des manuels d’histoire du Québec ou d’histoire du Canada avec un petit chapitre sur l’Acadie pour la période de la Déportation. On parlait aussi de l’élection de Louis J. Robichaud, mais il y avait très peu de choses sur l’Acadie. C’était similaire pour les cours de littérature, que ce soit aux primaire ou secondaire. Les auteurs étudiés étaient souvent québécois, ou plus rarement franco-ontariens. Les auteurs français étaient très présents, ceux des grands classiques.
Julien Massicotte : Je me souviens de Gabrielle Roy.
Nicole Lang : C’est ça. Gabrielle Roy entre autres, et puis on étudiait aussi Agaguk d’Yves Thériault. Des auteurs québécois pour les contemporains, et du côté des classiques, surtout des auteurs français : Hugo, de Maupassant, Zola. Il n’y avait aucune littérature acadienne dans les écoles, ni histoire acadienne. Chaque année, la question revenait sur le tapis, et les gens devenaient un petit peu agressifs. On comprenait mal que les jeunes allaient à l’école suivre des cours de littérature et d’histoire sans connaître leur propre histoire. À la fin des années 1990, la SAANB a décidé de former un comité provincial pour étudier la question et préparer un mémoire. La SAANB voulait des historiens du milieu universitaire, mais aussi des représentants de la communauté; on souhaitait que les universitaires entendent les préoccupations de la communauté. On m’a demandé de siéger au comité, ainsi qu’à Léon Thériault, du campus de Moncton. Il y avait des représentants de chacune des grandes régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. On s’est rendu dans les régions, on a écouté les gens et on a étudié les programmes.
Nous avons donc préparé notre mémoire […] dans lequel nous contextualisions et nous démontrions l’importance de la présence de l’histoire et la littérature acadienne dans les écoles. Parce que c’est une question d’identité, d’estime de soi et de connaissance de son propre milieu, de son contexte historique. Ensuite, nous présentions dans la dernière partie du mémoire nos revendications. Nous demandions, pour le primaire, davantage d’histoire acadienne dans le contenu des cours offerts, et qu’on étudie quelques auteurs acadiens. Pour le secondaire, nous demandions un cours d’histoire acadienne tout simplement, et davantage d’auteurs acadiens dans les cours de littérature. Nous avons par la suite déposé le mémoire à la SAANB. Ç’a été approuvé par le comité exécutif et les régions aussi se sont prononcées. Donc, nous avions vraiment l’appui de la communauté acadienne […]. Ensuite, nous avons déposé le mémoire auprès du ministre de l’Éducation. Quand c’est une démarche où il est très clair que la communauté a été présente tout au long du processus, outre les universitaires, et qu’il s’agit d’une demande de la communauté au départ, le gouvernement est plus à l’écoute. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des votes. C’était signé par tous les bureaux régionaux de la SAANB.
Julien Massicotte : Il y avait vraiment un consensus.
Nicole Lang : Il y avait consensus, et les gens trouvaient que c’était le temps que ça bouge en cette matière. On commençait à dénoncer la situation publiquement. C’était un dossier qui agaçait le gouvernement. À partir du moment où on a déposé le mémoire, on a invité le comité à Fredericton. Tout de suite on nous a dit qu’au primaire, on s’engageait officiellement à augmenter le contenu acadien. On a été consulté, et je peux dire qu’il y a vraiment davantage de contenu acadien maintenant, il y a eu vraiment une grande amélioration.
Au secondaire, ils ont accepté qu’il y ait un cours d’histoire acadienne, un cours à option, cependant. Le cours a été offert en ligne la première année, puis pour faire suite aux demandes nombreuses, le cours est offert sur une base annuelle par un professeur en classe, qui utilise tout de même le contenu en ligne. Le cours est offert depuis 2004.
Je n’ai pas hésité à m’impliquer dans ce dossier. Sachant que c’était une demande de la communauté, je me suis dit que comme historien professionnel, on ne peut pas refuser ce type de demande. On sent qu’on a une responsabilité à l’égard de la communauté. C’est notre communauté et on sent qu’il y a un besoin. On sait comme historien que l’enseignement de l’histoire dans les écoles est important. Je considère que cette expérience sur le plan de l’engagement fut très enrichissante.
Julien Massicotte : Ça doit aider quand tu as le soutien de la communauté et que ça débouche sur quelque chose de positif.
Nicole Lang : Quand tu fais de l’engagement et puis qu’année après année, dans le domaine des revendications qui touchent aux femmes, par exemple, rien n’aboutit… Prenons le dossier de l’équité salariale. Ce dossier accapare les militantes depuis des années, et c’est petit gain après petit gain après petit gain. On se dit, est ce que ça va finir par déboucher? Mais dans le dossier de l’enseignement de l’histoire acadienne, les choses ont abouti assez rapidement. Ce qui est agréable, pour quelqu’un qui est militant!
Julien Massicotte : Ça prend des dossiers qui vont bien pour te donner un peu de courage pour ceux qui avancent moins vite?
Nicole Lang : Parfois, c’est, je dois dire, un peu déprimant par moment. On est découragé et puis on se reprend en main. On se dit, si on veut atteindre nos objectifs, il ne faut pas lâcher. On a l’expérience maintenant, et il faut aller recruter des plus jeunes que nous pour qu’ils s’engagent aussi. On ne peut pas les laisser tomber parce que nous, avec les années, on a acquis de l’expérience, des connaissances. Sur le plan des approches, des stratégies pour obtenir des gains, on s’est cassé la gueule à bien des reprises. On sait que si cette stratégie-là ne fonctionne pas, il faut au moins que les erreurs servent à quelque chose. Comme militante, un dossier comme celui de l’enseignement de l’histoire acadienne a été très valorisant et m’a aidée dans mon cheminement parce qu’il a abouti. Quand ça va mal, cet exemple-là peut être ressorti. Ce dossier est tout de même particulier, au sens où l’appui venait de toute la communauté, ce qui n’est pas le cas pour les dossiers qui touchent plus spécifiquement les femmes, par exemple. Des jeunes, des personnes d’âge moyen, les personnes âgées, les hommes, les femmes, les plus conservateurs, les plus libéraux, tout le monde étaient d’accord. Quand ce n’est pas trop controversé et puis qu’on ne remet pas les choses en question…
Julien Massicotte : Oui, tout le monde est d’accord.
Nicole Lang : Alors que quand tu vas discuter des services d’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick par exemple, bien tu sais comme moi qu’il y a beaucoup de résistance encore dans bien des milieux aussi francophones qu’anglophones. J’avais accordé une entrevue à Radio-Canada sur la question, et je déplorais le fait qu’il y avait peu d’accès à l’avortement en région. On m’a boudée dans ma communauté, certaines personnes étaient très inconfortables. J’ai constaté à quel point ce dossier était encore tabou. Avec des dossiers comme ça, on est loin de l’unanimité. Quand tu vas voir le gouvernement, c’est moins facile de négocier pour obtenir des gains à ce moment-là, alors qu’avec toute ta communauté derrière toi, tu sais l’enseignement de l’histoire… Pour un dossier controversé, même le dossier de l’équité salariale présentement, un dossier important pour les femmes au Nouveau-Brunswick, c’est plus difficile. On a obtenu l’équité dans le secteur public […]. Mais pour le secteur privé, on demande une loi qui oblige les employeurs à accorder l’équité salariale. Bien des employeurs font du lobbying auprès du gouvernement. Souvent, ce sont de grands bailleurs de fonds de certains partis politiques au Nouveau-Brunswick. Bref, ils ne veulent absolument pas entendre parler de ça. C’est une situation compliquée.
Au cours de la dernière année, on a rencontré des députés. Il y a un comité provincial, la Coalition pour l’équité salariale, qui est une coalition bilingue, et il y a des comités régionaux. Une des stratégies employées au cours de la dernière année était d’exercer de la pression auprès des politiciens et politiciennes pour que lors des prochaines élections, ce soit dans leur plateforme électorale, qu’ils s’engagent à adopter une loi qui prévoit l’équité salariale non seulement au secteur public, mais également dans le secteur privé. Je fais partie du comité régional, en plus du comité provincial. On a rencontré notre députée, qui est une ancienne ministre du gouvernement conservateur de Bernard Lord, qui est en politique depuis des années, et ça n’a pas été tellement bien reçu. Son parti n’est pas pour l’adoption d’une loi qui obligerait le secteur privé à accorder l’équité salariale. Donc ce n’est pas un dossier qui fait l’unanimité, et à ce moment-là c’est beaucoup plus long.
Julien Massicotte : Ça ne fait pas l’unanimité au sein du monde politique, ni au sein du reste de la communauté en général?
Nicole Lang : Non, parce qu’en plus des employeurs privés, il y a tous ceux qui ne comprennent pas ce qu’est l’équité salariale. On a aussi l’impression que ça va couter tellement cher, que les taxes vont augmenter. C’était le cas lorsqu’on a instauré l’équité salariale dans le domaine public : on craignait des hausses de taxes. C’est toujours une question de sous. Ça ne faisait pas l’unanimité, mais le gouvernement a quand même été de l’avant parce que c’était une promesse électorale lors de la campagne électorale de 2006, les libéraux de Shawn Graham s’étaient engagés à réviser la loi de l’équité salariale pour le secteur public. Mais maintenant, pour le secteur privé, c’est autre chose [NDLR : le gouvernement de Shawn Graham fut défait lors des élections générales du 27 septembre 2010 par les conservateurs de David Alward]. Pour ce qui est des partis politiques, il y a le Parti vert au Nouveau-Brunswick, qui n’est pas implanté dans toutes les régions. Et ensuite le NPD; on sait que, comme les verts, la tradition néo-démocrate n’est pas tellement enracinée dans plusieurs régions, mais eux se sont engagés, ça fait partie de leur plateforme. Mais les deux grands partis, autant libéral que conservateur, n’ont pas cet élément dans leurs plateformes, pour les élections de fin septembre 2010.
Donc quand ce sont des dossiers qui font l’unanimité, c’est un plaisir de s’engager et de s’investir pour une cause, parce qu’on sait que ça va aboutir. Pour des dossiers qui ne font pas l’unanimité, on sait que c’est une question non de mois, non d’années, mais souvent de décennies avant que les choses débloquent. Il faut être convaincu. Quand on est historien ou historienne, parce qu’on a étudié ces questions-là, on sait vraiment à partir de quel moment on a commencé à revendiquer, on connait le contexte historique. On sait que ça prend du temps. C’est long et souvent après que des gains soient obtenus, nous ne sommes pas convaincus de pouvoir les conserver. Il faut faire le chien de garde.
Julien Massicotte : Tu parles des enjeux féministes, de l’histoire des femmes par exemple, et la résistance et l’inconfort relativement à ces thèmes. Il y a des statistiques parues l’an dernier dans le rapport du Comité consultatif sur la condition de la femme. Par exemple, 50 pour cent des francophones dans la province croient qu’une femme violée par son mari n’est pas victime d’un acte criminel. On peut parler également de la sous-représentation politique des femmes, soit des 12 pour cent de femmes élues en 2006 au Nouveau-Brunswick. Tu as mentionné la question de l’équité salariale. Pourquoi encore cette résistance, en 2010?
Nicole Lang : Je te dirais qu’il y a une résistance, et même les termes font peur. Je me souviens, lorsque le plus récent mouvement des femmes en Acadie, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, a été formé il y a presque quatre ans, au moment de choisir le nom du mouvement, une grande discussion a eu lieu à savoir si le terme féministe allait faire peur. Est-ce que ça allait nuire à nos chances d’aller chercher du financement, par exemple? Mon attitude a toujours été que plus on utilise les mots, plus on explique les concepts, et moins il y aura de résistance. C’est une question d’éducation. Il faut continuer d’éduquer nos jeunes, ça ne commence pas quand ils nous arrivent à l’université, il faut le faire dans nos écoles. Au primaire, il faut commencer à les éduquer, sur toute la question de la violence par exemple. La violence dans les relations hommes-femmes. Il y a des programmes qui commencent à être mis en place dans nos écoles. On a un peu de retard là-dessus comparativement au Québec, qu’on cite souvent, qui est un peu un chef de file dans ces dossiers-là. Moi je regarde toujours le Canada Atlantique aux fins de comparaison. Le Québec a les moyens, les francophones y sont majoritaires. Il ne faut pas perdre ça de vue. On ne contrôle pas tous les paliers du gouvernement en Acadie, et c’est une différence importante.
Julien Massicotte : C’est une question de pouvoir.
Nicole Lang : Il ne faut jamais perdre ça de vue, ce que l’on oublie parfois. Donc, on a du retard sur ce plan, mais les gens sont conscients, il y a beaucoup de comités. Les comités qui gravitent autour de nos maisons de transition pour femmes et enfants violentés, les mouvements concernant les services de garde au Nouveau-Brunswick, les intervenants dans le domaine de la santé mentale, de la santé physique, etc., tous sont conscients qu’on a un sérieux problème. J’ai vu les dernières statistiques pour notre maison de transition ici au Madawaska [NDLR : le Madawaska est situé dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick]. Au cours de la dernière année, le taux de fréquentation a augmenté en flèche, avec les problèmes dans le secteur forestier, la crise économique, etc. C’est sûr que ça peut expliquer des choses, mais c’est incroyable en 2010… On a de sérieux problèmes de société sur ce plan. Autant chez les anglophones que chez les francophones, en milieu urbain comme en milieu rural. Quand on voit ces statistiques-là, c’est déprimant. Ça fait des années que les mouvements des femmes travaillent pour ces questions là. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’ateliers de formation, d’éducation de fait, d’outils de développés, etc. Après le découragement et la frustration, il faut recommencer. C’est tout de même une question d’éducation, les gens vont finir par comprendre, ce que ça veut dire le terme féminisme et ce que ça veut dire le terme violence. Et puis ce qu’est un viol. Et puis qu’est-ce qui est acceptable et pas acceptable dans les relations?
Julien Massicotte : Autant la violence physique que psychologique.
Nicole Lang : Oui. Les représentants de notre maison de transition nous disaient que la violence psychologique est de plus en plus présente. On ne peut pas voir les marques sur le corps. C’est plus difficile de porter des accusations contre les personnes qui vont en violenter d’autres. Je demeure convaincue qu’il faut faire de l’éducation, rendre accessibles des lieux pour les personnes violentées, des services pour les personnes, etc. Je pense moi qu’il faut investir beaucoup dans la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut faire de l’éducation. Pour moi ça demeure la clé. Plus ta population est éduquée, plus elle comprend. Pour revenir au terme «féministe», quand je l’explique, en classe, et qu’on en discute, on se rend compte que les étudiants ne percevaient pas le terme de la bonne façon. C’est un terme qui fait peur. Ce que je disais aux femmes actives dans le mouvement, c’est qu’il ne faut pas avoir peur de l’utiliser. Plus on va l’utiliser, plus on va le démystifier, les gens vont savoir que ça signifie l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est la même chose avec l’équité salariale; les gens comprennent salaire égal pour travail égal, mais quand tu leur parles d’équité salariale, souvent c’est un concept qui les dépasse. C’est pour ça que la coalition avait monté une présentation PowerPoint là-dessus, très accessible. Quand on fait de l’éducation, il faut vulgariser, il faut réaliser qu’en tant qu’universitaire, quand on s’engage, il faut aussi devenir vulgarisateur. Si on ne l’est pas, on ne peut pas joindre la population, on lui fait peur. C’est du moins la leçon que j’ai tirée au cours des années. Il faut être capable de parler à la population et se faire comprendre. Pour faire ça, il faut vulgariser. Ça ne veut pas dire qu’on laisse de côté les résultats de nos études. On prend nos résultats et on les transpose dans un langage qui peut être compris par la population. Je pense que c’est ça la clé.
On les connait les problèmes, on sait quels sont les retards, on sait sur quels dossiers on doit travailler. La question des garderies au Nouveau-Brunswick, pour le mouvement des femmes, c’est un dossier très important parce qu’on n’a pas encore de garderies financées par l’État. Sur le plan des garderies privées, la qualité des services varie beaucoup. Il y a très peu de vérifications; il y a un sérieux problème. C’est pour ça qu’il y a une coalition de service de garde qui travaille avec d’autres mouvements de femmes au Nouveau-Brunswick. Le dossier de l’équité salariale revient constamment. Il y a la question de l’analyse inclusive selon le genre qui préoccupe de plus en plus le mouvement. On veut que nos gouvernements, avant qu’ils adoptent des mesures ou votent des lois, tentent de savoir quelles seront les conséquences de cette mesure-là pour les hommes au Nouveau-Brunswick, mais pour les femmes également. Un peu comme on le fait par rapport aux groupes sociaux. Pour les plus pauvres, pour la classe moyenne, pour ceux qui ont plus de moyens, on examine quel sera l’impact de telle ou telle mesure sur leurs revenus. On aimerait que cette analyse-là se fasse automatiquement pour le genre.
Un exemple concret : lors de l’adoption du dernier budget au Nouveau-Brunswick (hiver 2010), nous étions en pleine période de crise économique. On nous disait : «il faut faire des dépenses d’infrastructures, donc on a investi dans ce sens, il y a des chantiers partout au Nouveau-Brunswick». Mais quand on regarde les emplois créés dans ces domaines-là, ce sont des emplois pour les hommes. Donc, au moment de création de ces projets-là, dans lesquels on investissait des millions de dollars, on a aussi décidé de faire des coupures. Où a-t-on fait des coupures? Dans les postes d’aides enseignantes dans les écoles, des aides-bibliothécaires, on a aboli le service de médiation rattaché à la cour familiale. Donc, ces mesures-là, les suppressions de poste qu’on a faites au Nouveau-Brunswick, touchaient plus les femmes, parce que c’était des emplois occupés majoritairement par des femmes. Donc, d’un côté un beau budget avec des dépenses de millions de dollars et de la création d’emplois pour les hommes surtout, d’un autre côté des compressions budgétaires dans certains domaines touchant presque uniquement les femmes. C’était des emplois bas salariés en plus, des économies de bouts de chandelles.
Donc, on aimerait que le gouvernement au Nouveau-Brunswick, quand il étudie des projets de loi […] fasse l’analyse selon le genre de la personne. C’est un dossier qui est très actuel. On a commencé à revendiquer et puis demander que cette analyse-là devienne la façon de faire du gouvernement, surtout dans le processus budgétaire. Je dirais que c’est assez bien reçu. Pour l’instant, ce n’est pas trop menaçant, parce que c’est un beau grand concept qu’on essaie de comprendre, mais l’idée commence à faire son chemin.
Il y a plusieurs grands dossiers comme ça. Est-ce qu’un jour on aura l’analyse selon le genre au Nouveau-Brunswick, est-ce qu’un jour on aura des garderies subventionnées par l’État, est-ce qu’un jour on aura l’équité salariale pour le secteur privé? J’aimerais pouvoir répondre oui. Ce sont de grands dossiers, et les efforts vont se poursuivre. Quand on travaille sur ces dossiers-là, et c’est une des nombreuses choses que j’ai apprises au cours des années, il est impossible de le faire en vase clôt. Il faut tenir compte des différentes régions, il faut faire des pressions auprès de notre gouvernement, il faut démontrer que les dossiers qu’on défend sont des dossiers qui ont du mérite, sont des dossiers qui vont faire une différence et qui vont permettre aux femmes d’être égales, d’avoir des salaires équitables, des conditions de vie et de travail équitables.
Julien Massicotte : Est-ce que le gouvernement vous prend au sérieux quand vous revendiquez?
Nicole Lang : Oui, il nous prend au sérieux, mais on est perçu comme un groupe de pression parmi d’autres. Donc, on va écouter beaucoup, être très poli quand on nous rencontre, mais de là à dire qu’on a suffisamment d’influence pour faire changer des choses… Si on est capable de démontrer qu’on a la communauté derrière nous, ça fait toute la différence.
Il faut également s’adapter aux nouvelles réalités de la société. On ne peut plus faire de la revendication comme quand j’ai commencé. Il faut apprendre à se servir des nouveaux médias sociaux. Pour te donner un exemple, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a maintenant une page Facebook qui rassemble des centaines de personnes. Donc quand on veut faire circuler notre information maintenant, c’est beaucoup plus facile : des listes de distribution, des courriers électroniques, une page Facebook, un site web, etc. La petite annonce à la radio et dans les journaux : on utilise encore ces moyens-là quand on sait qu’il y a certaines émissions qui sont très écoutées, mais on s’aperçoit qu’il faut changer. Ce n’est pas nécessairement facile, surtout pour nos plus vieilles militantes, peu familiarisées avec ces outils-là. L’utilisation de ces nouveaux médias est tout de même inévitable, surtout si on veut faire du recrutement chez les jeunes. C’est l’un des grands problèmes tout de suite, non seulement dans le mouvement des femmes, mais aussi dans les organismes sociaux, comme la SANB; la moyenne d’âge commence à augmenter. On doit recruter, c’est un de nos grands défis, s’assurer qu’il y a une relève. Faire du recrutement auprès de nos jeunes. Et puis pour ce faire, on doit apprendre à travailler différemment. Mais c’est un gros défi parce qu’on n’a pas appris à militer avec ces outils-là. Chaque année, quand on discute de stratégie, comment faire connaître tel ou tel dossier, automatiquement, il y a toujours quelqu’un disant : «on fait une conférence de presse là-dessus». Je dis «oui mais combien de journalistes vont y être, va-t-on avoir quelques secondes lors du bulletin de nouvelles? Avec de la chance, peut-être un petit article dans les journaux, mais est-ce que les gens lisent vraiment ça?» Tandis qu’un montage en ligne et une annonce publique, c’est peut-être un autre moyen, une autre façon de faire.
Julien Massicotte : Ça vient changer les formes d’engagement, les nouveaux médias.
Nicole Lang : Oui, beaucoup. Comme militante, ça nous oblige à devoir faire face à toutes sortes de choses. Après quelques années d’engagement dans tel ou tel mouvement, sans devenir des experts, on commence à connaitre un peu les façons de faire et les meilleures stratégies. Ça devient sécurisant, on sait comment procéder pour que ça fonctionne, pour que les gens nous entendent. Quand on faisait une campagne, on sortait avec nos pancartes, et s’il y avait cent personnes qui avaient assisté à la manifestation, on avait une bonne couverture. On atteignait nos objectifs. On était devenues assez bonnes là-dedans. Mais aujourd’hui, ça ne marche plus tellement, on doit réapprendre à neuf avec de nouvelles stratégies pour faire passer notre message. C’est un défi supplémentaire, qui demande des efforts, qui n’est pas tout le temps évident. Je l’ai vu au cours des deux dernières années : au cours de nos réunions, les plus jeunes nous ramènent constamment vers ça.
Je demeure convaincue que dans tous nos organismes en Acadie, que ce soit la défense des droits des femmes, la question nationale, les soins de santé, on a besoin d’une relève. Nos militants et nos militantes sont essoufflés. En milieu minoritaire, il faut s’assurer que les gains sont maintenus, qu’on ne revienne pas en arrière. Donc même si on a fini de travailler sur tel ou tel dossier, il faut quand même s’en préoccuper. Ça demande une certaine énergie. Avec les années, tellement de comités sont apparus; certains travaillent pour la défense de l’environnement, d’autres pour les droits à des services en français dans le domaine de la santé, d’autres autour de la question de la représentation politique, les services de garde, etc. Ça se multiplie, et souvent ce sont les mêmes militants qui vont être actifs au sein de plusieurs comités, dans plusieurs organismes. On a besoin d’une relève.
Julien Massicotte : Tu parles du défi de la relève, tu évoquais l’engagement des jeunes, de leur rapport relativement à l’engagement. Penses-tu que les jeunes d’aujourd’hui perçoivent l’engagement de la même façon, sont-ils attirés à s’engager dans ces cadres-là? Où y aurait-il d’autres formes d’engagement possibles?
Nicole Lang : Je vais te donner l’exemple du Regroupement féministe. On s’apercevait que nos membres étaient constitués en bonne partie de personnes de quarante ans et plus. Comment peut-on intéresser les jeunes? À l’intérieur de notre regroupement, on a décidé de former un sous-comité qu’on appelle le caucus des jeunes féministes, et pour être membre, il faut avoir moins de 35 ans. Les jeunes maintenant ont un comité à l’intérieur de notre mouvement qui leur permet de se réunir et de travailler sur des dossiers qui les interpellent. On réalisait que certains dossiers vont intéresser beaucoup les jeunes, mais d’autres moins. Je pense que ç’a été une bonne façon de procéder. La SANB a aussi impliqué davantage les jeunes. Il faut trouver des moyens d’intéresser les jeunes et leur permettre de travailler sur des dossiers qui les interpellent. En leur donnant l’espace, on leur donne le droit de parole aussi, de s’exprimer, d’organiser des choses, de piloter certains dossiers. Ce n’est pas nécessairement facile pour les militants et les militantes; quand tu es habitué depuis vingt ans de mener la barque, et d’un coup il faut laisser les jeunes procéder à leur façon, c’est une adaptation qui n’est pas nécessairement évidente. Ce n’est pas de la mauvaise volonté. C’est un grand défi la relève. C’est exigeant et puis les problèmes sont toujours là, les dossiers ne disparaissent pas, donc il faut y travailler constamment. S’engager activement, ce n’est pas facile, ça demande beaucoup d’énergie et de temps.
Julien Massicotte : Est-ce que c’est valorisé?
Nicole Lang : Oui, c’est valorisé… mais selon moi, l’université ne le reconnaît pas suffisamment. Nos petits campus le reconnaissent davantage que les grandes universités, où la recherche est une plus grande préoccupation. Dans les plus petites universités, la proximité avec la communauté fait en sorte qu’elle est très ancrée et enracinée dans son milieu. Je pense qu’il y a une plus grande valorisation, mais je ne pense pas que c’est suffisamment valorisé encore. La plus grande valorisation vient de la communauté, beaucoup plus que du côté universitaire. Le milieu universitaire va souligner le travail fait sur tel ou tel comité, mais au moment d’analyser les dossiers professionnels, l’analyse est à trois volets : l’enseignement, la recherche et puis le service à la collectivité. Le service à la collectivité ne pèse pas lourd dans la balance. Ce volet-là est parfois dénigré, il y a quelquefois du mépris à l’égard des gens qui consacrent beaucoup de temps aux services à la collectivité et à l’engagement social. Pour ma part, je crois plutôt qu’on doit reconnaître et respecter ce type d’engagement. Surtout en milieu minoritaire, on en a besoin de l’engagement des gens de la communauté, du milieu universitaire ou d’ailleurs. Les gains de la société acadienne au cours des années en découlent, selon moi.
Souvent c’est une méconnaissance. La critique provient souvent de gens qui n’ont pas voulu s’engager. Je respecte ça. Ce n’est pas pour tout le monde, mais je trouve souvent qu’on manque de respect à l’égard des gens qui en font. On ne réalise pas comment cet engagement-là peut alimenter notre réflexion. Mon engagement communautaire nourrit mon enseignement, et nourrit mes efforts de recherche aussi. C’est très interrelié. Ça aide à comprendre les enjeux dans la société, ça jette un éclairage neuf. C’est une école. Une école qui m’a apporté beaucoup. Militer dans les organismes provinciaux, pour la cause acadienne, c’est très instructif sur notre système politique, sur toute la notion de pouvoir et les rapports de force au sein de notre société. Ça aide également à mieux comprendre les enjeux et les grands combats des périodes antérieures.
Bref, l’engagement est un choix. J’aimerais simplement que les gens respectent davantage ce choix-là. Le fait d’être une professeure d’université, une professeure engagée, ça dérange par moment. Ça dérange parce que ça soulève la question de neutralité. Est-ce qu’on peut être un universitaire scientifique tout en étant militant? Est-ce qu’on peut être objectif, est-ce qu’on doit s’engager? C’est un des grands débats. Certains croient sincèrement qu’il ne faut pas s’engager, qu’il faut rester à l’extérieur, pour avoir le recul. […] Il y a aussi l’autre extrême. Je rencontre constamment des gens du milieu communautaire, de différentes régions du Nouveau-Brunswick, qui soulèvent la question. On ne comprend pas qu’on ait autant de difficulté à recruter des membres et des militants parmi les universitaires. L’argument que les gens nous donnent, et c’est très intéressant, est le suivant : les universitaires sont parmi les personnes dans la société qui ont la plus grande liberté de parole et d’action, ils peuvent faire des sorties sur la place publique, dénoncer telle ou telle chose, sans conséquence négative. On ne perd pas son emploi le lendemain matin. Nous sommes en mesure de le faire, mais beaucoup disent non. Tandis qu’un fonctionnaire, par exemple, ne peut pas aller sur la place publique; l’employé d’un entrepreneur privé va-t-il aller sur la place publique défendre l’équité salariale pour le secteur privé? Les gens de la communauté ne comprennent pas pourquoi il n’y a pas plus d’universitaires qui s’engagent, alors que dans le domaine universitaire, il y a des gens qui ne comprennent pas qu’on puisse s’engager parce que selon eux, on n’est plus de vrais universitaires, on n’a pas la rigueur qu’on devrait avoir, on n’est pas sérieux.
Je crois qu’il faut faire la part des choses. Il est possible d’être universitaire avec une démarche de recherche très rigoureuse, très scientifique, tout en étant militant ou engagé. Quand je mets mon chapeau de militante et que je dois aller rencontrer le politicien pour aller défendre tel dossier, c’est la militante qui y va. Quand je mets mon chapeau de chercheuse et d’historienne en classe, et que je donne mes cours, la rigueur est là. Quand on sent qu’il peut y avoir un problème et un conflit d’intérêts, et que notre militantisme peut influencer notre comportement et notre travail d’historien, on doit prendre du recul, et se demander si c’est la militante qui réagit, ou l’historienne.
Julien Massicotte : C’est une question de jugement.
Nicole Lang : Qu’on le veuille ou non, engagés ou pas, on a tous des valeurs dans nos vies, des choses dans lesquelles on croit vraiment, et pour lesquelles on est prêt à intervenir. Chacun de nous a des valeurs, et cela a une influence. Ces questions-là peuvent finir par m’agacer un peu. C’est une question d’honnêteté, de jugement comme tu dis, et de rigueur. Nous sommes tout de même des historiens professionnels. Une démarche de recherche implique la rigueur, le sérieux, l’aspect scientifique. Quand on fait du militantisme, on sait quelles stratégies on doit adopter. Et puis on sait quand l’un peut nourrir l’autre, mais également quand c’est le moment de faire la part des choses entre l’un et l’autre. Personne ne va me convaincre du contraire. De mon côté, en classe, la militante n’a jamais laissé de côté la formation et la rigueur de l’historienne. Je n’ai jamais commencé à vendre ma salade en classe. C’est certain que quand je donne mon cours d’histoire des femmes, on va discuter de ces thématiques-là, je vais même parfois avoir des invités en classe pour présenter la situation des femmes en Acadie ou l’historique de certains dossiers. Sans doute que mon choix de conférencières est influencé par mon militantisme, mais si je n’étais pas engagée dans le mouvement, et que j’avais ces valeurs-là, mon choix serait-il tellement différent? Je ne pense pas.
Souvent, j’ouvre mon cours, lorsqu’il y a des conférenciers ou conférencières invités, à la communauté, ce qui permet aux gens qui souhaitent assister à la conférence de venir. Ça permet d’avoir différentes opinions, des discussions intéressantes, les gens qui y assistent apprécient. Le débat qu’on a dans la société, dans ce contexte, on l’a en salle de classe. C’est très enrichissant pour les étudiantes et les étudiants.
La communauté en Acadie a été souvent déçue du monde universitaire au cours des dernières années. Et je te dirais qu’en Acadie, et du côté anglophone, on a souvent entendu des critiques à l’égard des universitaires. Comment ils sont déconnectés du milieu, comment on aurait eu besoin de leur expertise, de leurs connaissances, pour aider à monter des dossiers. On a besoin de nous pour aider à mieux rédiger des demandes de financement, des mémoires, pour monter des dossiers, et souvent ce sont nos connaissances de base dans différentes disciplines qui nous permettent de contribuer. On vient nous voir aussi parce que souvent c’est plus facile pour nous d’aller faire des déclarations sur la place publique, devant les caméras, etc. C’est comme si les universitaires ne réalisaient pas jusqu’à quel point les problèmes étaient grands dans la société présentement et comment on avait besoin de nous. Nous sommes peut-être davantage sensibilisés à cette réalité du fait que nous sommes un petit campus, très enraciné dans son milieu, et où il est plus difficile de dire non. Les gens ici ne sont pas gênés, ils débarquent, ils cognent directement à nos portes. […] On doit s’interroger sur le fait que l’engagement soit si peu valorisé, les gens ont l’impression que ça va leur nuire dans leur carrière. Je pense vraiment qu’il faut réfléchir sur la question de l’engagement des universitaires…
Julien Massicotte : Merci.
[1] Nicole Lang est professeure d’histoire à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.
Articles sur les mêmes sujets