Entretien avec Marcel Martel
Par Caroline Robert, Amélie Grenier et Martin Robert, du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS)
Version PDF
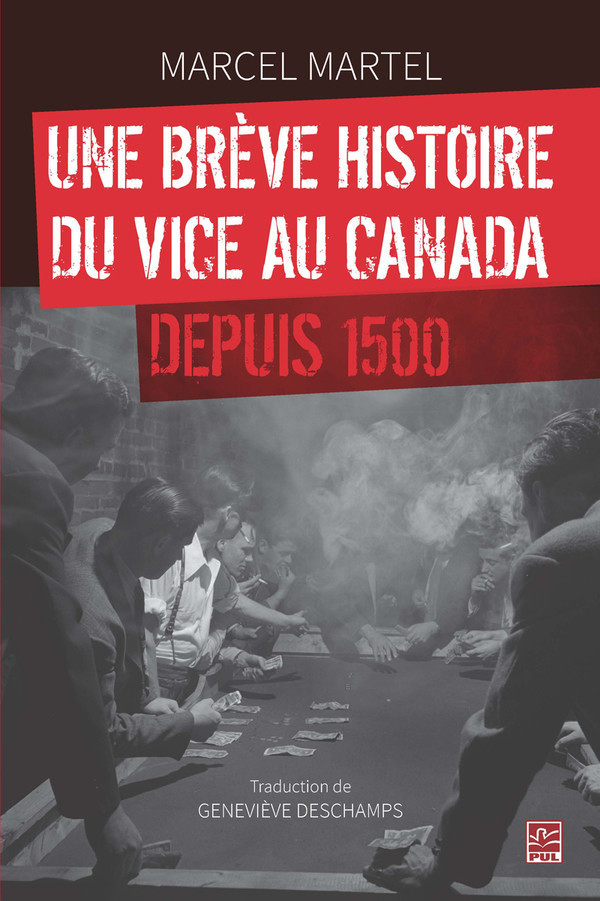 Monsieur Marcel Martel, professeur au département d’histoire de l’Université York à Toronto, était de passage à l’UQÀM les 4 et 5 mai derniers à l’occasion du colloque Vices et criminalité dans l’histoire du Québec et du Canada, organisé par le Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS). Dans le cadre de cet événement, une table ronde réunissant les professeurs Ollivier Hubert et Donald Fyson s’est tenue autour du livre de M. Martel Une brève histoire du vice au Canada depuis 1500, paru aux Presses de l’Université Laval (traduction française de Canada the Good : A Short History of Vice since 1500 paru chez Wilfrid Laurier University Press en 2014). Parmi les autres publications du professeur Martel, on trouve Not This Time : Canadians, Public Policy and the Marijuana Question, 1961-1975 (University of Toronto Press, 2006) et Le Canada français et la Confédération : fondements et bilan critique (Presses de l’Université Laval, 2016), coécrit avec Jean-François Caron[1].
Monsieur Marcel Martel, professeur au département d’histoire de l’Université York à Toronto, était de passage à l’UQÀM les 4 et 5 mai derniers à l’occasion du colloque Vices et criminalité dans l’histoire du Québec et du Canada, organisé par le Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS). Dans le cadre de cet événement, une table ronde réunissant les professeurs Ollivier Hubert et Donald Fyson s’est tenue autour du livre de M. Martel Une brève histoire du vice au Canada depuis 1500, paru aux Presses de l’Université Laval (traduction française de Canada the Good : A Short History of Vice since 1500 paru chez Wilfrid Laurier University Press en 2014). Parmi les autres publications du professeur Martel, on trouve Not This Time : Canadians, Public Policy and the Marijuana Question, 1961-1975 (University of Toronto Press, 2006) et Le Canada français et la Confédération : fondements et bilan critique (Presses de l’Université Laval, 2016), coécrit avec Jean-François Caron[1].
Caroline Robert : De quelle façon en êtes-vous venu à vous intéresser à l’histoire du vice du Canada?
Marcel Martel : Mon intérêt pour la problématique du vice s’explique d’abord par ma volonté de développer un nouveau cours au premier cycle. Il s’agissait d’adopter une approche comparative qui tienne compte non seulement du Canada, mais aussi des États-Unis et du Mexique. La dimension comparative montre que les phénomènes étudiés ne sont pas spécifiques au Canada, mais en même temps, elle permet de faire ressortir les spécificités de la société canadienne. On peut évidemment penser à la coexistence de deux communautés linguistiques, celle d’expression française et celle d’expression anglaise. Mais, il y a également le facteur religieux, puisque pendant de nombreux siècles, les chrétiens dominaient la société canadienne, toutefois ils n’étaient pas tous d’accord sur la manière de criminaliser les comportements considérés comme des « vices ».
L’exemple que j’aime donner, c’est celui de l’alcool. Chez les protestants, on jugeait la prohibition comme étant la seule manière de régler le problème, d’éviter que les gens soient tentés de boire. Alors que les catholiques croyaient davantage dans la tempérance, c’est-à-dire dans le contrôle de soi. Les catholiques ont perdu momentanément, puisque la prohibition est devenue une réalité pendant quelques mois en 1918, puis on a laissé les provinces prendre le monopole. La Colombie-Britannique et le Québec ont été les premières provinces à rendre la vente de l’alcool possible. La dernière province à lever la prohibition de l’alcool, c’est l’Île-du-Prince-Édouard, en 1937. L’autre raison pour laquelle je me suis intéressé au vice, c’est simplement par curiosité intellectuelle. Je m’intéresse au processus qui fait en sorte qu’on va identifier des réalités, puis vouloir que ces réalités soient transformées de telle manière qu’elles reflètent des valeurs personnelles. Encore une fois, dans le cas de l’alcool, en 1860 et 1920, de nombreux individus croyaient que la prohibition était la meilleure solution au problème de la consommation de l’alcool. Comme individu qui vit dans une société démocratique, je crois qu’on a tous la capacité de faire bouger les choses et étudier les questions du vice permet d’explorer les mécanismes utilisés par des individus pour modifier les politiques publiques afin qu’elles correspondent à leur vision du monde.
Amélie Grenier : Vous expliquez le triomphe des moralisateurs durant la seconde moitié du 19e siècle par les bouleversements sociaux et économiques vécus à la suite de la Révolution industrielle, où ces différents vices (alcool, drogues, sexualités) étaient vus comme créant des problèmes sociaux. Ces discours moraux permettaient-ils de justifier le nouvel ordre social axé sur le travail, créé par la Révolution industrielle, où tous les comportements nuisant à la force de travail étaient découragés?
Marcel Martel : Tout à fait d’accord! Un des facteurs qui va favoriser les discussions dans l’espace public sur les vices, c’est que bien des gens regardent leur environnement et leur environnement est en transformation. La manière dont on travaille se transforme. Au lieu d’aller travailler chez un cordonnier avec deux autres personnes, on va travailler dans une usine avec 200, 300, 400 personnes, et cela soulève une série de questions sur la manière dont on travaille, sur la productivité, sur l’argent que les gens gagnent, mais aussi sur la gestion du temps. Les réformistes constatent, en observant la nouvelle société industrielle, les problèmes de pauvreté et la détérioration du tissu social. Face à ces constats, ils tiennent pour acquis que ces problèmes proviennent de la manière dont la classe ouvrière gère son budget et son temps. Ainsi, la raison pour laquelle on ne voulait pas que les gens consomment, par exemple, de l’alcool dans des lieux publics, c’était entre autres parce cette pratique concernait la gestion du budget du ménage.
L’industrialisation entraîne de nouvelles manières de poser les questions du coût du logement et de la nourriture; on se retrouve avec des coûts supplémentaires qui n’existaient pas jusque-là et les budgets familiaux sont souvent précaires. Si, en plus, le soutien de la famille dépense un grand pourcentage de son salaire en fumant, en jouant aux jeux de hasard ou en buvant, on se retrouve avec des problèmes importants dans les familles. Il y a donc une volonté de régir les comportements de l’autre. Il y a aussi une volonté de régir la manière dont les temps de loisir devaient être employés. Bien entendu, les travailleurs se sentaient non seulement jugés, mais demandaient : « De quel droit pouvez-vous me dire comment employer mon temps de loisir? » Les réformateurs réagissaient à la détérioration du tissu social, c’est-à-dire à l’industrialisation et à ses problèmes et ils en déduisaient que la pauvreté urbaine était due au fait que les travailleurs administraient mal leurs budgets familiaux parce qu’ils dépensaient leur argent dans les vices…
Avec le recul, on peut voir qu’ils posaient un mauvais diagnostic. La pauvreté n’était pas due à la consommation d’alcool, elle était due au fait que les salaires étaient tout à fait inadéquats. Il y avait une dimension de classe évidente dans cette histoire. Les classes ouvrières avaient l’impression de se faire dicter par une classe bourgeoise en pleine ascension une certaine conception de la façon dont la société devait fonctionner. Cette histoire comportait aussi une dimension raciale très claire. Au 19e siècle, on blâmait par exemple les Chinois d’avoir apporté l’opium au Canada, les noirs, d’avoir apporté la marijuana, etc. En interdisant ces substances, on pensait appeler ces communautés culturelles à abandonner ces pratiques ou à retourner d’où elles venaient. On tenait ainsi des propos racistes qui ont alimenté les mouvements réformistes. C’est une des raisons qui expliquent la criminalisation de certaines drogues.
Amélie Grenier : Vos recherches ont cela de particulier qu’elles montrent l’écart qui existe entre la façon dont les lois qui criminalisent le vice sont conçues et leur application.
Marcel Martel : Dans l’étude des politiques gouvernementales, souvent, on s’intéresse surtout à la manière dont ces politiques ont été développées. On s’intéresse très peu à la manière dont ces politiques, transformées en loi, ont été mises en place. Ce qu’on sait par exemple par rapport aux jeux de hasard, au Québec, c’est que même l’Église catholique s’était opposée à leur criminalisation. L’Église catholique avait besoin des bingos, parce qu’elle s’en servait pour financer ses activités. Au Québec, les forces de l’ordre n’ont d’ailleurs pas passé trop de temps à chasser les personnes qui tenaient des maisons de jeux de hasard. Le travail du sexe est un autre exemple qui met en évidence le décalage entre les lois et leur application. Souvent, les autorités municipales étaient réticentes à appliquer les lois qui criminalisaient les travailleuses du sexe. Les policiers finissaient par connaître les histoires de quelques-unes de ces femmes, qui souvent avaient bien des raisons qui les amenaient à justifier leur travail.
Martin Robert : Comment s’est installée la logique de taxation du vice, notamment par la création de sociétés d’État telles que Loto-Québec ou la Régie des alcools?
Marcel Martel : Le raisonnement était le suivant : plutôt que de laisser ces activités entre les mains du secteur privé, surtout des éléments criminels, c’est l’État qui va percevoir les revenus. Un des éléments qu’on a fait valoir à compter de 1969, c’est que l’argent qu’on va percevoir par la taxation de ces activités va nous permettre de financer de grandes choses dans nos sociétés. Par exemple, on va s’en servir pour financer le système de santé ou d’éducation. À la fin de la prohibition, on cherchait ainsi à satisfaire à la fois les partisans de la prohibition et ceux qui se montraient en faveur de la vente d’alcool. En prenant en charge la vente d’alcool, l’État se chargeait aussi de la contrôler et de la restreindre. On pouvait refuser de vendre de l’alcool à une personne qui se présentait trop souvent à la Commission des liqueurs… Des fonctionnaires qui travaillaient à la Commission des liqueurs vont ainsi réguler la consommation d’alcool. L’argument a toujours été qu’il était préférable que l’État s’occupe de la vente d’alcool et qu’il le ferait de façon responsable. En même temps, c’était une manière pour l’État d’accroître ses revenus.
[1] Cette entrevue a été publiée, à l’origine, sur le blogue du Centre d’histoire des régulations sociale. C’est avec l’accord des responsables que ce texte est ici reproduit. Vous trouverez d’ailleurs d’autres entrevues et contributions de ce blogue sur l’espace qui leur est réservé sur notre site.
Articles sur les mêmes sujets



