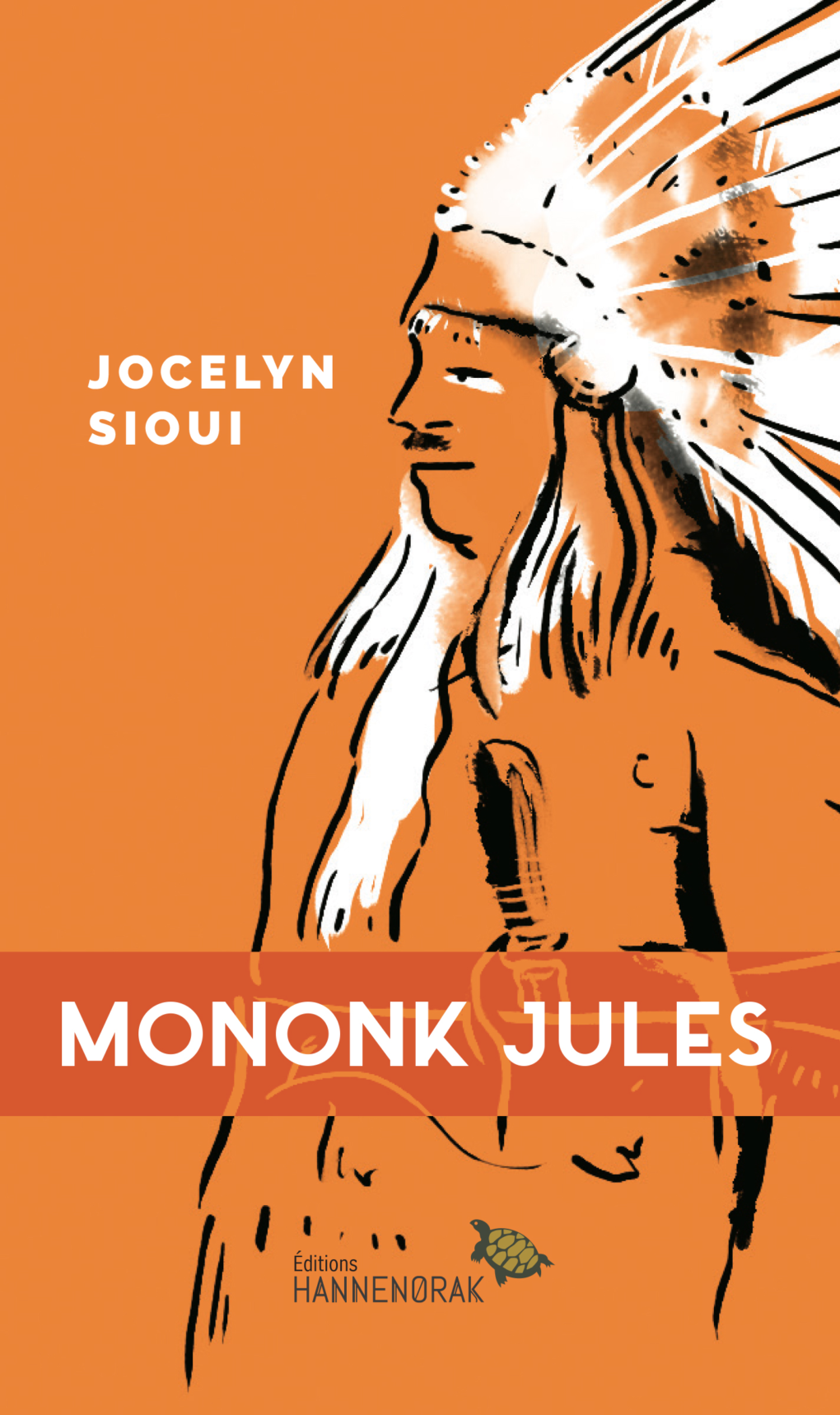Ce que les années 1850 peuvent nous enseigner
13 min
Par Patrick Lacroix, candidat au doctorat à la University of New Hampshire
Version PDF

Carte du chemin de fer du Grand Tronc, 1885. Source : Wikimedia Commons.
Lors d’une session spéciale du dernier congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, un groupe de jeunes leaders québécois.es réuni.es par Gérard Bouchard ont exprimé de très différentes visions du passé et de l’avenir du Québec[1]. Or ces jeunes ont fait consensus en déplorant, ensemble, le triomphe de « l’économisme » dans les dernières décennies. Les historien.nes de l’auditoire auraient pu leur souffler les exemples nécessaires : une stricte politique budgétaire introduite au cours des années 1990, l’approche néolibérale sous-entendue dans la « réingénierie de l’État » de 2003, puis l’arrivée des « Lucides », dont les injonctions sont encore avec nous. À ceci, on pourrait ajouter, plus récemment, la collusion dans le secteur de la construction, indice d’une trop grande proximité des autorités civiles aux agents de développement économique.
Selon certain.es militant.es nationalistes et sociaux-démocrates, ce sont là les signes d’un nouveau conservatisme – né d’une apathie politique croissante – qui tend à réduire les grandes questions de société à leur aspect économique, voire fiscal. Il y a, déclarèrent les jeunes leaders réuni.es par l’IHAF, le déclin d’un militantisme politique qui mènerait de grands projets nationaux et sociaux à terme. Suite au plus récent moment-charnière du Québec, le référendum de 1995, il s’est produit une « repriorisation » des enjeux économiques.
Ici, il revient à l’historien.ne d’intervenir et de noter que la présente situation n’est pas sans précédent. Aux niveaux économiques et politiques, notre période ressemble à plusieurs égards aux années 1850. Un peu plus d’une décennie après cet autre moment-charnière, l’insurrection de 1837, le Canada-Est connaissait, comme on l’allègue aujourd’hui, la subordination des autres enjeux de société à une définition étroite du développement.
Dans les années 1840, les Louis-Hippolyte LaFontaine, Étienne Parent et George-Étienne Cartier, se sont déjà détournés de leur passé radical ou révolutionnaire; ils ont accepté l’union du Haut et du Bas-Canada décrétée en 1840. Ils promeuvent, obtiennent et acceptent les limites du gouvernement responsable. En fait, dès 1846, l’ancien Patriote Étienne-Paschal Taché peut déclarer sans ironie que « [n]ous sommes dans nos habitudes, par nos lois, par notre religion… monarchistes et conservateurs ». Il vante la loyauté des Canadiens à leurs autorités politiques et, d’une phrase qui passera à l’histoire, affirme que « le dernier coup de canon tiré pour le maintien de la puissance anglaise en Amérique le sera par un bras canadien ». Puis, quelques années plus tard, lors de son unique voyage hors des États-Unis, l’auteur Henry David Thoreau remarque au sujet de ces Canadiens français, « They are very far from a revolution; have no quarrel with Church or State, but their vice and their virtue is content ». L’heure est à l’accommodation et non aux grands projets.
Observant et émulant les progrès industriels de la Grande-Bretagne et des États-Unis, une grande partie de la classe politique canadienne embrasse une définition économique du progrès – du moins, on propose une solution économique aux problèmes d’alors.
Ceci on le voit notamment… en construction! On a récemment reproché au Parti libéral de Jean Charest d’être trop près des firmes de construction. Or les réseaux finement tissés entre corporations de chemins de fer et politiciens au cours des années 1850 surpassent tout ce dont nous avons été témoins dans la dernière décennie. À cette époque, une vision du gouvernement qui en fait un vecteur de croissance agrémente l’enrichissement de figures politiques qui sont très souvent actionnaires du rail. La célèbre phrase de Sir Allan Napier MacNab, qui fut brièvement premier ministre du Canada-Uni, « all my politics are Railroad », est représentative de l’époque. Les plus influents Canadiens français, comme Cartier et Taché, sont désormais alliés aux grandes figures du milieu financier, tels qu’Alexander T. Galt (administrateur de la St. Lawrence and Atlantic Rail-road) et Francis Hincks (qui introduit des lois favorables à la construction ferroviaire).
D’ailleurs, des allégations de corruption visant Hincks, au sujet de ses rapports à la St. Lawrence and Atlantic, l’une des plus importantes entreprises ferroviaires de l’époque, et à la firme chargée du Grand Tronc, rognent la majorité dont il jouissait, avec Augustin-Norbert Morin, aux élections de 1854. Or le départ de Hincks marquera l’arrivée de MacNab! C’est là un virage surprenant par rapport aux années 1830, lorsque l’Assemblée législative du Bas-Canada se radicalise et refuse d’approprier des sommes à l’infrastructure.
Une certaine école de pensée influencée par le marxisme (avancée ici; considérée et nuancée ici) voit en la Confédération de 1867 à la fois la suprême expression et le dénouement de cet économisme-avant-l’économisme. Les historien.nes qui partagent ce point de vue mettent l’accent sur les arguments à caractère économique avancés par John A. Macdonald, George Brown et leurs alliés du Canada-Est (dont Cartier et Galt) en 1865 : obtenir un meilleur crédit public pour la construction ferroviaire, puiser les fonds nécessaires à la défense, faciliter le commerce qui était alors entre colonies séparées et établir une politique économique commune et cohérente. Si nous comprenons aujourd’hui que d’autres facteurs ont joué[2], ce n’est pas tout à fait un hasard de l’histoire qu’on ait défendu la Confédération canadienne sur le plan économique lors des récents débats référendaires.
Le thermidor post-1995 – c’est-à-dire l’abandon graduel de solutions constitutionnelles radicales – s’est bâti sur la déception de la défaite chez les souverainistes, le déclin de l’appui populaire à l’indépendance du Québec et la montée de nouveaux courants idéologiques, qui ont favorisé le retour d’un clivage politique gauche-droite[3]. Ainsi, à l’instar de Cartier et de Taché, de grandes figures souverainistes se convertissent au fédéralisme ou choisissent de reléguer la souveraineté à une place de seconde importance : Raymond Bachand, Lucien Bouchard, Alexandre Boulerice, Joseph Facal, Jean Lapierre, François Legault, et plusieurs autres encore.
Les gouvernements successifs et les orientations du Parti libéral du Québec illustrent ce virage. Mais le Parti québécois a aussi vécu cette réaction qui se désintéresse des questions culturelles et sociales : la défaite du gouvernement Marois et de sa « Charte des valeurs », la montée de l’entrepreneur Pierre-Karl Péladeau et la récente victoire de Jean-François Lisée, qui reporterait la question référendaire à un second mandat du PQ. La souveraineté, le plus ambitieux (peut-être le principal) projet de société offert aux Québécois depuis les années 1960 est en déroute.
Il y a là un parallèle facile à faire avec les « Rouges » du dix-neuvième siècle, ces libéraux radicaux qui sont définitivement relégués à l’opposition dans le Canada-Est. Leur vision nationale, qui fait d’eux les héritiers des démocrates des années 1830, ne reçoit pas l’approbation d’une majorité de Canadiens français, même si ceux-ci veulent encore se dire nationalistes. Aidés de l’apparente corruption du gouvernement Morin-Hincks, les Rouges atteignent leur apex en 1854 avec une vingtaine de sièges à l’Assemblée législative. Par la suite, le parti en est perte de vitesse. Il sera le seul à contester le projet de Confédération dans le Canada-Uni—et il le fera en vain.
Compte tenu de ces parallèles, y a-t-il des leçons à tirer des événements du milieu du dix-neuvième siècle? Il n’est pas ici question d’appliquer les remèdes d’une certaine époque aux situations d’aujourd’hui, ni encore de suggérer qu’il pourrait y avoir un transfert direct. Cependant, la perspective historique peut enrichir notre compréhension du présent en offrant un point de vue plus large, mieux informé.
De prime abord, l’économisme ne mène pas nécessairement à la stérilité intellectuelle. Les années 1850 sont celles des batailles entre l’Institut canadien et l’Institut national, deux centres de pensée importants qui ont alimenté les débats politiques de l’époque. Le journalisme a prospéré.
À ceci, il faut ajouter le rôle qu’une forte société civile peut jouer en assumant les responsabilités sociales et culturelles délaissées par l’État. La période du Canada-Uni coïncide avec l’épiscopat d’Ignace Bourget à Montréal et tout ce que cela entend : l’ultramontanisme, mais aussi la croissance rapide d’institutions catholiques qui, par la suite, véhiculent les aspirations nationales et sociales des Canadiens français. Il y avait donc division des responsabilités entre l’Église et l’État, de sorte que celui-ci se préoccupa de questions légales (l’abolition du régime seigneurial, la révision du Code civil) et économiques (l’infrastructure, la réciprocité commerciale avec les États-Unis)[4].
Il faut peut-être comprendre, à partir des propos des jeunes leaders mentionné.es ci-haut, que la tragédie de notre temps n’est pas tant l’économisme des instances politiques que l’absence de fortes institutions qui leur ferait contrepoids. Depuis la Révolution tranquille, on attend du gouvernement le rôle qu’a autrefois joué l’Église, un rôle quasi moral. Pourtant, si, aujourd’hui, il s’intéresse d’abord à sa mission économique, les citoyens détiennent les leviers et le pouvoir nécessaires au changement. Les efforts volontaires qu’ils peuvent déployer en marge d’institutions politiques promettent d’enrichir notre conjoncture d’un véritable esprit de communauté. Et à cet égard, il est permis d’espérer, puisque la société civile québécoise est plus forte, plus riche, plus diverse qu’elle l’était il y a un siècle et demi.
Les années 1850, comme notre temps, virent une accélération des communications et des échanges internationaux. Le télégraphe et la vapeur ont joué le même rôle révolutionnaire qu’Internet. Ces technologies ont concrétisé la globalisation; elles ont aussi facilité la création de nouveaux réseaux sociaux, intellectuels, etc. Elles peuvent aujourd’hui servir à rééquilibrer le rapport de force entre gouvernants et gouvernés. En l’absence d’une institution médiatrice unique – telle que l’Église – entre le pouvoir et la population, ces réseaux pourraient produire des initiatives citoyennes semblables à celles qui ont préparé la Révolution tranquille. Ainsi l’économisme des un.es sera enrichi de considérations sociales non plus catholiques, mais pluralistes et humanistes.
L’heure est à l’économisme, mais la question est loin d’être réglée. Les retours de pendules peuvent se produire très rapidement. Ce fut le cas à partir des années 1860. En l’espace de deux décennies, l’abrogation du traité de réciprocité, la « grande saignée », le scandale du Pacifique et la Rébellion du Nord-Ouest ont ensemble changé la donne de la vie politique au Québec. Dans notre contexte mondialisé, le choc d’événements lointains peut être également ressenti en terre québécoise – désastres écologiques, crises économiques, terrorisme et soubresauts politiques, notamment chez nos voisins du sud! Mais il ne faut non plus s’en remettre aux imprévus. Nous sommes tous acteurs historiques, portant en nous la responsabilité du présent et de l’avenir.
Ainsi, l’invitation des jeunes leaders de l’IHAF à l’engagement politique est bien reçue. La mobilisation du passé à des fins politiques pose toujours le risque de travestir les faits historiques par un schéma qui ne leur convient pas. Mais une meilleure compréhension de circonstances historiques semblables aux nôtres peut modérer nos craintes et nous permettre d’apprécier ce qui est en notre pouvoir de changer. Ce retour aux années 1850 le confirme.
Pour en savoir plus
BOCK-CÔTÉ, Mathieu. « Suspendre la lutte souverainiste au nom du progrès social ? ». Le Journal de Montréal (27 mars 2016), [en ligne] http://www.journaldemontreal.com/2016/03/27/suspendre-la-lutte-souverainiste-au-nom-du-progres-social.
CARELESS, James Maurice Stockford. The Union of the Canadas : The Growth of Canadian Institutions 1841-1857. Toronto, McClelland and Stewart, 1967, 256 p.
HAMELIN, Jean et Yves ROBY. Histoire économique du Québec, 1851-1896. Montréal, Fides, 1971, coll. « Histoire économique et sociale du Canada français », 436 p.
LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec. Tome 1 : 1760-1896. Montréal, Fides, 2000, 572 p.
KELLY, Stéphane. La Petite Loterie. Comment la Couronne a obtenu la collaboration du Canada français après 1837. Montréal, Boréal, 1997, 283 p.
PERIN, Roberto. Ignace de Montréal. Artisan d’une identité nationale. Montréal, Boréal, 2008, 303 p.
SYLVAIN, Philippe et Nive Voisine. Histoire du catholicisme québécois. Les XVIIIe et XIXe siècles. Tome 2 : Réveil et consolidation (1840-1898). Montréal, Boréal, 1991, 507 p.
WAITE, Peter B., dir. The Confederation Debates in the Province of Canada, 1865. Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2006, coll. « Carleton Library Series », no 206, 184 p.
[1] Cette session eut lieu le 7 octobre dans le contexte du congrès assemblé à Saguenay. Les participant.es étaient Dalila Awada, Miriam Fahmy, Philippe Gosselin et Simon-Pierre Savard Tremblay. L’interprétation offerte ici n’implique, bien sûr, que le présent auteur.
[2] Les débats parlementaires de 1865 révèlent que la forme que prend la Confédération est très largement influencée par les aspirations culturelles et religieuses des Canadiens français et le désir de protéger le lien impérial chez les Canadiens d’origine britannique. Voir Peter B. Waite, dir., The Confederation Debates in the Province of Canada, 1865, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2006, coll. « Carleton Library Series », no 206, 184 p.
[3] C’est d’ailleurs l’impression récemment formulée par Mathieu Bock-Côté dans son texte « Suspendre la lutte souverainiste au nom du progrès social ? », Le Journal de Montréal, 27 mars 2016, en ligne.
[4] Ces événements sont décrits par Philippe Sylvain et Nive Voisine, Histoire du catholicisme québécois. Les XVIIIe et XIXe siècles. Tome 2 : Réveil et consolidation (1840-1898), Montréal, Boréal, 1991, 507 p.; ainsi que par James Maurice Stockford Careless, The Union of the Canadas. The Growth of Canadian Institutions (1841-1857), Toronto, McClelland and Stewart, 1967, 256 p.
Articles sur les mêmes sujets