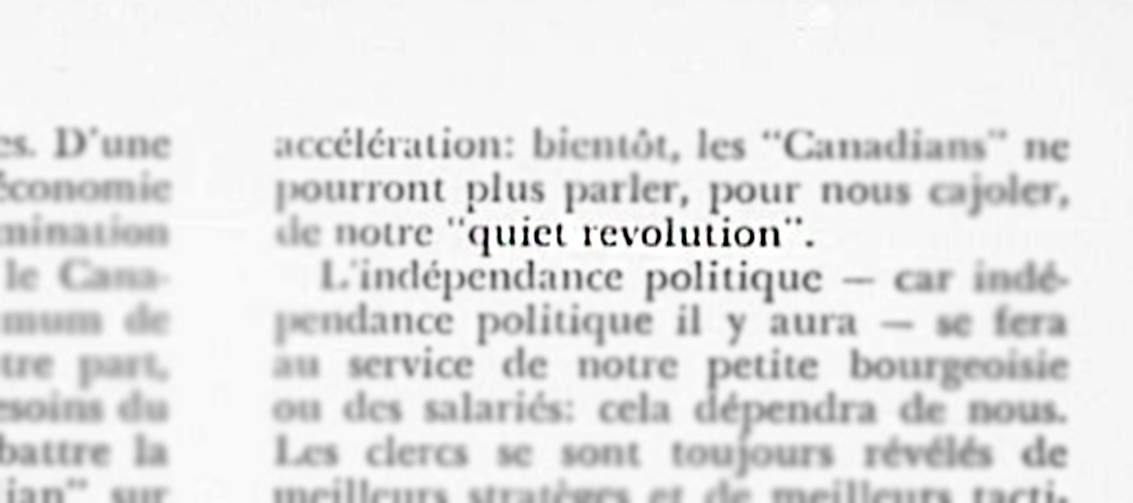Cessons nos luttes fratricides
5 min
Par Rémi Bouguet, Camille Gislard, Gina Pilote, Alex Tremblay Rémi Turner, étudiant à la maîtrise en histoire à l’Université Laval, Marie-Ève Lajoie, Anthony Savard-Goguen, étudiants au baccalauréat en sciences historiques et en études patrimoniales à l’Unversité Laval, et Samuel Venière, édutiant au diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial à l’Université Laval[1]
Version PDF
Depuis les dernières semaines, plusieurs historiens ont commenté la sortie du rapport intitulé Enseignement et recherche universitaires au Québec : l’histoire nationale négligée. Certains – pensons notamment à Donald Fyson et à Denyse Baillargeon – ont soutenu que l’histoire sociale et culturelle contribue « à élargir le champ de l’histoire politique et nationale en les ouvrant à d’autres préoccupations » alors que d’autres – Éric Bédard et Frédéric Bastien – se sont levés pour affirmer que l’histoire nationale devrait avoir « une vraie place » dans nos universités. À ces points de vue, nous voulons ajouter, le nôtre, celui d’étudiants en histoire.
En tant que futurs professeurs, chercheurs et intervenants dans le domaine, nous croyons qu’il s’agit là d’un débat stérile puisque nous jugeons qu’il n’y a pas de scission entre l’histoire nationale et l’histoire culturelle et sociale. Tout comme Denyse Baillargeon, nous croyons que les travaux de bon nombre d’entre nous peuvent enrichir l’histoire nationale, et ce, même s’ils s’inscrivent dans une perspective sociale et culturelle. Les recherches menées par l’un d’entre nous sur les relations entre les anglophones et les francophones au sein de la famille d’un ancien premier ministre – à savoir, le libéral Félix-Gabriel Marchand – alimenteront tout naturellement l’histoire politique. De même, nous espérons que celles portant sur l’œuvre du cinéaste nationaliste Pierre Perrault contribuent à l’avancement de l’histoire nationale. Et que dire d’un mémoire de maîtrise qui porte sur la professionnalisation du marketing électoral au sein de l’Union nationale? Bien que ces projets de recherche s’inscrivent tous dans une approche sociale et culturelle, ils apparaissent nécessaires pour faire évoluer l’histoire nationale. Si nous voulons être capables d’écrire de nouvelles biographies de Louis-Joseph Papineau, Honoré Mercier et Henri Bourassa – ce sur quoi travaille d’ailleurs l’historien Réal Bélanger actuellement – comme le souhaite Éric Bédard, il est nécessaire d’effectuer des recherches parallèles qui permettront d’apporter un éclairage nouveau sur la vie de ces personnages et sur le contexte dans lequel ils ont évolué.
Il est certes déplorable que des demandes de subvention de chercheurs en histoire nationale aient été rejetées, mais est-ce une raison pour remettre en question la pertinence d’études plus pointues en histoire sociale et culturelle comme le fait Frédéric Bastien? Certes, les travaux auxquels il fait référence – ceux portant sur la construction de la masculinité dans les collèges classiques au Québec entre 1800 et 1960 – ne constitueront sans doute pas le prochain succès de librairie lorsqu’ils seront publiés et c’est là un sujet qui intéressera davantage les chercheurs universitaires que le grand public, mais il demeure nécessaire que nous puissions financer des recherches couvrant un large éventail de sujets, même ceux qui pourraient sembler « trop » pointus a priori. C’est grâce à de tels travaux que nous pourrons enrichir une histoire plus générale. S’il fallait financer uniquement la recherche qui attirera un large lectorat, des cotes d’écoute faramineuses ou tout autre audimat, aussi bien fermer nos universités et laisser les grandes entreprises s’en charger.
Quant aux doutes qu’émet l’historien Frédéric Bastien sur l’intérêt que suscite l’histoire sociale et culturelle au sein du grand public (« Le problème est justement que le peuple ne veut pas de cette histoire »), ils nous apparaissent sans fondement. Lorsqu’on sort des cercles universitaires pour aller vers les sociétés d’histoire, que constate-t-on? Les conférences qui attirent le plus d’auditeurs sont celles qui traitent de la vie musicale, des traditions culinaires d’autrefois et de la façon dont on fêtait Noël au début du XXe siècle. Le grand public est friand d’histoire sociale et culturelle. Le succès de la revue Cap-aux-Diamants en témoigne brillamment. Selon Fernand Harvey, « au moins 45 % des thématiques [de ce magazine] peuvent être regroupées sous la mouvance de l’histoire culturelle et de l’ethnologie ». L’équipe de Cap-aux-Diamants n’aurait jamais réussi à publier 107 numéros s’il n’y avait pas une vive demande pour des articles de cette nature.
Non seulement l’histoire sociale et culturelle répond à un intérêt soutenu du grand public, elle contribue à enrichir l’histoire nationale et à la renouveler. Le nier, c’est s’enfermer dans une vision étriquée de l’histoire. En tant qu’étudiants en histoire, nous croyons qu’il faut mettre fin aux querelles entre l’histoire nationale et l’histoire sociale et culturelle. « Que notre cri de ralliement soit à l’avenir ces mots qui seront notre force : cessons nos luttes fratricides; unissons-nous », comme le disait si justement Honoré Mercier.
[1] Ce texte a été publié à l’origine dans Le Devoir du 19 octobre 2011 dans une version abrégée. C’est avec l’autorisation des auteurs que nous le reproduisons ici dans sa version intégrale.
Articles sur les mêmes sujets