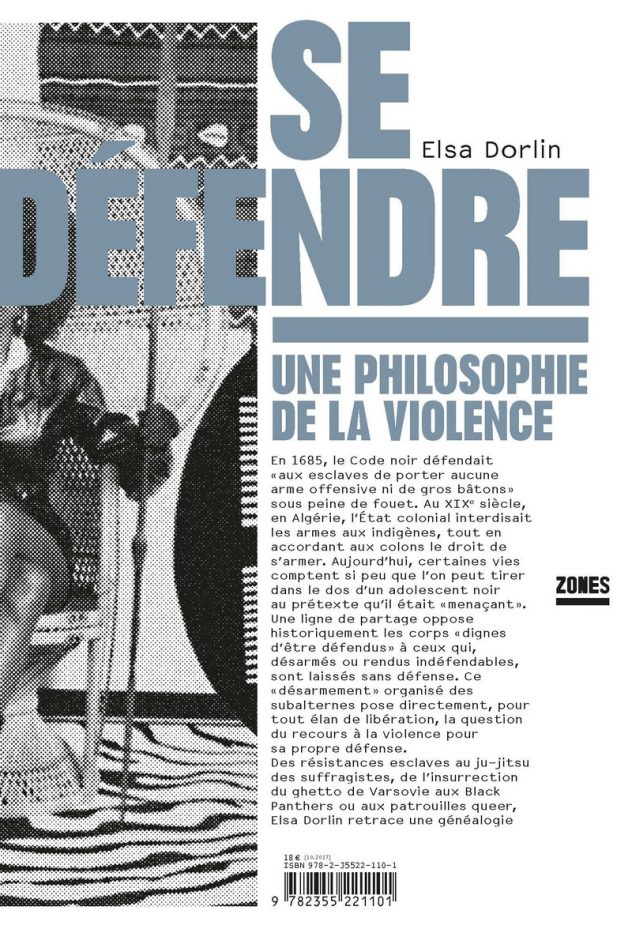Le Génocide tutsi : L’impossible justice
24 min
Par Amadou Ghouenzen Mfondi, doctorant à l’école d’études des conflits de l’Université Saint-Paul (Ottawa)
version pdf
Introduction
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 8 décembre 1948 définit le crime de génocide comme tout acte « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »[1]. Ce terme est certes nouveau mais l’histoire nous apprend que le fait décrit est tout aussi vieux que le monde. Au moment où le Rwanda commémore le 25e anniversaire du génocide tutsi, il est utile d’analyser la manière dont la soif de justice et la nécessité du pardon ont été gérées dans ce petit pays de montagnes coincé au cœur de la région des grands lacs africains.
A la suite de l’attentat qui coutât la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana en avril 1994, un massacre furieux se déclencha à Kigali, la capitale, et se transforma aussitôt en génocide sous les yeux médusés de la « communauté internationale ». Entre le 6 avril et le 1er juillet 1994, près d’un million de personnes, en majorité Tutsi, furent tuées. Un massacre vite fait. Perpétré en seulement cent jours, soit un ratio macabre de plus de 8 000 vies supprimées quotidiennement. Le tout devant les caméras du monde entier. Un génocide diffusé presqu’en direct à la télé. Du plus loin de ce que l’on sait des crimes de masse, le génocide tutsi est l’extermination à grande échelle la plus rapide de l’histoire humaine.
La gestion de l’héritage des crimes de masse pousse des sociétés sortant des conflits comme le Rwanda à envisager des solutions qui prennent en compte les blessures du passé, les ressentiments du présent et le besoin de réconciliation. Cette rationalité de l’histoire installe de fait les conditions d’un choix alambiqué entre la justice et le pardon. Le Rwanda post génocide n’a pas échappé à cette encombrante dialectique. L’expérience rwandaise du traitement de la période post-génocide fait apparaitre deux approches ambitieuses qui, dans leur relative complémentarité, eurent pour objectif de rendre justice et de favoriser le pardon et la réconciliation entre les victimes et leurs bourreaux. Un-quart de siècle après cette tragédie qui marqua à jamais l’histoire du Rwanda, toutes les juridictions spéciales qui ont été mises sur pieds pour rendre justice aux victimes et réconcilier le pays ont clôturé leurs travaux.
Les limites de la justice répressive au lendemain du génocide Tutsi
L’indifférence du conseil de sécurité de l’ONU et l’apathie des casques bleus présents au Rwanda au plus fort du génocide tutsi ont été largement dénoncées[2]. A l’occasion de la commémoration du vingtième anniversaire du génocide, comme pour s’excuser au nom de l’illustre institution qu’il représentait, l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, reconnut les erreurs des casques bleus en déclarant le 7 avril 2014 à Kigali : « Nous aurions pu faire beaucoup plus. Nous aurions dû faire beaucoup plus. Les Casques bleus ont été retirés du Rwanda au moment où l’on en avait le plus besoin […]. En l’espace d’une génération, la honte ne s’est pas effacée »[3]. En effet, face à l’émoi soulevé par ces crimes manifestes contre l’humanité, le conseil de sécurité de l’ONU, pour se faire bonne conscience et laver son honneur après avoir gardé un silence pour le moins troublant pendant tout le temps qu’ont durés les massacres, vota dès novembre 1994 la résolution 955 (1994) portant sur la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). L’objectif assigné à cette juridiction fut de « juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations du droit international commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 »[4]. Le jugement des responsables du génocide tutsi devint ainsi pour la communauté internationale une exigence morale à satisfaire.
Le TPIR constitua la première expérience de la justice pénale internationale en Afrique. Dès sa création, des voix se sont élevées pour dénoncer l’hypocrisie de la communauté internationale sur le dossier du génocide tutsi. L’ambassadeur du Rwanda à l’ONU, dont le pays avait voté contre la création du TPIR, exprima son malaise en affirmant que « la création d’un tribunal international aussi inefficace apaisera seulement la conscience de la communauté internationale plus qu’elle ne répondra aux attentes du peuple rwandais et des victimes du génocide en particulier »[5]. Mais mû par sa volonté de se racheter devant l’histoire, le conseil de sécurité de l’ONU entérina la création de cette juridiction. Par l’accord du 26 septembre 1996 entre la République Unie de Tanzanie et les Nations Unies, son siège fut installé à Arusha.
C’est dans ce contexte de défiance du gouvernement Rwandais que le TPIR entra en fonction. Il rencontra d’énormes soucis pour son installation et n’organisa son tout premier procès qu’en janvier 1997[6]. Sa première condamnation fut prononcée le 2 septembre 1998 contre Jean Paul Akayesu, ancien maire de Taba. Cette condamnation pour crime contre l’humanité est la première depuis celles prononcées par le tribunal de Nuremberg en 1946[7]. Cependant, cette justice « hors sol » que proposa l’ONU ne fut pas assez rapide pour assouvir l’impatience des victimes. Son fonctionnement fut marqué par de nombreuses imperfections parmi lesquelles la lenteur des procédures, la marginalisation des victimes et une sécurité aléatoire pour les témoins[8].
Ces disfonctionnements furent aggravés par le manque de coopération du régime de Paul Kagamé. Ce dernier ne voyait pas d’un bon œil l’éventualité des enquêtes que l’ancienne procureure du TPIR Carla Del Ponte s’apprêtait à lancer sur les crimes qu’auraient commis ses troupes (l’armée patriotique rwandaise ou APR) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Dans une lettre adressé au conseil de sécurité le 24 juillet 2002, la procureure se plaignît du manque de coopération de la part des autorités rwandaises parce que dit-elle « les éléments puissants au Rwanda s’opposent fortement aux enquêtes sur les crimes apparemment commis par les membres de l’APR en 1994 »[9]. Aussi, les accusés traduits devant le TPIR le qualifièrent de tribunal des vainqueurs dénonçant sa partialité qui, selon eux se dégage de la pratique systématique des plaidoyers de culpabilité par le bureau du procureur[10]. En décembre 2008, le directeur général de la célèbre Organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) envoya une lettre au procureur du TPIR dans laquelle il affirme qu’en 1994 le front patriotique rwandais (FPR), le parti de Paul Kagamé, dont la branche armée est l’APR a tué des milliers de civils et que ces crimes relevant de la compétence du TPIR ont été bien documentés par une commission d’expert de l’ONU[11]. En reconnaissant que ces faits ne sont pas de la même nature ni de la même ampleur que le génocide, Human Rights Watch souligna néanmoins la nécessité de rendre justice à toutes les victimes, y compris celle du FPR..
Le TPIR a fermé ses portes le 1er décembre 2015 sans n’avoir mené aucune enquête sur les crimes supposés du FPR. Au total, il a inculpé 93 personnes. Mais toutes n’ont pas été jugées car jusqu’à nos jours huit accusés ont réussi à se soustraire à la justice : Félicien Kabuga, Protais Mpiranya, Augustin Bizimana, Fulgence Kayishema, Charles Sikubwabo, Aloys Ndimbati, Charles Ryandikayo et Phénéas Munyarugarama[12]. Dans les 80 dossiers d’accusation examinés et jugés par le TPIR, il y a eu 14 acquittements, 61 condamnations, 2 actes d’accusations retirés et 3 personnes inculpées qui sont décédées avant le jugement[13]. Ce bilan est modeste à coté d’un budget de plus de deux milliards de dollars englouti dans des procédures complexes et interminables[14]. Au delà du TPIR, plusieurs juridictions nationales se sont penchées sur le cas du génocide Rwandais.
Au nom de la compétence universelle, entendue comme un système attribuant la compétence, pour poursuivre et juger une infraction, à un Etat tiers quels que soient le lieu où l’infraction a été commise, la nationalité de l’auteur ou de la victime[15] ; plusieurs pays ont ouvert des procédures judiciaires pour poursuivre les présumés génocidaires qui se sont refugiés sur leurs territoires. Les procès ont été organisés aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en France, assortis de condamnations pour certains. Mais l’action de ces États tiers est restée somme toute symbolique compte tenu de l’ampleur des crimes commis et du nombre de criminels en fuite. La plus haute juridiction rwandaise chargée de la poursuite pénale des criminels a répertorié deux cents trente-et-un fugitifs accusés de génocides[16].
Au lendemain de ces tristes événements, les nouvelles autorités rwandaises montèrent à la hâte les tribunaux nationaux pour juger les présumés génocidaires. En 1999 soit cinq ans après les faits, 2 500 accusés avaient été jugés par ces tribunaux alors que plus de 120 000 autres attendaient toujours leurs procès en prison dont certains depuis cinq ans[17]. C’était devenu humainement et juridiquement intenable. L’État ne pouvait plus continuer d’incarcérer tant de personnes sans procès pendant plusieurs années sous le régime de la présomption d’innocence. Ainsi, l’ampleur du génocide tutsi au Rwanda écrasa tous les ordres de juridiction du pays. Les présumés génocidaires attendaient inlassablement l’ouverture de leur procès. Les victimes quant à elles exprimaient de plus en plus leur impatience face à la lenteur des procédures. Et le pouvoir politique affichait sans cesse sa volonté de reconstruire le pays et de réconcilier les populations. La justice rwandaise bien qu’elle se montra volontariste se trouva très vite dépassée par les réalités ingérables des crimes de masses.
Avec une population carcérale d’une centaine de milliers de détenus pour un pays sortant de conflit, l’État ne pouvait avoir les moyens de s’assumer en offrant aux présumés génocidaires en détention un traitement respectueux de la loi et de la dignité humaine. Aussi, il n’était guère question de libérer les détenus de peur de pérenniser la culture d’impunité qui a fait son lit dans le pays depuis l’indépendance. Toutes ces raisons réunies déterminèrent l’Etat rwandais à ressusciter un vieux système de règlement de litige dans les sociétés traditionnelles du pays. C’est l’avènement des gacaca.
Les gacaca ou l’approche de la réconciliation par la justice transitionnelle
Selon Bert Ingelaere, « le nom des gacaca provient du mot umugaca, qui en kinyarwanda désigne une plante sur laquelle il est si doux de s’asseoir que l’on préférait se rassembler dessus »[18]. Il est utilisé pour désigner les tribunaux communautaires villageois qui se réunissaient sur les espaces verdoyants surplombant les collines escarpées du Rwanda. D’où le nom désormais connu de « Justice sur le gazon ». Ce fut une approche de règlement de litige dans les communautés rwandaises avant l’instauration de l’ordre colonial. Au lendemain du génocide, l’État rwandais ressuscita ce système traditionnel qui devait pallier la paralysie du système judiciaire devant la tache immense des procès en attente[19]. Aussi, il était question de « passer d’une justice exclusivement punitive à une justice restauratrice qui implique toute la société rwandaise »[20]. Les gacaca symbolisent l’harmonie de la société rwandaise précoloniale face à la haine de l’altérité et à l’idéologie génocidaire qui ont fait leur lit dans la conscience collective depuis l’installation de l’ordre colonial[21]. Mais de l’avis des chercheurs qui ont étudié de près ce système, « [l]es ‘nouvelles’ juridictions gacaca sont une ‘tradition inventée’. En intervenant par des constructions sociales et légales, l’État a conçu et mis en place une nouveauté, vaguement apparentée à l’institution existante. Les ‘anciens’ et les ‘nouveaux’ gacaca sont de natures différentes »[22]. Quoi qu’il en soit, l’État rwandais fit de ce système une variante de la justice transitionnelle.
Le concept de justice transitionnelle est apparu aux États-Unis dans les années 1980 pour servir de base à la reconstruction des pays sud-américains sortant de conflit ou de régime dictatorial[23]. Il désigne l’ensemble des approches développées par des sociétés qui veulent gérer l’héritage de violations massives ou systématiques de droits humains lorsqu’elles évoluent d’une période de conflit violent ou d’oppression vers la paix, la démocratie, l’État de droit et le respect de droits individuels et collectifs[24]. Son objectif est d’assumer le legs historique de la période du conflit, fut-il traumatisant, de nommer et de reconnaitre les exactions, mais aussi d’amnistier si possible les responsables pour que la transition vers une société démocratique soit plus assurée et davantage apaisée[25]. C’est sans doute dans cette perspective que l’assemblée nationale rwandaise adopta le 12 octobre 2000 la loi portant sur la création des juridictions gacaca[26]. Le fonctionnement de ces juridictions était hybride et conséquemment, poursuivait les objectifs suivants :
- établir la vérité sur ce qui s’était passé ;
- accélérer les procédures judiciaires à l’encontre des accusé-e-s de crimes de génocide ;
- éradiquer la culture d’impunité ;
- réconcilier les Rwandais-e-s et renforcer leur unité ;
- utiliser les capacités de la société rwandaise à faire face à ses problèmes par l’intermédiaire d’une justice fondée sur les coutumes rwandaises[27].
Les gacaca eurent ainsi la carapace d’une justice transitionnelle et le corps d’un ordre de juridiction pénale. La mise en place de ce système traduisit l’échec du système judiciaire formel et sa paralysie devant l’immensité de la tâche qu’impliqua le traitement judiciaire du génocide[28]. Face aux urgences parfois contradictoires qui se signalaient dans le pays, notamment la soif de justice des victimes et la nécessité du pardon, les gacaca s’employèrent alors à « restaurer l’ordre et l’harmonie sociale et à un degré moindre d’établir la vérité sur ce qui s’était passé, la sanction du coupable, voire une indemnisation sous la forme d’un présent ». [29] Instaurés en 2002, ces tribunaux populaires ont clôturé leurs travaux le 18 juin 2012 avec un bilan impressionnant.
En une décennie, environ 12 000 gacaca ont été créés avec en tout près de 2 millions de personnes jugées pour un taux de condamnation qui s’élève à 65% d’après les chiffres du gouvernement rwandais[30]. Le gap est assez grand à côté des quelques 76 personnes jugées par le TPIR en plus de deux décennies avec un budget beaucoup plus important. Dans les tribunaux gacaca, les condamnations pouvaient aller d’un simple dédommagement à 30 années de prison. Les accusés qui passaient aux aveux pouvaient bénéficier d’une remise de peine. Les gacaca pouvaient ainsi infliger de lourdes peines de prison à certains accusés tout en aménageant la peine des autres. Dire la vérité sur ce qui s’est passé et se repentir constituaient une porte ouverte pour la réconciliation entre les victimes et leurs bourreaux. Dans un contexte de sortie de crise comme la période post-génocide au Rwanda, la vérité devient le socle de tout processus de réconciliation et de pardon. Les juridictions gacaca s’employèrent à rendre cela possible. Mais avec des résultats mitigés.
Ces tribunaux populaires semi-traditionnels ont fait l’objet de nombreuses controverses et leurs effets sur la société rwandaise semblent être décevants si l’on considère leurs ambitions initiales qui étaient de lutter contre l’impunité et de reconstruire le vivre-ensemble entre les différentes communautés du pays. Les gacaca furent étroitement contrôlés par l’État et donc par le régime FPR qui est accusé d’avoir massacré en 1996 à l’Est de la République Démocratique du Congo près de 240 000 refugiés rwandais qu’il assimilait aux génocidaires hutus[31].
Dans ce contexte, les gacaca ont manqué de crédibilité aux yeux de certains Rwandais qui ont estimé que dans ces tribunaux populaires, une part de vérité tombe sous le coup de la censure ou de l’autocensure, poussant une partie de la population classée par définition (à tort ou à raison) du côté des tortionnaires, à avoir des ressentiments vis-à-vis de ce processus. C’est ainsi que les gacaca sont de fait considérés par certains comme une justice des vainqueurs qui ne donne pas aux accusés la possibilité de se défendre[32]. Aussi, certaines victimes du FPR ne comprennent pas pourquoi les gacaca ne traitent pas des crimes commis par les soldats de ce parti avant, pendant et après le génocide.
Même du côté des victimes du génocide, la critique n’a pas été moins acerbe vis-à-vis de ce système que certaines d’entre elles jugeaient beaucoup trop conciliant envers les criminels. Ne pouvant pas incarcérer des centaines de milliers de personnes accusées de génocide, les gacaca instaurèrent un système d’aménagement de peine après que les accusé-e-s eurent avoué leurs crimes et demandé pardon. Certaines victimes n’ont pas vu d’un bon œil la libération « trop rapide » de leurs bourreaux. Elles y voyaient les marques d’une impunité qu’elles ne pouvaient accepter[33]. Aussi, elles estiment que le résultat de leurs témoignages dans les gacaca profite uniquement à l’État puisque les travaux forcés infligés aux condamnés ne leurs servent pratiquement à rien[34].
Dans un document publié quelques mois avant la fermeture des tribunaux gagaca, et intitulé « Justice compromise : L’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda », Human Rights Watch (dont les observateurs ont couvert près de 2000 jours de procès devant les juridictions gacaca et examiné plus de 350 affaires) rapporte le témoignage de certaines personnes ayant participé aux procès[35]. Ainsi, une femme déclara en 2009 lors d’un entretien avec les observateurs de Human Rights Watch que : « Le jeune homme qui m’a violée m’a chuchoté lors du procès que si je lui pardonnais, il me rendrait hommage dans le futur. Il n’est jamais venu me voir depuis qu’il a été libéré. Je ne le vois jamais alors qu’il vit dans le même quartier. »[36] Une autre rescapée ajouta qu’ « [i]l s’agit de réconciliation imposée par le gouvernement. Le gouvernement a forcé les gens à demander et donner le pardon. Personne ne le fait volontairement […]. Le gouvernement a gracié les tueurs, pas nous »[37]. Du coté des accusé-e-s, c’est la même frustration qui est observée. L’épouse d’un homme reconnu coupable lors d’un procès devant les juridictions gacaca déclara à son tour que « Le système gacaca a laissé les Hutus et les Tutsis encore plus divisés que jamais »[38].
Cependant, tout n’a pas été que négatif. Benoît Kaboyi, l’ancien secrétaire générale de l’association IBUKA-Mémoire et Justice qui regroupe les rescapé-e-s et les proches des victimes, a indiqué que les gacaca ont plus ou moins informé la population sur ce qui s’est passé et sur l’endroit où se trouvent les morts[39].
Toutes ces lacunes observées dans le fonctionnement des structures chargées de rendre justice aux victimes du génocide tutsi participent de la difficulté de juger les crimes de masse. Si les critiques ont été acerbes pour dénoncer les imperfections des différents ordres de juridictions instaurés par les autorités rwandaises pour juger les auteurs du génocide, il est évident que le défi était presqu’insurmontable pour un jeune État comme le Rwanda qui devait tout reconstruire au lendemain de ces tueries de masse contre la communauté tutsi, jusqu’aux moindres relations de voisinage.
Quant à la réconciliation et au pardon, ils sont dictés du haut par les autorités rwandaises qui contrôlent toutes les politiques mémorielles autour du génocide. Aucune dissidence sur la question n’est tolérée. Cela semble marcher car le Rwanda est devenu un État stable tourné vers l’avenir. La mémoire du génocide est certes omniprésente dans la société, entretenue à la fois par les associations de victimes et aussi par l’État, mais le pays apparait aujourd’hui comme un ilot de paix et de prospérité dans la très instable région des grands lacs africains. Pour le moment, le gouvernement rwandais a réussi à éloigner des frontières du pays les forces négatives qui se sont (ou ont été) écartées du processus de réconciliation nationale. Notamment les ex-génocidaires rwandais refugiés en RDC depuis la fin du génocide. Ces derniers sont réunis dans un groupe politico-militaire dénommé Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR). Le renversement du régime actuel de Kagamé apparait clairement dans leur agenda[40]. Preuve que la politique du pardon et de réconciliation nationale au Rwanda a aussi ses dissidents.
Conclusion
Au demeurant, la justice au sens littéral n’a pas été rendue à toutes les victimes du génocide au Rwanda non pas par manque de volonté, mais parce qu’aucun ordre de juridiction n’a réussi face aux crimes d’une telle ampleur. Dans un rapport publié en septembre 2007, le Service national des juridictions gacaca estimait le nombre d’exécutants du génocide à plus d’un million de personnes. C’est dans cette perspective que Philippe Raynaud pense que les sociétés d’aujourd’hui doivent apprendre à modérer leur « demande de justice » qui excède les moyens de tout ordre juridique possible[41]. Au lieu de céder à l’obsession de la logique punitive pour résorber l’héritage des crimes de masse « qu’on ne peut ni punir ni pardonner », des voix s’élèvent de plus en plus pour recommander l’application d’une autre forme de justice qui cherche en priorité la reconstruction du lien social et moins le châtiment[42].
[1] Article 2 de la Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide, https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx, consulté le 05 avril 2019.
[2] Lire Dallaire, Rome?o, & Beardsley, Brent. (n.d.). J’ai serre? la main du diable : La faillite de l’humanité? au Rwanda. Outremont(Québec), Libre expression, 2003, 685p.
[3] Secretariat General des Nations Unies, “Remarks at the commemoration of the 20th anniversary of the Rwandan genocide”, 07 April 2014, disponible sur le lien https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-04-07/remarks-commemoration-20th-anniversary-rwandan-genocide-english-and
[4] Résolution 955 du 08 novembre 1994 du conseil de sécurité, Article premier du statut du TPIR
[5] Procès verbal de la réunion du conseil de sécurité du 08 Novembre 1994, p.16.
[6] J. Fernandez, « l’expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux » in AFRI, Volume IX, Bruxelles, 2008, p.227.
[7] F. Lafargue (sd), Le tombeau des Grands Lacs, CYRENE revue de géopolitique, No 2, hiver 1998, p.44.
[8] Ibid., p.44.
[9] Report of the persecutor of the international criminal tribunal for Rwanda, New York,24 jullet 2002., cité par Filip Reyntjens «La transision politique au Rwanda«, L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2003-2004, p.17.
[10] J. Fernandez, « l’expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux », p.233.
[11] Human Rights Watch, “ICTR: Address Crimes Committed by the RPF A Letter to the ICTR Prosecutor” disponible sur le lien https://www.hrw.org/news/2008/12/11/ictr-address-crimes-committed-rpf, consulté le 05 avril 2019.
[12] Nations Unies, Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, « Les fugitifs », http://www.unmict.org/fr/affaires/rechercher-les-accuses-en-fuite consulté le 10 avril 2019.
[13] Voir le bilan détaillé dans : Nations Unies Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, « Chiffres clés des procès du TPIR », http://unictr.irmct.org/fr/chiffres-cl%C3%A9s-des proc%C3%A8s-du-tpir, publié en février 2019.
[14] A. Gauthier, « Le TPIR fermera-t-il ses portes le 30 Septembre 2015 », www.collectifpartiescilesrwanda.fr consulté le 20 Décembre 2015 à 16h22.
[15] Questions internationales, « Dossier Justices internationales », No 4, Nov.-Déc. 2003, p.55.
[16] National Public Prosecution Authority (NPPA), « Suspects wanted for genocide committed against tutsi in 1994 », la liste des fugitives disponible sur le lien https://nppa.gov.rw/fileadmin/Archive/RAPORO_Z_UBUSHINJACYAHA/GENOCIDE_SUSPECT_DOCS.pdf , consulté le 07 avril 2019.
[17] I. Biruka, La protection de la femme et de l’enfant dans les conflits armés en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2006, pp.145-146.
[18] Bert Ingelaere, « Les juridictions gacaca au Rwanda », in Luc Huyse et Mark Salter (dir.), Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent La richesse des expériences africaines, Stockolm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2009, p.36.
[19] Déo Byanafashe et Paul Rutayisire (éd.), Histoire du Rwanda des origines a la fin du XXe siècle, Kigali, Imprimerie Papeterie Nouvelle, 2011, p.605.
[20] Ibid.p.605.
[21] Amadou Ghouenzen Mfondi, « Introduction à la sociohistoire des crimes de masse à caractère ethnique dans la région des Grands Lacs africains », in Revue d’histoire de l’université de Sherbrooke, Vol. X, Sherbrooke, Octobre 2017, pp.104-128.
[22] Bert Ingelaere, « Les juridictions gacaca au Rwanda », p.35.
[23] J. Sàda, « La justice transitionnelle entre politique de la mémoire et châtiment » in Spirale : arts. lettres. Sciences humaines, No 218, 2008, p.42.
[24] Centre International de Justice Transitionnelle, cité par M. Schotsmans, « La justice transitionnelle pendant … », p.202.
[25] Roland Marchal, « Justice internationale et réconciliation nationale. Ambiguïtés et débats », Politique africaine, N° 92, Avril 2003, p.9.
[26] Cahiers du centre de gestion des conflits, « Les Juridictions Gacaca et le processus de Réconciliation nationale », No3, UNR, 2003.
[27] B. Ingelaeré, « Les juridictions “gacaca” au Rwanda », p.41.
[28] Déo Byanafashe et Paul Rutayisire (éd.), Histoire du Rwanda des origines a la fin du XXe siècle, Kigali, Imprimerie Papeterie Nouvelle, 2011, p.605.
[29] B. Ingelaeré, « Les juridictions “gacaca” au Rwanda », p.36.
[30] Le monde, « Génocide : Le Rwanda clôt officiellement ses tribunaux populaires », in www.lemonde.fr publié le 12-06-2012, consulté le 25-02-2015 à 21h24.
[31] Guichaoua, André. « L’instrumentalisation politique de la justice internationale en Afrique centrale », Revue Tiers Monde, vol. 205, no. 1, 2011, p.72.
[32] B. Ingelaeré, « Les juridictions “gacaca”… », p.59.
[33] Déo Byanafashe et Paul Rutayisire (éd.), p.607.
[34] B. Ingelaeré, « Les juridictions “gacaca”… », p.52.
[35] Human Rights Watch, « Rwanda. Justice compromise : L’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda », mai 2011, https://www.hrw.org/node/99215 , consulté le 7 avril 2019.
[36]. Human Rights Watch, « Rwanda. Justice compromise : L’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda », mai 2011, https://www.hrw.org/node/99215 , consulté le 7 avril 2019, p.141.
[37] Ibid., p.141.
[38] Ibid., p.143.
[39] Ibid.,139.
[40] ISSANDA, « Dix ans de statut de Rome instituant la cour pénale internationale : quelles leçons tirées ? », in Feuillet d’information et d’éducation sur les Droits de l’Homme et la Justice, Kinshasa, ACADHODHA, 2008.
[41] Questions internationales, « La justice internationale entre l’éthique, la puissance, le droit et les juges », No 4, Novembre-Décembre 2003, p. 31.
[42] Par exemple Antoine Garapon, Magistrat et ancien secrétaire général adjoint de la FIDH cité par Questions internationales, « La justice internationale entre l’éthique, la puissance, le droit et les juges », No 4, Novembre-Décembre 2003, p. 31.
Articles sur les mêmes sujets