S’anéantir comme sujet. Une autre histoire de la violence (recension)
14 min
Par Ollivier Hubert, professeur à l’Université de Montréal, membre du Centre interuniversitaire d’étude québécoise (CIEQ) et du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS)
Version PDF
Recension de : Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, Zones, 2017, 254 p.
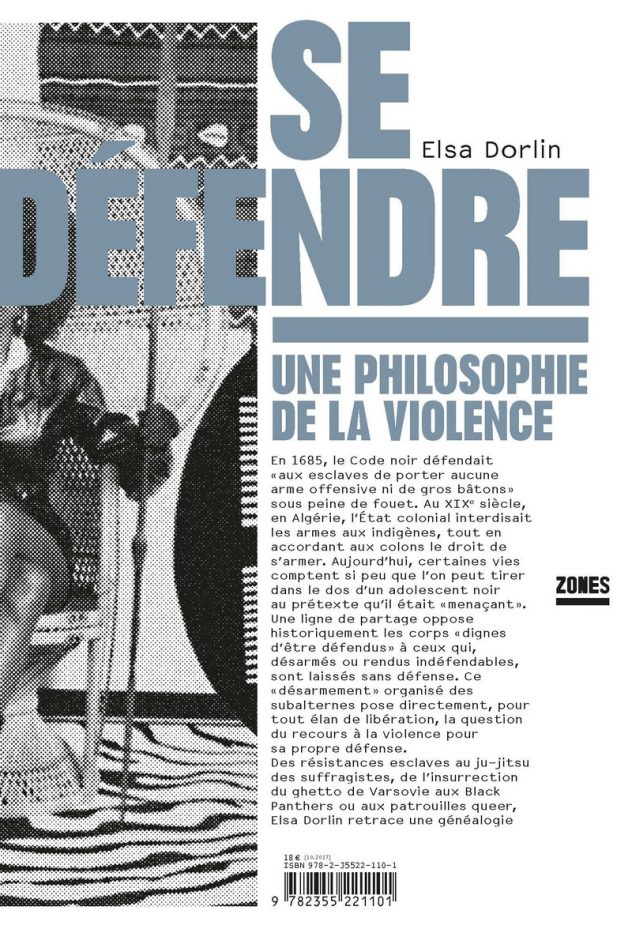
Voici un livre ambitieux, pénétrant, roboratif, exigeant, déstabilisant par endroit et, finalement, bouleversant. Car il plonge aux racines de la violence, présentant avec crudité les fondements de l’injustice et les mécanismes les plus pervers de la domination.
L’ouvrage s’ouvre sur la description d’un dispositif de supplice utilisé à la colonie de la Guadeloupe au début du XIXe siècle, du moins selon le militant antiesclavagiste Joseph-Elzear Morenas. Le condamné est publiquement exposé dans une cage de fer, l’entrejambe au-dessus d’une lame tranchante. Lorsqu’épuisé, le supplicié s’affaisse et s’inflige de cruelles blessures qui stimulent un sursaut. Ainsi sa lutte désespérée contre la douleur et la mort prolonge-t-elle sa souffrance sans pour autant le sauver. Cette entrée en matière inscrit le texte dans le sillage du Surveiller et punir de Michel Foucault et, en même temps, annonce qu’il s’en démarquera finalement assez radicalement. Car, si l’exécution du régicide Damiens mettait d’abord en scène la puissance répressive de l’État, ce sur quoi l’infâme cage de fer coloniale attire l’attention est au fond la puissance d’agir (humiliée donc reconnue comme une menace à étouffer) du sujet minoritaire qui « se défend ». Il reste que le livre prolonge une des propositions parmi les plus troublantes de Foucault : il ne faut pas penser la subjectivité comme quelque chose que le pouvoir se contenterait de soumettre, ou qui se constituerait nécessairement contre lui, mais aussi comme une production du pouvoir (la subjectivation). Ainsi le propos d’Elsa Dorlin est-il de penser le sujet dominé constitué, pour le meilleur et pour le pire, par l’acte de résistance, de défense ou même de réaction.
La métaphore du dispositif sadique guadeloupéen n’augure rien de bon à cet égard, puisqu’il « s’agit de conduire certains sujets à s’anéantir comme sujet, d’exciter leur puissance d’agir pour mieux les pousser, les exercer à leur propre perte. Produire des êtres qui, plus ils se défendent, plus ils s’abîment » (page 9). S’inventerait avec la modernité un pouvoir qui, fondé sur une anthropologie du sujet agissant, médiatiserait les manifestations désespérées de la puissance pour l’étouffer.
Là où le livre d’Elsa Dorlin atteint toutefois une dimension proprement militante et par conséquent positive, c’est en refusant de penser le sujet politique en termes universaux. Car l’agir de certaines catégories de sujets est visé par l’entreprise d’anéantissement de la volonté tandis que les capacités d’autres catégories de sujets sont au contraire non seulement reconnues, mais valorisées par l’État « de droit ». Le célèbre lynchage de Rodney King (1991), qui est la seconde scène inaugurale du livre, ainsi que le verdict du procès qui suivit, permettent en effet d’illustrer le deux poids deux mesures qui caractérise l’appréciation de l’agir subjectif. Quels peuvent bien être l’origine et le fonctionnement de ce régime de conviction qui transforme la victime en agresseur et l’agresseur en victime de la violence de l’Autre ? Judith Butler, autre inspiration majeure, outre celle de Fanon, de la réflexion d’Elsa Dorlin, propose une critique du « processus » par lequel les « perceptions sont socialement construites » (page 11) ; autrement dit historiquement constituées.
Le dominé est donc ciblé par une double logique. D’une part un dispositif qui tend à néantiser sa puissance d’agir, d’autre part une catégorisation morale qui sépare les sujets qui exercent une violence en se défendant de ceux qui exercent un droit en attaquant. Selon l’auteure, les États forgés dans l’impérialisme ne se caractériseraient pas tant par le monopole de la violence légitime que par la protection qu’ils accordent aux privilégiés en leur déléguant une partie de l’exercice d’une violence juridiquement requalifiée de « légitime défense ». Cette violence légitime disséminée est l’armature efficace de la domination sociale, s’insinuant dans les moindres replis de l’expérience. Elle fait du sujet dominé le praticien d’une autodéfense (par opposition à la légitime défense exercée par le dominant) au quotidien à la fois éreintante et constituante qui s’impose à lui dans la mesure où l’État se révèle non seulement incapable de le défendre mais en fait complice de ceux qui l’assaillent.
Elsa Dorlin explore en huit chapitres, parfois érudits mais généralement exploratoires, cette problématique aussi précise qu’immense. Huit études portant sur des contextes fort divers qui mettent en jeu la question de l’autodéfense et de la légitime défense. Nulle contemplation béate de l’esprit de révolte en ces pages, nulle apologie de rébellions héroïques, mais quelque chose de plus obscur, souvent en deçà du politique, au plus près des corps opprimés. Certaines de ces réactions ne mènent, finalement, vraiment nulle part et d’autres s’épuisent en effets pervers. Toutes permettent d’identifier les mécanismes d’assujettissement qui les provoquent, eux-mêmes justifiés par une rhétorique de la défense. Se dessine par touches ce qui serait une des caractéristiques d’un mode de gouvernement qui s’articulerait autour de la valeur défensive. D’une part, injonction faite à beaucoup à « se défendre », à se considérer comme détendeur d’un pouvoir-devoir de police et même de justice, subjectivation par conséquent du citoyen en coresponsable de l’ordre public (« en me défendant je défends la société »). Et, d’autre part, nécessité imposée aux exclus-es de l’espace de sécurité aménagé par l’État, mal défendus-es, non défendus-es, indéfendables, de survivre malgré tout.
C’est en partie en contexte colonial que s’invente un ordre social dans lequel les dominants sont défendus par l’État dans leur droit de se défendre « contre » celles et ceux qu’ils exploitent. L’État colonial français (aux Antilles, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie) protège les colons contre la violence des esclaves et des « indigènes » non seulement en réprimant férocement tout acte de révolte, mais, plus fondamentalement, en armant les colons et en désarmant les subalternes. Ces derniers-ières, pourtant maintenus-es dans une position de vulnérabilité, sont considéré-es comme a priori toujours dangereux-euses. Quant aux exactions des Blancs, elles sont préconçues en gestes de légitime défense. Le colon doté d’un permis permanent de punir et de tuer est de ce fait placé au cœur même du dispositif de la domination impérial. Désarmé, le sujet colonisé mue son corps en arme (culture du combat à mains nues, rituels de captation des forces naturelles, danses martiales, etc.) et élabore un savoir défensif qui est l’envers des pratiques punitives de la légitime défense.
Un peu curieusement, dans le souci sans doute de bien montrer par cet agencement que cette généalogie est celle d’une pratique, c’est au quatrième chapitre seulement que l’auteure traitera des fondements qui justifient dans la pensée européenne la division politique, juridique et morale entre sujets possédant les droits de se défendre et d’être défendus et sujets dépourvus de ces droits. Deux lignes sont repérables à cet égard chez les philosophes du contrat social. Hobbes reconnaît que la liberté de prendre tous les moyens à sa disposition pour « se préserver » est toujours légitime, car il pose cette liberté comme un droit naturel et non un privilège. Cette liberté est par conséquent imprescriptible et les esclaves « ne font rien contre les lois de nature s’ils s’enfuient ou s’ils égorgent leur maître ». La résistance est pour Hobbes le pendant incompressible de la domination. Foucault écrira dans le même sens que « là où il y a pouvoir, il y a résistance » (La volonté de savoir, 1976). Pour Locke au contraire, toute défense n’est pas légitime puisqu’il faut posséder quelque chose à défendre pour justifier une violence qui vise à le protéger. Seuls les propriétaires, et en particulier les propriétaires de leur propre corps, sont véritablement sujets de droit et de ce fait jouissent du privilège de se faire justice. Ainsi, ce sont au bout du compte les hommes adultes propriétaires blancs, et non l’État, qui détiennent les droits de police et de juridiction, droits qu’ils délèguent à l’État tant et aussi longtemps seulement que celui-ci se montrera capable d’assurer leur sécurité. À l’intérieur de ce libéralisme, l’État ne peut donc peut plus être caractérisé par le monopole de la violence physique légitime (Elsa Dorlin est plus prudente que moi en écrivant que la délégation « complexifie la thèse du monopole étatique de la violence légitime », page 92). Ce déboulonnage de la théorie de Weber s’appuie sur des faits incontestables et finalement permet de mieux rendre compte de certaines formes de régulation. Il explique par exemple le phénomène de la milice — si important dans toute histoire coloniale — comme un contre-transfert ; l’État déléguant à certains sujets, pour des raisons multiples, en particulier d’économies, l’exercice de son pouvoir de sûreté. Il fonde encore la place essentielle qui est faite à la régulation du port d’armes dans les cultures juridiques britannique et américaine. Esla Dorlin propose ici un récit captivant de la constitution des deux côtés de l’Atlantique de « mutuelles de défenses » en avançant que leur vitalité n’est absolument pas une incongruité (c’est-à-dire un accroc au monopole wébérien), mais plutôt qu’elle « participe d’une généalogie de l’État libéral » (page 94), la légitime défense étant un attribut de la jouissance de la liberté qui institue le citoyen (et, corollairement, destitue le subalterne).
Une des forces de l’ouvrage, qui n’en manque pas, est de faire converger dans un même texte des éléments qui appartiennent aux impérialismes américain, britannique et français, pulvérisant ainsi un argument trop connu, employé par tous les nationalistes : c’est pas moi, c’est l’autre. Elle rappelle par exemple que le colon et intellectuel d’origine française Alexandre Barde, installé en Louisiane à partir de 1842, est l’un des théoriciens et premier historien du vigilantisme qui contribua à imposer le suprémacisme blanc dans les États du Sud. Fidèle à sa ligne et conformément aux écrits de Barde lui-même, l’auteure avance, contre toute une tradition historiographique qui l’inscrit en dehors des cadres de l’État de droit, que le vigilantisme est la manifestation d’une « forme de rationalisation de la race comme fondatrice du droit » (page 103).
Le cinquième chapitre brosse une histoire du lynchage en tant que cette pratique, dont il démontre la sinistre banalité, est motivée par la défense légitime de l’honneur de « la » femme — c’est-à-dire de la race — blanche. Elle pointe au passage le rôle joué par les associations féministes blanches dans la racialisation du viol. Le sixième chapitre trace à très grandes enjambées le passage à la résistance armée du nationalisme noir américain. Il se fait partiellement par une appropriation du vigilantisme blanc, mais principalement par opposition à la stratégie de la non-violence qui perpétue la représentation du corps noir en corps désarmé et martyrisable. Cette forme d’autodéfense vise à produire « une autre sémiologie du corps militant » (page 130) et à insuffler un sentiment de fierté aux jeunes hommes sensibles à certains codes de la virilité blanche. Elsa Dorlin évoque le rôle critique des féministes à l’intérieur du Black Panther Party et elle rappellera dans le chapitre suivant que les artistes, militantes et intellectuelles africaines-américaines figurent parmi les personnalités marquantes du débat entourant les mouvements d’autodéfense féministes et LGBTQ. A contrario, elle pointe l’aporie d’un militantisme défensif qui, s’organisant primordialement autour d’un impératif grégaire de sécurité, s’inféode à l’appareil sécuritaire étatique et reproduit des rapports de pouvoir dans des espaces communautaires prétendument sécurisés. L’auteure préfère la proposition de June Jordan qui « en appelle à créer d’autres formes de communautés coalisées non pas sur le fondement d’un sujet rassuré, mais sur un engagement enragé au combat » (page 149). Tous ces développements sont au cœur de la réflexion radicale américaine des cinquante dernières années. Un des mérites du livre est de les exposer avec un art consommé de la synthèse et en français.
L’ouvrage se clôt sur un chapitre intitulé « répliquer » — le plus beau texte que j’ai lu depuis fort longtemps — qui révèle la nature proprement féministe du projet d’Elsa Dorlin. Elle y adopte un « nous » féminin et féministe tout ce qu’il y a de plus inclusif, absolument pas rassuré et tout à fait engagé et engageant. On y trouvera en particulier une lecture percutante du roman Dirty Weekend (1991) de l’autrice britannique Helen Zahavi. Elle alimente une réflexion sur le rôle de la violence sexiste dans la subjectivation féminine. L’autodéfense au quotidien est à la fois un produit de l’oppression et, d’une certaine façon, une condition de sa perpétuation : plus les femmes se défendent et plus elles s’abîment. « Nous » nous constituons en victimes et nous épuisons littéralement par le travail de déni qui consiste à faire, jour après jour, comme si la violence sexiste ordinaire, expression de la « banalité du pouvoir » masculin ne nous atteignait pas, propose-t-elle. Il s’agit bien ici, selon Dorlin, non pas d’une légitime défense encadrée par une philosophie politique et un appareil juridique, mais de l’exercice journalier, et de ce fait accablant, de techniques d’autodéfense féminine (et non pas féministe, un autre chapitre passionnant du livre décrit l’histoire contradictoire de ces deux techniques corporelles) qui, si elles permettent de survivre à la domination, n’en contestent pas le fait et engagent le sujet dans une forme de négation de soi. Bella, l’héroïne du roman Dirty Weekend qui fit scandale à l’époque de sa parution, s’appropriera son existence en abandonnant la pratique des tactiques d’autodéfense héritées, en transgressant sa condition politique, en oubliant le souci des autres pour développer un souci de soi à partir duquel il est possible d’imposer à l’autre la reconnaissance de sa propre altérité. En répliquant, le sujet dominé refuse le désarmement et les méthodes défensives auxquelles ce désarmement le condamne. Il rejette, au bout du compte, la subjectivation malheureuse dans laquelle le confine historiquement la gouvernementalité sécuritaire.
En la problématisant sous l’angle de la défense, ce livre ouvre des perspectives tout à fait originales pour repenser historiquement la violence. Il rappelle que, toute violence étant a priori théorisée par ceux qui l’exercent comme une défense, l’étude historienne de ses manifestations passe obligatoirement par une considération fine des traditions discursives mobilisées et de la position sociale des protagonistes, ce que de très nombreux ouvrages qui prétendent « mesurer » l’évolution du « niveau » de violence dans une « société » ne font absolument pas. Elsa Dorlin prend, je crois, un peu trop de pincettes avec ma profession en assurant qu’elle ne « prétend » pas « faire œuvre d’histoire, mais bien travailler à une généalogie » dont « le corps des dominé.e.s constitue la principale archive » (page 16). On aimerait tellement lire davantage d’œuvres d’histoire qui prétendent à l’intelligence de cette généalogie-là !
Articles sur les mêmes sujets



