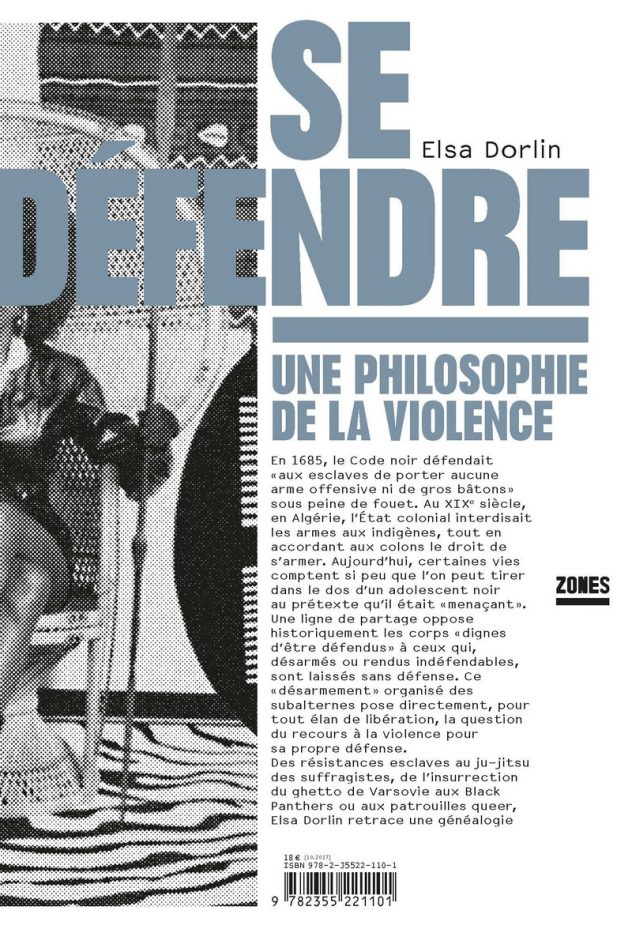Decolonizing Dialectics, de George Ciccariello-Maher : recension
12 min
Par Philippe Néméh-Nombré, doctorant en sociologie à l’Université de Montréal
Version PDF (à venir)
Recension de : CICCARIELLO-MAHER, George. Decolonizing Dialectics. Durham, Duke University Press, 2017, 256 p.

« All I want for Christmas is white genocide. » Il n’en fallait pas plus pour heurter les sensibilités. La provocation de George Ciccariello-Maher a – trop – fonctionné. En décembre 2017, le professeur de politique et de global studies a présenté sa démission à l’Université Drexel; se jouant d’un concept imaginé et brandi au même titre que le « racisme anti-blanc » par une droite blanche et nationaliste qui met en garde contre une « menace » qui guetterait les États-Unis, son tweet datant du 24 décembre 2016 lui a valu harcèlement, attaques et menaces de mort, au point où la pression en serait devenue « insoutenable ». L’affaire, traitée principalement sous l’angle de la liberté académique et de la (re)montée en puissance de tendances suprémacistes, a fait grand bruit, notamment dans les médias nationaux. D’autant plus que le principal intéressé s’est assuré de consolider les oppositions en multipliant les sorties incisives et les propositions du même ordre.
Pourtant, s’il fallait encore s’en convaincre, ces apparitions répétées ont fait bien plus qu’assurer une trame narrative au feuilleton. Elles ont également permis de mettre en évidence l’intention intellectuelle et politique de Ciccariello-Maher d’en témoigner et de l’inscrire dans une continuité pour l’essentiel évacuée de la couverture médiatique : faire émerger les ruptures politiques, les investir et les situer dans un processus de (ré)arrangements d’identités, de luttes et de sociabilités. Une posture, finalement, qui correspond parfaitement au point de départ de son plus récent ouvrage, Decolonizing Dialectics. Dans ce livre, l’auteur actualise, articule et met justement à l’épreuve les potentialités libératrices d’une insistance sur les oppositions dynamiques et fécondes de même que sur la formation de solidarités oppositionnelles comme processus politique. En plus d’éclairer le caractère subversif des interventions publiques de Ciccariello-Maher, la réflexion fine qui y est proposée entend surtout permettre de penser – et de vivre – les luttes politiques radicales dans des paramètres qui favorisent leur déploiement. La proposition de Ciccariello-Maher est d’ancrer dans la pratique politique une révision et un dépassement des usages limitatifs de la pensée dialectique, une pensée qui s’intéresse essentiellement au mouvement dynamique entre oppositions conflictuelles. Celle-ci serait, selon lui, trop souvent mise au service de résolutions conservatrices et harmonieuses plutôt qu’à la mise en évidence souhaitable et nécessaire des divisions combatives, des indéterminations du conflit et des futurs radicaux imprédictibles (p. 6).
Inaugurant la série Radical Américas des éditions Duke University Press, qui se consacre essentiellement aux théorisations et aux praxis transformatrices des luttes contemporaines, Decolonizing Dialectics donne le ton en investissant l’espace de négociation entre pensées radicales et traditions académiques. L’ouvrage esquisse une réarticulation décolonisée d’une théorie des oppositions dynamiques, à travers la relecture critique d’une tradition faisant autorité et dont les tendances dominantes – héritées surtout de la dialectique hégélienne – menacent les possibles; les perspectives décoloniales. Inspiré du modèle généalogique de Michel Foucault et de sa théorisation du contre-discours, l’exercice propose plus spécifiquement une réactivation et une remise en mouvement, dans les dynamiques contemporaines, de savoirs subjugués forçant l’ouverture décoloniale du mouvement dialectique (pp. 16-17). Malgré la densité des différents développements que l’auteur fait entrer en dialogue, l’approche flexible et transformatrice préconisée lui permet de faire émerger des outils déterminants et un plan de « sauvetage » (p. 13) de la pratique dialectique, au fil d’une démonstration méticuleuse, évitant habilement le paradoxe d’un mouvement linéaire et déterminé.
Le premier chapitre présente une première opposition théorique et politique à « la » dialectique, à partir de laquelle Ciccariello-Maher entend réactualiser certains éléments « radicalisés » d’une charge assumée contre la pratique dialectique comme méthode « abusive » de résolution des contradictions. C’est dans la pensée de Georges Sorel que l’auteur identifie le développement d’une critique forte de l’« harmonie sociale » qui réduirait la pratique dialectique à un mouvement téléologique (p. 23-24). Pour Ciccariello-Maher, cependant, la virulence de Sorel à l’endroit de « la » dialectique ne l’empêche pourtant pas de proposer une reprise de la dialectique de la lutte des classes marxienne, en trois moments essentiels : 1) le diagnostic d’une immobilité dans le présent; 2) la réactivation par le prolétariat du mouvement dynamique des oppositions, fondée discursivement (à travers un « mythe révolutionnaire ») sur l’« incommensurabilité » des identités de classe; et 3) le rejet du déterminisme par l’acceptation de l’indéterminabilité du potentiel créatif et créateur de la violence révolutionnaire (p. 28). C’est en cela, selon Ciccariello-Maher, que la pensée dialectique sorélienne tend vers une ouverture décoloniale. Elle permet aussi bien une attention aux conditions sociales particulières et contingentes qui circonscriront les oppositions qu’un rejet du mouvement historique déterminé par une totalité idéologique, en plus d’insister sur la violence légitime (p. 44).
C’est dans cet esprit que l’auteur suggère, dans les deuxième et troisième chapitres, une rencontre heureuse entre Georges Sorel et Franz Fanon, malgré qu’ils insistent différemment sur la classe, et en dépit de l’apparente distance entre la négation de la totalité chez Sorel et le nationalisme tiers-mondiste d’État chez Fanon. Au moyen de la violence, envisagée comme productive et génératrice d’identités politiques et de transformations du monde, la mise en dialogue des théories de Sorel et de Fanon permet de penser la race, la classe et la nation de manière interdépendante et historicisée (p. 48). Ciccariello-Maher propose donc une lecture précise, bien que paradoxalement totalisante – quelque peu limitée quant à la prise en compte des ruptures dans la pensée fanonienne –, du rejet de la tradition dialectique chez Fanon. Ce rejet est entamé dans Peau noire, masques blancs et culmine sur la formulation « radicale » d’une dialectique permettant de dépasser l’impasse de la suprématie blanche, d’abord, puis dans Les Damnés de la terre, celle du colonialisme. À partir de l’expérience subjective du racisme vécu comme fixation, refus d’humanité et privation du monde, Fanon pose d’abord l’impossibilité d’un mouvement dialectique du fait de l’inexistence ontologique de la zone habitée subjectivement par les colonisés.es. Cette non-existence et ce non-accès à l’existence empêchent l’entrée dans la dialectique de la reconnaissance et impliquent un pré-conflit, c’est-à-dire un combat d’un seul côté, soit du côté de la zone du non-être qui doit violemment affirmer son existence – nécessairement oppositionnelle, donc – pour rendre possible, poser puis entretenir les oppositions nécessaires au mouvement dialectique (pp. 50-71).
Par un déplacement dans le contexte des luttes décoloniales, le troisième chapitre s’intéresse ensuite à la transposition effectuée dans Les Damnés de la terre, où la nation, plutôt que l’identité, recadre l’objet de la dialectique de combat. Les nouveaux paramètres établis, le socle de la dialectique se situe désormais dans le « manichéisme absolu » (p. 79), la distinction fondamentale et sans symétrie entre les mondes colonisant et colonisé. C’est donc dans l’inversion – temporairement – « simpliste » du manichéisme colonial qu’émerge la décolonisation comme passage des oppositions figées au combat (pp. 80-82). C’est dans la distinction entre force et violence que cette dernière ne devient pas cyclique, et dans la conscience des divisions « intra-nationales » et donc des luttes « intra-dialectiques » (p. 87) que se maintiennent l’ouverture et la non-finitude du mouvement dialectique décolonial.
La dialectique fanonienne introduit ainsi, pour la démonstration, le défi d’identifier les identités politiques les plus pertinentes pour le travail de décolonisation. C’est à cela que s’intéresse le quatrième chapitre, qui met à profit la conception du « peuple » d’Enrique Dussel, formulée à l’intérieur de la tradition dialectique hégélienne, mais aussi sur la base du concept d’« extériorité » d’Emmanuel Levinas qu’il parvient à déplacer (p. 104). Selon Ciccariello-Maher, c’est ce qui permet à Dussel de maintenir la dimension conflictuelle, hétérogène et transformatrice de la nation de Fanon, mais aussi d’en élargir la perspective transnationale tout en permettant de penser conjointement la race, la classe et la nation comme une multiplicité de micro-dialectiques. C’est donc en situant l’« analectique » dérivée de la notion d’extériorité chez Levinas – le déplacement du regard vers l’Autre ou l’apparition de l’Autre-extériorité – dans une perspective historique plutôt qu’éthique que Dussel en fait un « moment » de la progression dialectique. La définition du « peuple » qu’il construit se situe précisément dans cette relation dynamique entre dialectique et analectique (p. 114). Pour l’auteur, l’« anadialectique » de Dussel rejoint d’abord les perspectives de Sorel en ce que ce dernier théorise l’incommensurabilité des classes qui, bien qu’« interne », nie l’harmonie sociale et se pose en précondition au mouvement dialectique. Elle rejoint également, malgré certaines différences quant aux conceptions de l’extériorité, la reformulation fanonienne de la dialectique hégélienne qui pose ontologiquement la séparation et la déqualification coloniale d’une non-existence à la base du mouvement dialectique imprévisible et non-fini (p. 121).
La pertinence de ce cadre en trois temps doit cependant être vérifiée dans des dynamiques géopolitiques concrètes qui permettent d’évaluer l’utilité du « peuple » comme identité politique au centre d’une dialectique décoloniale. Aux perspectives eurocentrées du « peuple », homogène et homogénéisant, l’auteur entend donc opposer, dans le cinquième et dernier chapitre, un concept ancré dans les réalités de l’Amérique latine et de ses mouvements révolutionnaires (p. 129). L’Amérique latine et plus particulièrement le Venezuela permettent de comprendre le peuple comme catégorie de rupture autant que d’unité. Pour Ciccariello-Maher, l’identité populaire constitue l’identité combative dans le contexte de l’Amérique latine, traversée de multiples divisions et exclusions qui doivent se rejoindre dans une lutte. Le chapitre esquisse donc une « libération » et une « décolonisation » du concept de « peuple » à travers et avec les luttes politiques concrètes au Venezuela. Il propose d’abord une définition de l’identité populaire en Amérique latine selon la reformulation récente de Dussel, pour ensuite s’intéresser aux spécificités du contexte vénézuélien et au contenu « local » d’une identité populaire (p. 136). Il se concentre finalement sur les luttes concrètes pour souligner l’utilité du peuple comme concept et comme identité hétérogènes, ainsi que l’intérêt de la dialectique décolonisée comme processus. Ces luttes rejoignent tant l’impulsion subjective du combat chez Sorel que l’attention à la temporalité chez Fanon et l’insistance de Dussel sur l’extériorité et l’élargissement des luttes présentes vers des futurs reconfigurés (p. 145).
Il s’agissait, pour l’auteur, de circonscrire de toute urgence les dangers de la fermeture dialectique, de mettre en cause sa charge téléologique pour en identifier les limites et de faire (ré)émerger le potentiel décolonial des oppositions dynamiques dans un mouvement non-fini et ouvert. Si la démonstration parvient assez difficilement à convaincre de la nécessité de la dialectique pour la praxis et l’imagination décoloniales, et surprend – déçoit – par son attention marginale, voire nulle, aux dimensions genrées et aux nombreuses perspectives féministes notamment décoloniales, elle n’en perd pas, en revanche, tout son intérêt. Elle réussit très justement à situer les écueils d’une pratique délaissant le jeu entre intérieur et extérieur, et à mettre en cause politiquement et théoriquement les pratiques dialectiques qui court-circuitent les possibilités transformatrices. Le mouvement historique linéaire, soit la conception de l’histoire qui sert de cadre à la tradition dialectique, présuppose une existence ontologique circonscrite dans le temps et dans l’espace qui produit son extérieur et détermine ses usages. Pour l’auteur, c’est dans la distance immense entre « la » dialectique et une dialectique décolonisée se fondant dans le pré-dialectique, dans la déqualification ontologique et conséquemment dans l’apparition violente, qu’il devient possible de reformuler les oppositions invisibles, sous l’angle de la différence coloniale, et de faire de la pratique dialectique une arme potentiellement utile. C’est d’ailleurs dans une perspective similaire que Ciccariello-Maher invite, en guise de conclusion, à de futurs développements qui investigueraient une autre tension entre décolonisation et tradition occidentale, à savoir les relations compliquées, mais potentiellement fécondes entre décolonisation et anarchisme (pp. 168-170). Malgré l’insistance réaffirmée quant à l’intention et au potentiel transformateurs d’une telle démarche, cette dernière ouverture rappelle cependant une autre limite non-négligeable de Decolonizing Dialectics : son utilité effective et pratique, pour les mouvements sociaux et les luttes radicales dans le présent, s’étiole dans la complexité imposante de l’argumentation, qui nécessite malgré sa clarté une certaine familiarité conceptuelle et théorique.
Pour en savoir plus
CICCARIELLO-MAHER, George. Decolonizing Dialectics. Durham, Duke University Press, 2017, 256 p.
Articles sur les mêmes sujets