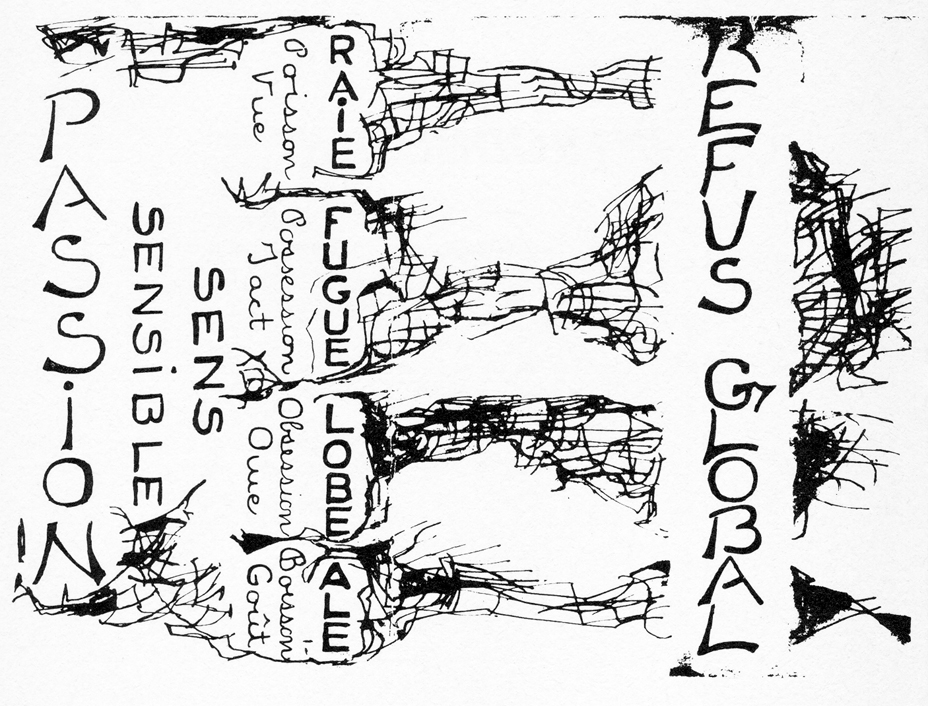Domination en crise
Par Zénaïde Berg, Martine El Ouardi et Anne Morais
On a d’autres préoccupations que de jouir de nos privilèges
Kery James, Vivre ou mourir ensemble, 2019
Philippe Lorange, étudiant en philosophie politique à l’Université de Montréal, signait le 31 janvier dernier, avec l’appui d’une soixantaine de personnes, son « Manifeste contre le dogmatisme universitaire ». Nous en avons produit une brève analyse critique, publiée dans Le Devoir, respectant un maximum de 5000 caractères et tentant également d’édulcorer notre pensée afin de la rendre acceptable pour cette plateforme. Le présent texte se veut donc être une extension de notre première analyse : il s’agit en fait, en quelque sorte, de notre propre manifeste, et non d’une réponse, comme l’a été notre précédent billet. Nous souhaitons aussi attirer l’attention vers le contexte sociopolitique présent de manière plus globale : notre texte s’inscrit dans ce contexte, et pas seulement dans une logique argumentative avec les tenants de la droite réactionnaire que sont Lorange et ses pairs. À noter que nous écrivons ce texte en nos noms personnels et n’engageons que nous à son adhésion.
Le « Manifeste contre le dogmatisme universitaire » postule que la « gauche » monopolise les lieux de pouvoir; qu’elle contrôle le monde, tant la société au sens large que l’académie; et que les théories et épistémologies critiques submergent les autres théories dans les milieux universitaires. Notre objectif a d’abord été de démontrer la fausseté de ces affirmations, ce que nous avons fait dans notre lettre ouverte. Nous proposons à présent de soulever la malhonnêteté derrière la mobilisation du concept de liberté d’expression, qui occulte les rapports de pouvoir sous-tendant les discours hégémoniques; et de reconnaître que le manque de représentation des groupes minoritaires n’est pas qu’à constater, mais aussi à combattre. Ces propositions nous mènent donc vers une orientation profondément militante du rôle des sciences sociales, pour laquelle nous prenons position. En d’autres termes, nous postulons que l’heure du débat est largement dépassée, et doit laisser la place à des changements structurels significatifs, afin d’espérer contrer les diverses violences auxquelles les groupes minoritaires sont exposés.
Débat et liberté d’expression
Les signataires du « Manifeste contre le dogme universitaire » nous enjoignent à permettre l’échange d’une pluralité d’opinions « dans un cadre respectueux et juste ». Ce type d’argument repose sur la prémisse erronée de la possibilité d’un tel échange, prémisse qui occulte les rapports de pouvoir qui traversent et sont inhérents à toute forme de discussion. L’importance accordée au débat et à l’échange s’appuie en effet sur la « fiction fondatrice de la société libérale selon laquelle tout un chacun bénéficie du même traitement, indépendamment de son origine, son ethnicité, sa religion, son sexe […] » (Salée, 2010). Cette fiction est caractéristique des sociétés néolibérales, où les inégalités ne sont pas conceptualisées de manière structurelle et ont plutôt tendance à être individualisées et expliquées par le seul mérite des individus en question. Il nous semble donc primordial de défendre l’idée que la liberté d’expression s’exerce de manière inégalitaire dans un contexte sociopolitique où un groupe majoritaire possède « le monopole des ressources et de leur distribution » (Juteau, 1999). Il s’agit donc de repolitiser les inégalités et les rapports de pouvoir afin de montrer qu’il est absurde de parler de débat alors qu’un des groupes antagonistes se retrouve dans une position minoritaire.
Les efforts de Jürgen Habermas pour développer une éthique de la discussion mettent d’ailleurs en évidence le caractère fautif d’une telle proposition de dialogue. Habermas suggère en effet qu’en s’appuyant sur ce qu’il appelle la rationalité communicationnelle, il serait possible d’avoir des discussions égalitaires, à l’issue desquelles émergerait naturellement un consensus autour de l’argument le plus rationnel. Autrement dit, selon Habermas, en mettant en place des règles qui permettraient cette rationalité communicationnelle, on pourrait espérer se conformer à l’idéal du débat démocratique. Force est toutefois de constater que nulle part, ni dans l’académie ni ailleurs, n’a-t-on pu voir de telles règles se former, être appliquées, et donner lieu à l’atteinte du but fixé par Habermas. Il semble en effet y avoir quelque chose d’intrinsèquement inégalitaire à toute discussion. C’est ce qu’ont notamment montré Foucault et Derrida : le débat est, à tout moment, pénétré et régi par des enjeux de pouvoir (Flyvbjerg, 2001). Ce sont ceux-ci qui positionnent les participant·e·s de manière plus ou moins avantageuse, en fonction de leur place dans la hiérarchie sociale, et qui, ultimement, déterminent l’issue du débat. En d’autres termes, ce n’est pas l’argument le plus convaincant qui l’emporte, comme le souhaiterait Habermas, mais plutôt celui qui est porté par le participant le plus fort, jusqu’à ce que les autres soient forcés d’abdiquer.
Ainsi, appeler à un débat égalitaire dans le cadre du monde académique semble d’abord bien utopique. Tout débat sera toujours marqué par les rapports de pouvoir qui distinguent ceux et celles qui y participent, étant donné l’impossibilité apparente de trouver des règles discursives qui permettraient d’évacuer ces rapports. En outre, il ne nous apparaît pas non plus souhaitable de prétendre à un tel idéal. Ce faisant, nous risquerions de minimiser les rapports de pouvoir que nous n’aurions pas réussi à évacuer, et ainsi supposer, comme le font les auteurs du manifeste, que des théoriciennes noires ont d’emblée la même autorité dans le milieu académique et le débat public que, par exemple, les hommes blancs. Il s’en suivrait donc que si leur argumentaire n’est pas accepté par la majorité ou ne fait pas l’objet d’un consensus, c’est en raison de sa faiblesse, alors qu’il n’en est rien. Les porteurs et porteuses de théories critiques, et particulièrement ceux et celles qui appartiennent à des groupes minoritaires, sont depuis toujours marginalisé·e·s dans la sphère académique, accueilli·e·s avec moins de sérieux, et font l’objet de moins d’attention. Si leurs argumentaires ne sont pas acceptés, cela n’a donc rien à voir avec leur intelligence ou leur bien-fondé, et plutôt tout à voir avec leur position dominée dans le cadre du débat académique.
L’enjeu n’est donc pas d’avoir plus de débats, ou d’avoir un meilleur débat, sachant que celui-ci restera toujours profondément inégalitaire, et que les idées qui ont toujours été dominantes risquent encore d’en ressortir victorieuses. Il s’agit plutôt d’effectuer une sorte de retour du balancier, en donnant de l’attention à des théories qui n’en ont jamais suffisamment reçu, dans l’espoir que celles-ci soient enfin écoutées et que l’académie puisse avoir un rôle de premier plan dans la lutte pour le changement social.
Pour des sciences sociales militantes
La prétention à la neutralité a longtemps été le point d’ancrage des sciences sociales. Max Weber parlait de neutralité axiologique, la décrivant ainsi comme un idéal vers lequel tout chercheur devrait tendre, en suspendant ses valeurs le temps de la recherche (Weber, 1965). Nous pensons toutefois qu’il est impossible de suspendre ses valeurs, ne serait-ce qu’un instant : celles-ci cadrent notre vision du monde à tout moment, y compris dans le contexte de la recherche. Le choix d’un objet d’étude et celui d’une méthodologie sont tous les deux nécessairement teintés par des préoccupations politiques. Ainsi, le chercheur ou la chercheure qui choisit de se pencher sur le phénomène de la gentrification à partir d’une méthodologie qualitative et interprétative n’a pas les mêmes intentions ni les mêmes conceptions épistémologiques que celui ou celle qui souhaite mathématiser l’impact macroéconomique de la réglementation des innovations technologiques. Des décisions s’imposent à tout moment d’une étude, et elles seront toujours politiques. Qui plus est, le monde académique est de plus en plus à la solde des intérêts privés, qui servent à financer la recherche dans le contexte des coupures budgétaires imposées par les politiques d’austérité. Il devient alors gravement naïf de continuer de prétendre à une quelconque neutralité, dans la mesure où ces intérêts marchands orientent nécessairement encore davantage la recherche dans une certaine direction. Le danger, ce n’est pas d’avoir un parti pris : c’est un parti pris qui s’ignore.
De plus, la volonté de neutralité en sciences sociales s’appuie sur l’idée qu’il existe des savoirs qui seraient non-situés, et que ces savoirs seraient évidemment plus crédibles et admissibles que les savoirs produits par des savant·e·s non objectif·ive·s. Ce genre de présupposé glisse dans une conception eurocentrée et blanche des sciences sociales et de leur rôle, étant donné une forte tendance à discréditer les sources non-blanches (Van Dijk, 2006). Celle-ci a notamment cours dans les domaines des sciences sociales, dominés par les théories positivistes qui, de par leur supposée universalité, occultent les expériences des groupes minoritaires. En d’autres mots, prôner une pratique neutre des sciences sociales permet de délégitimer les groupes minoritaires à participer à leur élaboration, mais aussi d’invisibiliser ces mêmes groupes. M. Jacqui Alexander et Chandra Talpade Mohanty défendent d’ailleurs l’idée que c’est bien la majorité blanche masculine et hétérosexuelle qui détermine les savoirs qui sont considérés comme légitimes, laquelle était déjà présente chez Patricia Hill Collins dans « La pensée féministe Noire ». Nous adhérons à cette idée, à savoir que ce sont effectivement les groupes majoritaires qui produisent et qui déterminent la légitimité des savoirs qui sont produits à l’université. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas seulement une représentation académique des théories critiques, mais aussi une déconstruction de la dualité entre savoirs militants, détenus par des personnes en lutte de manière empirique, et savoirs académiques pour être en mesure de défaire à leur tour les rapports de pouvoir. Admettre le caractère infiniment politique des sciences sociales permet à celles-ci de questionner les structures sociales qui désavantagent les groupes minoritaires et de travailler à les combattre.
Les théories critiques ont d’ailleurs souvent émergé dans des contextes de lutte, afin de nommer des réalités vécues. Les partisans du conservatisme qui critiquent leur inclusion dans le monde académique admettent ce faisant qu’ils ne conçoivent pas que ces théories puissent être fondées dans la réalité. En fait, c’est qu’elles décrivent une réalité qu’eux-mêmes ne voient pas, et refusent de voir : hommes privilégiés au sommet de la hiérarchie sociale, ils ne conçoivent pas que des oppressions puissent exister sans qu’eux n’en soient conscients. Or, en se murant ainsi dans leurs privilèges, ils freinent les efforts de ceux et celles qui sont opprimé·e·s, et pour qui des termes comme « intersectionnalité » et « colonialisme » servent d’outils indispensables à la lutte.
Pour ne citer qu’un seul exemple, le Combahee River Collective, un groupe politique de femmes Noires majoritairement lesbiennes qui s’est réuni de 1974 à 1980 dans la ville de Boston aux États-Unis, a écrit une déclaration publiée en 1979 et considérée comme étant pionnière de la pensée féministe noire[1]. La construction du Combahee River Collective et la rédaction de leur déclaration s’inscrivent toutes deux dans le contexte du déploiement du féminisme Noir aux États-Unis de 1968 à 1980 face aux lacunes du Mouvement Noir et du Mouvement féministe qui n’ont pas pensé l’imbrication et l’articulation des rapports sociaux de pouvoir. Les membres de ce collectif accordent une attention toute particulière au fait que les oppressions de race, de classe et de sexe ne doivent pas être traitées de manière distincte puisque leurs expériences leur démontrent que ces différentes oppressions agissent sur elles simultanément. Les idées issues de ce collectif qui découlent des expériences vécues de ses membres ont permis que soit développé dans le milieu académique le concept d’intersectionnalité en 1989 par Kimberlé Crenshaw. Cet exemple permet d’illustrer le lien direct entre expérience vécue et production de recherche académique. Il s’agit ici de montrer que les concepts développés par les études féministes, postcoloniales et décoloniales comme celui d’intersectionnalité sont en lien direct avec l’expérience vécue des groupes marginalisées, et ne correspondent pas à des idées développées par des universitaires au sommet de leur tour d’ivoire. Prendre cela en considération permet de comprendre l’imbrication du savant et du politique plutôt que leur séparation, et aussi de discréditer la populaire idée, reprise par Lorange dans son manifeste, d’une déconnexion totale entre les savoirs académiques et les expériences populaires quotidiennes.
Conclusion
Ce dont nous essayons de rendre compte ici, outre les rapports de pouvoir observables dans les domaines structurel, disciplinaire, culturel, individuel et psychique[2] de l’interaction sociale, est l’impertinence du propos victimaire de Philippe Lorange et ses co-signataires. En effet, ceux-ci sont nostalgiques d’une période qui est loin d’être révolue dans l’état actuel des choses, c’est-à-dire celle de la position hégémonique qu’occupent les hommes privilégiés. Il ne s’agit donc pas, de la part de ces personnes, d’une volonté de s’exprimer, mais bien de maintenir leur domination sur les groupes qui leur sont subalternes; de pouvoir tout dire, et être partout. Ces lamentations sont d’une ironie qui goûte acide, dans un contexte où notre premier ministre peut occulter les dimensions racistes et discriminatoires des politiques de son gouvernement le jour même où nous commémorons un attentat terroriste islamophobe commis trois ans plus tôt seulement; où il faut trente ans pour reconnaître le caractère politique d’un féminicide où quatorze femmes ont perdu la vie; où des incels disposent d’un espace sur les réseaux sociaux, s’encourageant entre eux à la misogynie, à la violence et même au meurtre de femmes, au point où certains passeront à l’acte, comme ce fut le cas le 23 avril 2018 à Toronto par exemple; où des femmes luttent pour disposer d’un accès à l’avortement alors que d’autres, appartenant à des communautés autochtones, doivent composer avec des stérilisations forcées; où les militant·e·s de gauche doivent se masquer et craignent la violence de la police alors que, parallèlement, des groupes d’extrême-droite peuvent compter sur la protection des policier·ère·s lors de leurs événements, qui invitent pourtant à la marginalisation et à la violence sur des groupes minoritaires; où les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis sont victimes d’un génocide, et plus particulièrement les femmes, sans pourtant que cela ne crée d’émoi particulier; où on jette sans problème 18 000 dossiers d’immigration à la poubelle; où un nombre effarant de personnes racisées sont profilées, fichées, battues et/ou tuées par la police; où énormément de personnes trans se retrouvent en situation d’itinérance; et la liste pourrait s’allonger à l’infini. Devant la facilité discursive de transformer la figure hégémonique en victime du politically correct, la pertinence d’utiliser les sciences sociales comme outil de lutte se confirme.
RÉFÉRENCES
Alexander, M. J., et Tapalde Mohanty, C. (2010). Cartographies of Knowledge and Power: Transnational Feminism as Radical Praxis. Dans A. Lock Swarr et R. Nagar (dir)., Critical Transnational Feminist Praxis. Suny Press.
Bent, F. (2001). Making Social Science Matter. Cambridge: Cambridge University Press.
Falquet, J. (2006). Déclaration du Combahee River Collective, Les cahiers du CEDREF, (14)1-10.
Hill Collins, P. (2016). La pensée féministe noire: savoir, conscience et politique de l’empowerment. Les Éditions du Remue-ménage.
Juteau, D. (1999). L’ethnicité et ses frontières. Presses de l’Université de Montréal.
Salée, D. (2010). Penser l’aménagement de la diversité ethnoculturelle au Québec: mythes, limites et possibles de l’interculturalisme. Politique et Sociétés, 29, 1 (145-180).
Weber,
M. (1965). Essais sur la théorie de la science. Librairie Plon.
[1] Les cahiers du CEDREF (Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes) a publié la traduction de la déclaration du Combahee River Collective en 2006 produite par Jules Falquet. Le texte original a été rédigé en 1977 et publié pour la première fois en 1979 dans un recueil dirigé par Zillah Eisenstein.
[2] Cette grille d’analyse des rapports de pouvoir a été proposée par Sirma Bilge et Patricia Hill Collins en 2016 dans l’ouvrage « Intersectionality ». À noter que le domaine psychique du pouvoir est un ajout personnel de la chercheuse et sociologue Sirma Bilge à la grille et ne figure pas dans l’ouvrage.
Articles sur les mêmes sujets