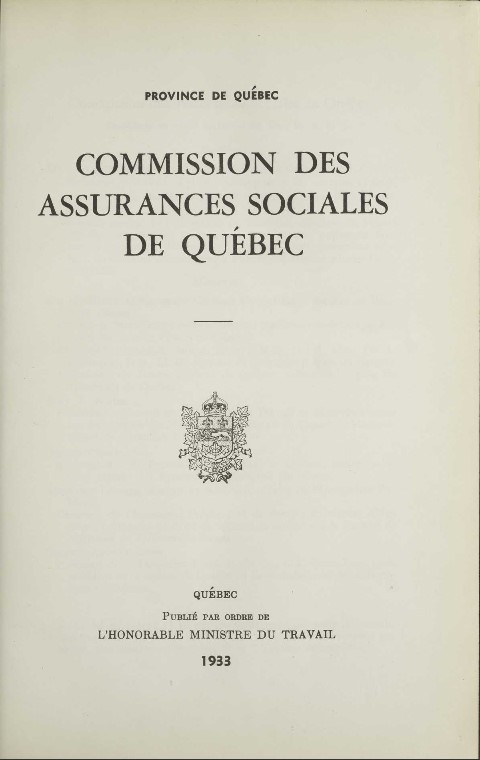Entrevue avec David Niget
Par Cory Verbauwhede, doctorant en histoire à l’UQÀM
Version PDF

Le colloque « Question sociale et citoyenneté » se tiendra à l’UQÀM du 31 août au 2 septembre 2016. Plus de détails ici.
David Niget est maître de conférences en histoire à l’Université d’Angers, affilié au Centre de recherches historiques de l’Ouest (CNRS, France) et au Centre d’histoire des régulations sociales (UQAM, Québec). Reconnu pour ses travaux sur la rééducation des mineurs au Québec, en France et en Belgique, il place l’agentivité historique de la jeunesse au cœur de ses recherches. Sa réflexion actuelle sur l’observation médico-pédagogique, qui se développe en France, en Belgique et au Québec entre 1945 et 1970, vise à mettre en lumière l’ascension des experts dans la définition et le traitement de la délinquance juvénile, révélant ainsi le double mouvement instauré par ces nouvelles approches : incitation à l’autonomisation des jeunes en tant que citoyens en devenir, d’une part, et subjectivation croissante de ces mêmes jeunes, ciblés par des thérapies nouvelles invasives de leur intimité psychique, de l’autre. Il ne s’agit ainsi pas uniquement de dévoiler les processus de prise en charge mais aussi d’examiner la réaction des jeunes à l’endroit de ceux-ci[1].
Cory Verbauwhede : Parlez-nous de votre parcours.
David Niget : Ma recherche doctorale, sous la direction de Jean-Marie Fecteau, fondateur du Centre d’histoire des régulations sociales dont je suis un chercheur affilié, a porté sur la mise en place du Tribunal pour enfants en France et au Québec. J’ai voulu apporter une perspective non-institutionnelle et non-juridique à une histoire qui demeure très classique dans son ensemble, en centrant mon travail sur les jeunes et leur « expérience sociale ». Je me suis d’abord intéressé à la première période d’existence du tribunal, de sa fondation en 1912 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puis un poste de recherche postdoctorale à l’Université catholique de Louvain (UCL) m’a permis d’étendre la période étudiée jusqu’aux années 1950-1960, en me penchant sur le cas, passionnant, de la Belgique.
Cory Verbauwhede : Comment distingueriez-vous votre approche d’une historiographie plus « classique »?
David Niget : Lorsque j’étais aux études, l’histoire sociale se concentrait de plus en plus sur les acteurs, en suivant les propositions épistémologiques de Boltanski par exemple. Dans mon domaine, cela impliquait de s’intéresser au « sujet juvénile » qui fait face aux systèmes de normes instaurés par les institutions bien plus qu’aux institutions elles-mêmes. Je suis donc un chercheur de mon époque.
Cory Verbauwhede : Pour le colloque Question sociale et citoyenneté, vous proposez une communication sur le point de vue des jeunes face à l’intervention des experts en matière de « psychisme » dans le dispositif pénal des jeunes en Belgique et en France. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet, et surtout, quelles sont vos sources, puisqu’il s’agit d’une histoire qu’on devine peu documentée?
David Niget : Les choix de thèmes de recherche précis découlent souvent d’heureux hasards qui sont tributaires de découvertes faites lors de travaux dans les archives, de rencontres fortuites, d’événements imprévus, etc. C’est un aspect du métier d’historien qui me plaît beaucoup, et qui devrait, me semble-t-il, faire partie de notre posture épistémologique de manière explicite. Dans mon cas, c’est une belle petite histoire. Par l’entremise de Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, une experte sur la question des droits des enfants, j’ai su que les Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) de Saint-Servais en Belgique voulaient se débarrasser de leurs archives. Ils avaient en effet déjà commencé à détruire des dossiers de jeunes filles qui y avaient été en « observation » dans les années 1920-1940. Cette période d’observation était une sorte d’enquête par l’institution auprès d’adolescentes qu’elle suspectait de délinquance. L’enquête était menée avant qu’un jugement officiel n’eût été prononcé à l’égard de ces personnes. Certaines sortaient de l’institution sans avoir été jugées coupables de quoi que ce soit. Pour d’autres, plus nombreuses, c’était le début d’une longue carrière institutionnelle, d’autant plus longue que l’on estimait que les « mauvaises filles » étaient plus difficilement « réinsérables »… Nous sommes donc dans le domaine de l’« infra-pénal », et c’est en partie pour cette raison que les IPPJ ne trouvaient pas preneur pour leurs vieux dossiers, que les Archives de l’État de Belgique considéraient comme « mineurs » et pour lesquels elles disaient ne pas avoir de place.
Cory Verbauwhede : On allait donc d’une certaine manière effacer leur(s) histoire(s)?
David Niget : Ce refus, qui mérite effectivement qu’on s’y attarde — surtout dans le contexte d’une réflexion sur la citoyenneté — trahit le dédain, voire la pudeur ou la gêne sociale qu’on ressent par rapport à ces jeunes filles « aliénées », « délinquantes » et « criminelles ». Peut-être y avait-il aussi là une part de honte par rapport à des pratiques qu’on considérerait aujourd’hui comme abusives. Toujours est-il que — de façon certes peu orthodoxe — nous sommes allés chercher les archives qui n’étaient pas encore détruites, avec des collègues du Centre d’histoire du droit et de la justice de l’UCL. Nous les avons rapportées à mon bureau à l’université, où pendant les deux ans que je les ai gardées, on ne pouvait y faire entrer quoi que ce soit de plus. De mon point de vue, c’était bien pratique, mais les Archives de l’État à Namur se sont finalement intéressées à ces dossiers et ont réclamé leur retour immédiat, non sans un certain ton accusateur, même si nous leur avons signalé que sans nous ces archives auraient été détruites. Depuis, ce fonds a été remarquablement mis en valeur, inventorié, et j’ai pu travailler avec Julie Godinas, archiviste, à la rédaction d’un guide à destination des chercheurs sur les usages possibles de ces documents. Comme quoi la ténacité paye parfois…
Cory Verbauwhede : Que ce genre de choses se soit passé avant la mise en place de l’État et des moyens d’archivage modernes peut à la limite se comprendre, mais au XXIe siècle, en Belgique, cela me paraît inacceptable?
David Niget : Outre le fait qu’on donne en général peu d’importance aux archives judiciaires, il s’agit d’un bel exemple des angles morts de la recherche documentaire, qui est largement dépendante des politiques d’archivage, des biais des archivistes, et, plus largement, d’une politique mémorielle discriminatoire. On a, dans ce cas, la confirmation que les « filles incorrigibles » sont des citoyennes de seconde zone, dont il n’y a pas lieu de garder une trace. Symboliquement, on leur dit qu’elles n’ont même pas le droit à la mémoire, ni même droit à l’histoire. Or la mémoire et l’histoire sont des attributs fondamentaux de la citoyenneté. Cela rejoint un projet d’enquête orale que je compte mener auprès d’anciennes détenues afin de comprendre quel impact ce passage en institution a eu dans leurs vies. Je cherche à comprendre s’il s’agissait plutôt d’une parenthèse dans leurs parcours ou alors si cela a participé de la construction psychologique de leurs personnalités, voire même de la formation de leur identité politique. Rébellion ou soumission, ces expériences de la contrainte laissent des traces sur les trajectoires individuelles et sur les représentations que l’on se fait des normes sociales. Plus qu’une démarche patrimoniale, il s’agit d’un projet politique, puisqu’il y a derrière tout cela des revendications de reconnaissance qui sont encore bien actuelles. Nombreuses et nombreux sont encore les ancien.ne.s détenu.e.s qui n’ont même jamais révélé à leurs proches le fait d’être passés par de telles institutions.
Cory Verbauwhede : Dans votre proposition de communication, vous évoquez aussi la congrégation du Bon-Pasteur.
David Niget : Oui — j’ai là aussi eu de la chance. En effet, cette congrégation, dont la maison mère se situe à Angers, où j’ai été élu à un poste d’enseignement en 2013, était une sorte de multinationale de l’enfermement des jeunes filles. Que ce soit à Montréal, aux États-Unis, en Australie ou en France, elle en avait quasiment le monopole. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la congrégation du Bon-Pasteur représente 350 monastères, où travaillent plus de 10.000 religieuses qui encadrent 52.000 « pénitentes », dans près de 40 pays. Or, elle a fini par accepter d’ouvrir ses archives en 2014. Officiellement, c’était pour pouvoir faire sa propre histoire, mais c’était aussi une réponse, d’une part, à une pression soutenue de la part d’anciennes détenues et, de l’autre, à une attente sociale accrue de reconnaissance des souffrances passées et de clarification historique des zones sombres de notre histoire. Dans le cas du Bon-Pasteur, les anciennes se sont bien organisées et ont mis sur pied un blogue, donné des conférences, etc. Elles sont notamment actives dans les réseaux féministes de la gauche radicale. Au-delà de demandes possibles de dédommagement — qui contrairement au Québec seraient ici plutôt vues comme affaiblissant la cause en y ajoutant un facteur d’intéressement — elles disent vouloir échanger avec la congrégation du Bon-Pasteur et exigent des excuses de sa part et de la part de l’État. En outre, la plupart affirment avec force ne jamais avoir commis de véritable faute justifiant le traitement qu’elles ont subi. Elles se disent, avec raison me semble-t-il, victimes d’un ordre moral violent à l’encontre des filles des classes populaires.
Cory Verbauwhede : Au fond, vous vous intéressez aux actes de rébellion de ces jeunes, tant dans le passé que dans le présent?
David Niget : Ce qui m’intéresse, c’est la subversion des normes imposées d’en haut par diverses stratégies de résistance. L’intervention d’institutions comme les IPPJ et le Bon-Pasteur se fondait sur un paradoxe que les filles ont su exploiter contre ces institutions. Ainsi, au nom des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance, l’État se permettait d’enfreindre les règles qu’il avait lui-même instaurées et qui exigeaient qu’aucune punition ne soit infligée sans infraction à une norme connue à l’avance. La nouvelle rationalité, que j’appellerais « médico-sociale » et qui consiste à prévoir les risques sociaux en les anticipant, vient en contradiction directe avec la rationalité des Lumières qui appelait à neutraliser le pouvoir arbitraire des moralistes en jugeant des faits et non des individus. Or, dans les cas d’enfermement de jeunes filles, on les privait de leur liberté avant même l’arrivée d’une quelconque infraction, au nom de la prévention des risques sociaux. Même si la justification de la mesure d’enfermement était le plus souvent « protectionnelle » plutôt que pénale, le caractère punitif de cette surveillance très contraignante et invasive n’échappait à personne. Plusieurs filles ont détecté ce manque de légitimité de la part des autorités et ont tenté de l’utiliser contre elles, parfois de façon très créative. Je pense par exemple à une fille qui s’est emparée du fait qu’on la disait « fragile » pour exiger qu’on la laisse rentrer chez elle (ou sinon il y aurait un drame), ou à une autre, qui argumentait qu’elle avait d’autant plus droit d’être respectée (et donc qu’on lui accorde plus de liberté) qu’elle était jugée « déficiente ». L’hypersexualisation des filles est également un bon exemple : là où les expertises psychiques les stigmatisaient, certaines jeunes filles utilisaient cette assignation de manière subversive, subversion d’autant plus explosive qu’elle était jetée aux visages de chastes religieuses! Ainsi, de manière paradoxale, les sciences du psychisme « assujettissent » les jeunes, mais contribuent également à construire un sujet conscient de son individualité, et ultimement, de ses droits.
Cory Verbauwhede : Quel lien faites-vous entre cette résistance et le thème de la citoyenneté?
David Niget : Comprendre les institutions de gestion des masses juvéniles du point de vue de la jeunesse populaire qui y était assujettie, c’est aller au cœur des nouvelles pratiques de régulation sociale qui se développent avec l’apparition du sujet de droits et le mouvement pour la mise en place de chartes de droits universels à destination de l’enfance depuis les années 1920 jusqu’aux années 1980. La citoyenneté représente en effet bien plus que de simples énoncés abstraits et individualistes comme les droits de la personne et le droit de vote : avant toute autre chose, c’est une pratique très concrète, issue des revendications de souveraineté collective portées par les grands mouvements populaires. Or, on a tendance à situer les droits des enfants dans la déclinaison des droits individuels énoncés par le libéralisme, qui ne deviennent finalement que des instruments de normalisation et de disciplinarisation d’autant plus pernicieux qu’ils promettent de façon fallacieuse l’émancipation de celles mêmes qui sont contraintes en leur nom. L’étude de ces réalités cachées nous mène à vouloir réhabiliter les dimensions collective et pratique de la citoyenneté, souvent présentées comme « archaïques » depuis les supposés échecs historiques des projets socialistes au XXe siècle. Pourtant, cette dimension collective de la citoyenneté est fondamentale, elle renvoie au principe d’égalité qu’elle recèle. Comme le dit bien l’anthropologue Catherine Neveu, la citoyenneté devrait être la « vérification permanente de l’égalité ».
Cory Verbauwhede : Les chartes de droits universels existent au moins depuis les Lumières. Comment expliquez-vous l’ascendance de ces questions au début du XXe siècle?
David Niget : C’est assurément la « question sociale » qui les a poussées sur l’avant-scène. La fondation du Tribunal pour enfants en 1912 était en effet un tour de force politique. Ses concepteurs prétendaient pouvoir régler les problèmes de la pauvreté et de la délinquance du début du siècle en s’y attaquant à leur « source » ou à leurs « racines », c’est-à-dire dès l’enfance. La gestion des risques sociaux par la justice pénale et la médicalisation permettait aux autorités de s’attaquer à ces problèmes sur le mode individuel, sans octroyer de droits aux classes populaires, dites « dangereuses ». Cette technique s’oppose à une gestion du risque plus collective, les assurances sociales par exemple, qui en étaient encore à leurs balbutiements au début du siècle. Elle crée beaucoup de ressentiment et ce que l’on observe dans les années d’après-guerre, en autant que les archives nous le permettent, c’est une véritable révolte des jeunes contre cette société d’adultes qui voudrait à tout prix les contrôler.
Cory Verbauwhede : Y a-t-il un lien avec 1968?
David Niget : Oui! Mais pas celui que l’on croit. En effet, les événements de mai 1968 ne sont pas le début de la prise de parole des jeunes, bien au contraire. Ils marquent en fait l’aboutissement et la généralisation de plusieurs décennies de résistances de la part de jeunes issus de milieux populaires. Les jeunes étudiants, bourgeois pour beaucoup, ont en effet été les derniers à se joindre à une révolte qui a pris de l’ampleur dès les années 1940 et 1950. Malgré l’absence relative d’archives pour les raisons déjà évoquées, les exemples sont nombreux, et plus près de chez vous je pense notamment aux révoltes chez les sœurs du Bon-Pasteur par des jeunes qui étaient détenues au nord de l’Île de Montréal au milieu des années 1940.
Cory Verbauwhede : Quelles lectures conseilleriez-vous pour aller plus loin?
David Niget : Il y a bien sûr l’ouvrage collectif Pour une histoire du risque que j’ai dirigé avec Martin Petitclerc, qui revient notamment sur les différents modes de gestion des risques sociaux, mais au-delà de cela, la thèse de Tamara Myers sur l’intersectionnalité des discriminations de classe et de genre me paraît essentielle afin de décoder les combinaisons complexes et contradictoires des rapports de force sociaux. Parmi les filles enfermées, il y avait par exemple des cas où les jeunes avaient mis en danger la respectabilité de leur père, et le facteur expliquant leur enfermement découle plutôt dans ces cas du genre que de la classe sociale. Mary Douglas est une incontournable sur la question des liens entre la culture et la perception des risques, notamment autour du corps des femmes, et Michel Foucault reste le point de départ pour penser la gouvernementalité des masses, même si c’est Mitchell Dean qui a poussé cette théorie la plus loin. Contrairement à Foucault, Dean n’est pas optimiste quant aux perspectives d’émancipation ouvertes par la découverte du fait que le libéralisme fonctionne en partie à travers le sujet lui-même, qui aurait donc un certain pouvoir sur les normes qu’il choisit de s’imposer. Sur ce point, on pourra s’inspirer des révoltes des jeunes filles enfermées au milieu du XXe siècle : il y a de belles histoires, mais il faut faire attention de ne pas verser dans l’héroïsation, qui serait d’ailleurs une autre forme d’assignation faite aux « mauvaises filles ».
[1] Cette entrevue a été publiée, à l’origine, sur le blogue Question sociale et citoyenneté. C’est avec l’accord des responsables que ce texte est ici reproduit. Vous trouverez d’ailleurs d’autres entrevues et contributions de ce blogue sur l’espace qui leur est réservé sur notre site.
Articles sur les mêmes sujets