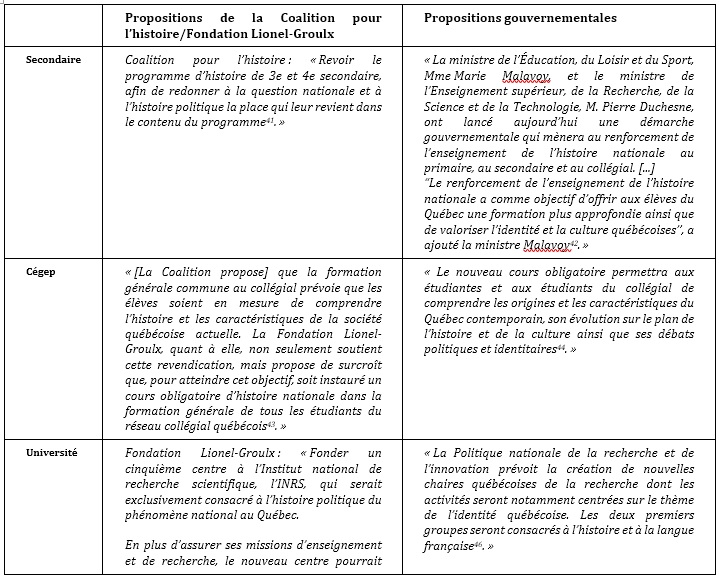La « Grande noirceur » catholique et duplessiste au Québec : entre mémoire et histoire.Note critique sur l’ouvrage L’Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis d’Alexandre Dumas
26 min
Par Jean-Philippe Bernard, étudiant au doctorat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
L’Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis est le second ouvrage publié par l’historien Alexandre Dumas. Tiré de sa thèse de doctorat soutenue en 2016 à l’Université McGill, il paraît dans la prestigieuse série des Études d’histoire du Québec (Studies on the history of Quebec) chez McGill-Queen’s University Press. Soulignons, par ailleurs, que sa publication, en offrant de nouvelles perspectives sur les relations entre la religion et la partisanerie politique dans l’histoire du Québec, s’insère à merveille dans les houleux débats entourant la loi 21 et la question de la laïcité de l’État.
Le titre de l’ouvrage est à cet effet fort bien choisi : ce sont bien les rapports de l’Église à « la » politique dont on parle, et non des rapports de l’Église à l’État ou «au» politique, pris plus largement. L’Église et la politique québécoise explore donc les liens qu’entretiennent l’épiscopat et le clergé avec les députés, les candidats électoraux, les partis politiques, etc., des libéraux de Taschereau aux unionistes de Duplessis. La présence, pourtant importante, des institutions religieuses au sein des différents organes de l’État québécois (santé et services sociaux, éducation, colonisation, agriculture, etc.), de même que leur influence sur l’orientation des politiques, est un aspect qui est peu abordé par l’auteur[1].
Cela étant dit, on s’abstiendra d’insister sur les absences de l’ouvrage pour s’intéresser à ce qu’il contient. À cette fin, plutôt qu’un résumé chapitre par chapitre, j’ai privilégié une recension qui présente et analyse trois des nombreuses thèses soutenues tout au long des dix chapitres du livre. Deux d’entre elles concernent l’Église et ses représentations au sein d’une certaine mémoire collective, alors que la troisième s’intéresse à Maurice Duplessis et à ses relations avec l’institution religieuse.
La deuxième partie de cette recension prend la forme du commentaire et explore la confusion qu’alimente Dumas, tout au long de l’ouvrage, entre mémoire et histoire, notamment en raison des critiques qu’il adresse à l’historiographie en l’accusant de ne pas avoir su s’émanciper du portrait monolithique dressé par les architectes de la Révolution tranquille. Enfin, je souhaite réfléchir à certains « dangers » auxquels nous expose un tel exercice de «révision» de figures historiques du conservatisme social comme le furent Maurice Duplessis et certains évêques de la province.
L’Église et la politique québécoise résumé en trois thèses
1 — Nuancer la participation active de l’Église dans la politique québécoise
La première question concerne l’image plus ou moins fondée d’une participation déterminante et récurrente de l’Église dans le domaine de la politique au Québec. Dans son ouvrage, Dumas démontre qu’il importe de nuancer l’idée voulant que l’Église intervienne régulièrement et, surtout, de façon monolithique, auprès des partis politiques de la période qui l’intéresse. Plutôt, cette participation dans la joute électorale connaitrait son apogée à la fin du XIXe siècle alors que l’idéologie ultramontaine produit un «climat d’hostilité» envers le gouvernement libéral. La victoire de Wilfrid Laurier en 1896, soutient Dumas, «semble être la défaite de l’Église» (p. 20) et met fin à la volonté d’assujettir le politique au religieux. Seuls quelques agents plus radicaux ou des contextes précis vont par la suite favoriser la prise de positions partisanes par l’Église. Si quelques prêtres récalcitrants — qui forment d’ailleurs un «élément marginal», souligne Dumas — s’engagent dans une joute de mots avec les élus, ils ne représentent pas la ligne directrice de l’Église qui s’oppose plutôt à une intervention dans ce domaine. Ce «retrait» de l’Église se maintiendrait jusqu’aux élections de 1935 (chapitre 4), alors que le parti libéral fait les frais d’une forte prise de position de la part de membres du clergé qui défendent l’alliance Paul Gouin-Maurice Duplessis et sa plate-forme électorale[2]. Si l’on se fie à l’auteur, cet épisode, qui n’est ni représentatif de la place que prend l’Église dans l’arène politique, ni des relations tendues qu’entretient le clergé à l’égard du parti libéral de Taschereau, aurait pourtant retenu une part injustifiée de l’attention des historien.ne.s. Devant les accusations de «conspiration politico-religieuse» (p. 77) portées par Le Soleil et Le Canada, les évêques entreprennent alors une campagne de sensibilisation auprès du clergé de la province afin de rappeler l’importance de maintenir une distance entre l’Église et la politique. Seules des «dénonciations morales» pourront dès lors justifier des interventions publiques.
La démonstration à laquelle nous convie Dumas est convaincante. L’historiographie se serait rendue coupable d’une exagération vis-à-vis de ce mariage Église-État ou, plus précisément, du bénéfice qu’en auraient tiré Maurice Duplessis et l’Union nationale. Or, si l’ouvrage corrige l’image d’une Église ultramontaine dont le pouvoir s’exprime jusque dans l’orientation des politiques publiques et dans les urnes, il n’est toutefois pas en mesure de rejeter entièrement le portrait d’une proximité entre les deux institutions. Des relations sont bien entretenues et se maintiennent durant la période. L’auteur souligne lui-même qu’«à une époque où l’Église catholique est au Québec l’institution qui contrôle la santé, l’éducation et la charité publique tout en étant le principal guide moral de la société», il est inévitable que certains accrochages et débats se produisent avec le parti au pouvoir (p. 47). On pourrait ajouter qu’il est tout aussi inévitable que certaines interventions et alliances aient lieu avec ceux qui lui sont le plus favorables. L’Église de cette période n’est, finalement, jamais très loin du pouvoir politique.
2 — L’Union nationale de Maurice Duplessis : le parti de l’Église?
Justement, qu’en est-il du pouvoir et de la relation qu’entretient l’institution religieuse avec les différents partis politiques durant cette période? Une part importante de l’ouvrage est consacrée à cette seconde question, orientée dans l’objectif de déconstruire l’idée répandue voulant que ce soit l’Union nationale de Maurice Duplessis qui aurait le plus bénéficié de cette relation étroite et harmonieuse avec le clergé de la province. Non pas dans «l’intention de redorer l’image du “cheuf”» (p. 9), insiste d’emblée l’auteur, à l’intention de quiconque voudrait l’attaquer de se livrer à un exercice de réhabilitation de Duplessis. Mais plutôt, pour contester le portrait laissé par ceux et celles qui se sont retrouvés à profiter de la fin du régime duplessiste et auraient ainsi tiré certains avantages à dresser une image exagérément sombre de la période dont ils et elles souhaitaient s’émanciper (p. 5).
Deux stratégies sont utilisées par l’auteur pour déboulonner ce «mythe». D’abord, représenter les relations étroites qu’entretient l’Église avec les autres partis qui convoitent ou tiennent les rênes du gouvernement. Ensuite, nuancer la bonne entente entre Maurice Duplessis et l’épiscopat afin d’insister sur les exagérations de l’historiographie. Dumas a ainsi, tout au long de l’ouvrage, recours à l’une ou l’autre de ces stratégies, insistant longuement — parfois trop — sur les détails contenus dans la correspondance ou dans des prises de position publiques des membres du clergé qui permettent d’appuyer son argumentaire.
Prenons un second exemple. Maurice Duplessis, outre quelques prêtres convaincus, n’aurait jamais été le «champion du clergé» tel qu’on l’a décrit. L’alliance entre l’Action libérale nationale de Paul Gouin et le Parti conservateur de Maurice Duplessis lors des élections de 1935 aurait ainsi obtenu la faveur du clergé, non pas par enthousiasme pour Duplessis, mais bien en raison de la plate-forme fortement inspirée de l’encyclique Quadragesimo Anno qu’adopta l’ALN. Ce sont d’ailleurs certains candidats (Philippe Hamel, Ernest Grégoire, Paul Gouin) qui tiennent les rangs de vedettes auprès de l’Église, alors que Duplessis ne «paraît pas éveiller de sympathie particulière parmi les prêtres» (p. 51). La mobilisation de l’Église contre le parti libéral durant ces élections aurait d’ailleurs été «fortement exagérée», insiste Dumas.
Arrêtons-nous brièvement sur quelques exemples. Dumas aborde notamment l’accent mis par l’historiographie sur les tensions, entre l’Église et le parti libéral de Louis-Alexandre Taschereau, qu’auraient créé les lois de l’assistance publique (1921) et des écoles juives (1930). À l’utilisation de termes comme «tensions» ou «conflits», l’auteur préfère parler de «certains froids» (p. 21) pour qualifier le climat entre les deux institutions. Malgré certains accrochages, Dumas y voit plutôt une cohabitation et une relation fort positives. L’adoption d’une version modifiée de la loi des écoles juives qui, devant la montée de boucliers que produit sa première mouture, donne finalement «pleine satisfaction à l’épiscopat» (p. 26) et constitue un exemple des efforts déployés par Taschereau pour maintenir des relations harmonieuses avec l’Église. Pourquoi, alors, l’historiographie s’est-elle acharnée sur le déroulement de cet épisode, plutôt que sur son dénouement? Devant cette révision historiographique, les unionistes n’apparaissent plus comme les seuls à alimenter la bonne entente avec l’Église. Il s’agit d’une composante de l’échiquier politique avec laquelle tous les partis doivent conjuguer.
Le même argument est toutefois plus difficile à défendre lorsqu’il est question de la campagne de 1936, de laquelle Duplessis ressort comme le seul opposant en mesure de destituer les libéraux de Godbout. Ce n’est pourtant pas le chef que l’on adore, précise encore une fois Dumas, mais bien ce qu’il représente. La ferveur qu’il déploie à dénoncer la corruption des libéraux lors des enquêtes du Comité des comptes publics (amorcées en 1936), lui assure l’image du candidat dont la droiture morale pourra mener la province vers des jours meilleurs. Sa victoire lui vaut d’ailleurs des mots de félicitations de la part du Cardinal Villeneuve, pratique courante durant la période étudiée. Ces mots, l’auteur les reproduit en insistant sur la nécessité de les nuancer. «Votre passé et vos nettes affirmations pendant la campagne électorale nous sont une garantie du caractère chrétien que vous voudrez garder au gouvernement de notre Province», écrit le Cardinal, «et du respect que vous portez à l’Église» (p. 106). Villeneuve, insiste Dumas, parle bien de «garder» et non d’«instaurer» ou de «restaurer» ce caractère chrétien.
Dès la fin de ce premier mandat, le clergé, notamment sa branche nationaliste, est fortement déçu de Duplessis. Ceux-ci choisissent alors de se tourner vers l’Action libérale nationale et le Parti national pour trouver réponse à leurs aspirations, ce qui permet à l’auteur d’en conclure que «dans les années 1930, les aspirations des prêtres sont moins religieuses que nationales.» (p. 146) La politique de cette fin de décennie tourmentée, et les profondes remises en question du modèle libéral qu’elle entraîne se réduiraient donc, soit à la question religieuse, soit à la question nationale. On repassera sur la profondeur de l’argument et de la démonstration qui l’accompagne. Comme le souligne l’auteur lui-même, on relève à plusieurs reprises, tout au long de la décennie, des membres de l’Église qui se trouvent au cœur de la critique d’un modèle social et politique qui apparait comme grandement dépassé. Le libéralisme de Duplessis et son incapacité, malgré ses nombreuses promesses électorales, à relever la situation économique et sociale de la province offrent, à mon avis, une explication beaucoup plus convaincante du choix de certains religieux de tourner le dos à l’Union nationale.
Comme dernier exemple de cette exagération commise vis-à-vis du régime duplessiste, Dumas insiste dans le chapitre 8 («Les libéraux de retour au pouvoir»), sur les relations harmonieuses entre l’Église et l’État qui caractérisent les années libérales (1939-1944) succédant au premier mandat de l’Union nationale. «Ne pourrions-nous pas», conclut-il, «décrire le cardinal Villeneuve comme un allié de Godbout aussi facilement que certains historiens l’ont décrit comme un allié de Duplessis?» (p. 162)
Enfin, si les deux derniers chapitres («“Les évêques mangent dans ma main”» et «Les mœurs électorales») démontrent bien qu’il est exagéré de penser que les évêques furent tous soumis à l’autorité de Duplessis, l’étude détaillée que fait l’auteur des relations entre l’Union nationale et l’Église ne laisse aucun doute : c’est bien le «Cheuf» qui dicte les règles du jeu à l’épiscopat. La machine du parti est bien huilée. Chaque faveur, chaque subvention — dont le chèque est signé personnellement par Duplessis — doit s’accompagner de remerciements publics sans quoi l’on risque de perdre l’assistance financière de l’État. En somme, bien plus qu’un catholique irréprochable, Duplessis est d’abord mû par une soif de pouvoir dont une alliance avec l’Église — même lorsqu’il s’agissait d’une mise en scène — apparait nécessaire. On notera que c’est cette démonstration de Dumas qui m’apparait comme la mieux construite et la plus convaincante de l’ouvrage.
3 — Réfléchir au conservatisme de l’Église catholique au Québec
Enfin, L’Église et la politique québécoise contient un troisième objectif, annoncé dès l’introduction : celui de nuancer le portrait d’une Église catholique conservatrice — pour ne pas dire réactionnaire — qui aurait été fortement exagéré par l’historiographie. «De façon générale», note Dumas en introduction, «les Québécois ont volontiers associé tout ce qui leur déplaît dans leur histoire à l’influence de l’Église catholique.» (p. 4) Non seulement, comme nous l’avons noté, l’Église n’aurait pas été aussi influente que l’aurait retenu l’historiographie, mais on aurait également exagéré l’anti-modernité de ses positions. Lorsqu’une question jugée «sensible» ou ayant provoqué des prises de position de la part de l’Église est abordée, Dumas s’y arrête en présentant de nombreux extraits de lettres de curés ou d’évêques qui montrent bien le spectre des opinions qui traverse l’institution. Ainsi, Mgr Charbonneau, évêque de Montréal, n’aurait pas flirté avec les idées d’Adrien Arcand comme l’aurait affirmé Robert Rumilly qui, fidèle à ses habitudes, n’aurait pas référencé cette affirmation. «Les historiens à sa suite l’ont probablement cité», soutient Dumas, «parce que l’idée que l’Église catholique ait nourri l’antisémitisme de la société canadienne-française est cohérente avec l’idée qu’on s’en fait.» (p. 27) Cette dernière n’est pas non plus si engagée — avant 1936 — dans la lutte contre le communisme, ni uniformément opposée à l’introduction de l’État au sein de domaines traditionnellement assumés par l’Église (éducation, santé, services sociaux, etc.). L’adhésion de l’Église à la coalition de l’Action libérale nationale de Paul Gouin et du parti conservateur de Duplessis en 1935 ne s’explique-t-elle pas, d’ailleurs, par la nature progressiste de son programme?
Si certains évêques ou prêtres plus conservateurs ont attiré l’attention de l’historiographie, les opinions qui traversent l’Église sont pourtant fort diversifiées. «Chaque prêtre» soutient Dumas, «a sa propre idée des problèmes de l’heure et de la meilleure façon de les régler.» (p. 125) Cette diversité est d’ailleurs très bien démontrée dans l’ouvrage. Les opinions se multiplient ainsi sur des questions comme la conscription, le nationalisme, le syndicalisme, etc. Seul le droit de vote des femmes semble obtenir l’unanimité. Mais peut-on blâmer l’Église, précise Dumas? Bien qu’elle soit parmi les dernières entités politiques occidentales à adopter cette mesure, la province n’est pas la seule à la repousser et les raisons pour lesquelles le gouvernement de Godbout y adhère sont loin d’être progressistes. Elles sont avant tout partisanes, les femmes étant potentiellement plus attachées au parti qui leur aurait «octroyé» (ce sont les mots de l’auteur) le droit de vote. Inutile, alors, d’attribuer le retard québécois à une quelconque «misogynie, au conservatisme ou à la religion» (p. 150). Dumas sort d’ailleurs du cadre de l’analyse historique lorsqu’il soutient que, si «l’opposition de l’Église catholique québécoise au suffrage féminin est réelle et incontestable, elle n’a pas été outrancière.» (p. 156) «Outrancière» Voilà un qualificatif qui semble relever de l’opinion de l’auteur et dont il aurait pu nous dispenser.
Entre histoire et mémoire : les «dangers» d’un révisionnisme de l’ère duplessiste
La Grande Noirceur : entre «imaginaire collectif» et historiographie
Parce qu’il traite de questions sensibles de la mémoire collective québécoise, l’ouvrage de Dumas a le potentiel d’attirer l’attention du public. Il fera donc inévitablement jaser tant il s’insère dans les débats entourant la laïcité de l’État et l’influence du religieux dans la sphère publique, tout en offrant de nouvelles perspectives à celles et ceux adhérant toujours au mythe mémoriel de la Grande noirceur et de la Révolution tranquille. Ce mythe qui, soutient Dumas, fut alimenté par les protagonistes des transformations qui s’opèrent dans les années 1960 et devait servir à assombrir la période précédente pour légitimer la trame narrative de la «révolution» qu’ils et elles mettaient en branle (p. 5).
N’empêche, j’insiste sur la caractéristique «mémorielle» de cette périodisation de l’histoire du Québec. Une série d’affirmations présentées en introduction et à certaines reprises dans le livre alimentent une confusion entre ce que Dumas nomme «l’imaginaire collectif» de cette période et son historiographie. Depuis les années 1990 — et même au-delà?! — de nombreuses analyses ont en effet questionné ce mythe d’une rupture entre l’avant et l’après-Lesage. Certes, le sujet de ces analyses ne fut pas toujours l’Union nationale ou Maurice Duplessis, mais elles auront été assez nombreuses pour que Ronald Rudin parle d’un courant «révisionniste» de l’histoire du Québec[3]. En privilégiant l’étude des structures socio-économiques qui ont affecté le Québec de la période 1930-1960, ces analyses auront dépassé l’idée de «spécificités» nationales — peut-être «trop» si l’on s’en tient à Rudin — dont le régime de Maurice Duplessis aurait jusqu’alors constitué la représentation la plus convaincante. Des regroupements plus récents de politologues, sociologues et historien.ne.s ont également produit des ouvrages collectifs explorant et nuançant plusieurs facettes du personnage, de ses idéologies en passant par ses stratégies communicationnelles, et, du même coup, de la période à laquelle on l’a associé[4]. D’autres ont bien montré que le passage de cette Grande noirceur vers la «modernité» québécoise pourrait davantage être qualifié de continuité que de rupture. Je pense entre autres aux travaux sur le rôle joué par l’Église et la pensée personnaliste dans les transformations qui s’opèrent au tournant des années 1960[5]. La Grande noirceur, autant que la Révolution tranquille, comme les deux opposés d’un spectre moderniste permettant de périodiser l’histoire du Québec, a bel et bien été abandonnée par l’historiographie. Pourquoi ne pas le reconnaître?
Ces études, Alexandre Dumas les connait. Elles se retrouvent d’ailleurs toutes dans la bibliographie du livre. S’il nous apparait tout à fait légitime d’insister sur l’originalité de ses travaux, le ton de la table rase qu’adopte Dumas laisse parfois planer une impression de sensationnalisme qui, à mon avis, pourra en faire sourciller plusieurs. L’Église et la politique québécoise permet certes de nuancer le portrait qui perdure dans la mémoire collective et offre de nouvelles sources pour réfléchir à cette période importante du XXe siècle québécois. On repassera toutefois sur la complète originalité dont l’auteur se réclame.
Échapper à la réhabilitation du conservatisme social
Il nous semble important d’insister, enfin, sur les dangers d’un tel exercice de «révision» de figures historiques du conservatisme social comme le furent Maurice Duplessis et certains évêques de la province. Ces travaux peuvent certes servir la discipline en nuançant des exagérations commises par l’historiographie. Toute lecture anhistorique du passé possède certainement ses lacunes. Ce révisionnisme laisse toutefois place à certains pièges, notamment celui de justifier, voire d’excuser, l’adoption de politiques conservatrices en insistant sur le contexte historique dans lequel elles furent soutenues et élaborées. En s’inscrivant dans l’«ère du temps», ces mesures deviendraient alors excusables, participant du même coup à réduire leurs conséquences importantes sur les transformations sociales, culturelles et économiques de la société québécoise.
Un ouvrage comme celui de Dumas peut avoir, malgré lui, une portée plus large que la simple révision du portrait peu nuancé du conservatisme de l’Église catholique ou de l’Union nationale de Maurice Duplessis. D’emblée, j’insiste sur le fait qu’il serait erroné de faire porter à l’auteur le poids de ce courant historiographique. Il se défend d’ailleurs, en introduction, de se livrer à un tel exercice que d’autres avant lui ont pourtant fait ouvertement[6]. Sa démonstration est loin de se limiter à l’homme politique et son parti. N’empêche, son travail nous rappelle l’importance d’insister sur les problèmes que peut poser une telle réhabilitation dans le contexte actuel de passivité vis-à-vis des discours haineux, xénophobes et populistes qui s’expriment au Québec et dans les sociétés occidentales. Se présente alors le double «piège» dans lequel est placé l’historien.ne face au présentisme. D’un côté, tenter de «défendre» des positions adoptées par l’État et l’Église en les insérant dans leur contexte historique ou, de l’autre, faire preuve de rectitude politique à l’égard des communautés marginalisées (personnes racisées, ouvrier.ère.s, femmes, Autochtones, etc.) qui ont fait les frais de ces politiques réactionnaires. Si l’objectif de l’histoire n’est pas de «juger» les acteurs et actrices du passé, il n’est pas davantage de sa responsabilité de justifier leurs actions, surtout lorsqu’elles ont mené à des aspects sombres de l’histoire du Québec. On doit certes expliquer ces décisions, mais sans toutefois les légitimer.
Le «mythe» de la Grande noirceur a contribué à masquer des faits importants qui permettent de comprendre les transformations qui s’opèrent au Québec pré-1960. Il a également contribué à la construction d’une prétendue «exception» du Québec de cette période par rapport au reste du Canada. Pour ces raisons, on peut très bien s’accorder avec la thèse soutenue par Dumas, à savoir que lorsqu’il est question de libéralisme économique ou de conservatisme social, Duplessis n’est pas une exception[7]. Si les mesures qu’il adopte pour lutter contre le communisme sont jugées sévères, elles ne sont pas étrangères à ce qui se fait ailleurs au Canada dans la première moitié des années 1930[8]. Duplessis n’est pas non plus le seul à s’opposer au droit de vote des femmes — même des organisations comme les Cercles des fermières s’y opposent, souligne Dumas — ou à être favorable à des lois punitives à l’égard de grévistes ou d’organisations syndicales. Ses idées et ses politiques, il les partage avec plusieurs hommes de son époque, soit.
Il n’y a donc pas que le «despote» Duplessis qui a participé à assombrir cette période de l’histoire du Québec. Mais qu’elles soient partagées ou non, exceptionnelles ou non, ses idées et ses politiques, appuyées par certains représentants de l’Église, auront permis de faire régner sur cette période de l’histoire du Québec un conservatisme qu’on ne peut ignorer. Un conservatisme qui s’exprimera à travers les discours et actions portées à l’endroit des ouvriers et ouvrières, des femmes, des personnes racisées et des minorités ethniques et religieuses. Il serait trop long ici de faire la liste des conflits, oppressions et tensions ethniques, religieuses ou sociales qu’auront alimentés ces hommes d’Église et d’État durant cette période de l’histoire du Québec. Malgré ses biais, il me semble que le « mythe » d’une Grande noirceur québécoise tient tout de même la route.
Duplessis, de même que certains évêques ne peuvent donc être tenus seuls responsables de toutes ces transgressions. Ils auront tout de même contribué à alimenter le conservatisme social de cette période de l’histoire du Québec, et ce, malgré certaines exagérations commises par les artisans du «mythe» de la Grande noirceur. À cet égard, on pourrait aller plus loin et proposer, comme certains l’ont fait avant moi[9], qu’il serait pertinent de prolonger la périodisation de cette Grande noirceur et ainsi s’accorder avec Dumas pour absoudre Duplessis d’une partie de ses responsabilités à l’égard des actes de violence et d’intolérance commis par l’État québécois. Après tout, les gouvernements de Gouin, Taschereau et des artisans de la Révolution tranquille ne peuvent être déchargés de toutes critiques quant aux gestes commis à l’endroit des femmes, des personnes racisées, des Autochtones, etc. C’est la société québécoise qui doit reconnaître certaines de ses inégalités, reproduites encore aujourd’hui, et qu’une personnification à travers quelques hommes politiques ne nous permettra pas de nous en disculper.
[1] Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait la lecture d’une première version de ce texte. Notamment, les annotations et commentaires pertinents des membres du comité éditorial d’Histoire engagée qui m’auront permis d’améliorer sa forme et son contenu. Je demeure, évidemment, le seul responsable des propos qui sont tenus dans ce texte, de même que les omissions ou erreurs que j’aurais pu commettre.
Des travaux comme ceux d’Amélie Bourbeau, par exemple, offrent de nombreuses pistes de réflexions qui m’apparaissent fort utiles pour explorer la question des relations Église-État. On en retrouve pourtant aucune trace dans la bibliographie. À mon avis, ses travaux auraient pu contribuer à renforcer certaines sections de l’ouvrage.
[2] Cette plate-forme, Yvan Lamonde la résume en 5 «C». Il s’agit de réformer le capitalisme afin de contenir la popularité du communisme, en adoptant certains fondements du corporatisme et du coopératisme, de même qu’en encourageant la colonisation comme solutions à la crise. Yvan Lamonde, La modernité au Québec. Tome I – La Crise de l’homme et de l’esprit, 1929-1939, Québec, Fides, 2011, p. 86.
[3] Ronald Rudin, «La quête d’une société normale : critique de la réinterprétation de l’histoire du Québec», Bulletin d’histoire politique, vol. 3, no 2, 1995, p. 9-42.
[4] C’est le cas de deux recueils produits suite à des colloques tenus sur Duplessis : Alain Gagnon et Michel Sarra-Bournet (éd.), Duplessis: entre la grande noirceur et la société libérale, Montréal (Québec), Éditions Québec Amérique, 1997, 396 p. et Xavier Gélinas et Lucia Ferretti (éd.), Duplessis: son milieu, son époque, Québec, Septentrion, 2010, 513 p.
[5] On pense, entre autres, aux travaux de E.-Martin Meunier et Jean-Philippe Warren, Sortir de la «grande noirceur»: l’horizon personnaliste de la Révolution tranquille, Sillery, Québec, Septentrion, 2002, 214 p. et ceux de Michael Gauvreau, notamment, The Catholic Origins of Quebec’s Quiet Revolution: 1931-1970, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2008, 522 p.
[6] Martin Lemay, À la défense de Maurice Duplessis, Montréal, Québec Amérique, 2016, 168 p.
[7] Gilles Bourque, «Duplessis, libéralisme et société libérale» dans Duplessis: entre la grande noirceur…, op. cit., p. 265-282.
[8] Andrée Lévesque, Scènes de la vie en rouge: l’époque de Jeanne Corbin, 1906-1944, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 1999, p. 65-79.
[9] À cet égard, plusieurs aspects de cette réflexion sont inspirés de deux textes, rédigés respectivement en 2009 et en 2017 et qui proposent une analyse beaucoup plus complète du nationalisme-conservateur traversant l’historiographie québécoise. Il s’agit de Martin Petitclerc, «Notre maître le passé?: Le projet critique de l’histoire sociale et l’émergence d’une nouvelle sensibilité historiographique», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, n° 1, 2009 et Brian Gettler, «Les autochtones et l’histoire du Québec Au-delà du négationnisme et du récit “nationaliste-conservateur”», Recherches amérindiennes au Québec, vol. XLVI, n° 1, 2016.
Articles sur les mêmes sujets