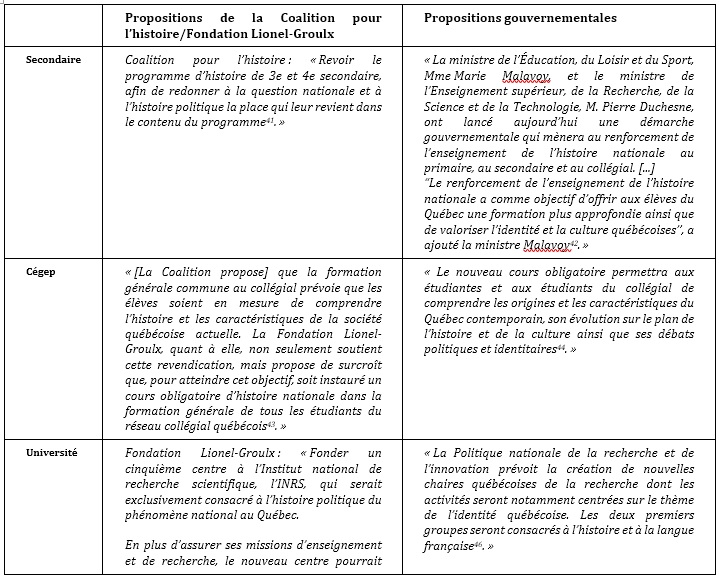L’histoire nationale négligée? Pour un recours aux sources
8 min
Par Alexandre Turgeon, Université Laval
Version PDF

Crédit : Alexis Gravel (Flickr).
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a beaucoup parlé d’histoire au Québec ces dernières semaines. Force est d’admettre qu’Éric Bédard et Myriam D’Arcy, les auteurs du rapport qui a mis le feu aux poudres, ont réussi leur coup. Tenants de l’« histoire nationale » et de l’« histoire sociale » semblent s’entredéchirer sur l’espace public, en particulier dans les pages papier – et numériques – du journal Le Devoir, alors que le Parti québécois vient de réclamer une commission parlementaire sur l’enseignement de l’histoire nationale et la formation des maîtres. Mais qu’en est-il, au juste, du rapport en lui-même, que l’on semble avoir oublié au fil de cette polémique? On le sait, les constats d’Éric Bédard et Myriam D’Arcy ont été fortement contestés par les uns, portés aux nues par les autres. Mais ces constats sont-ils seulement avérés, leurs données solides, appuyées?
Dans le cadre de ce débat qui a notamment fait rage dans les pages du Devoir, et qui a d’ailleurs rapidement dégénéré en un dialogue de sourds, je souhaite pour ma part revenir au rapport lui-même, m’intéresser à ses fondements, à son cadre d’analyse en m’arrêtant sur trois points. En d’autres mots, je souhaite y aller d’un « recours aux sources », pour reprendre le titre du dernier ouvrage d’Éric Bédard (Éric Bédard, Recours aux sources. Essais sur notre rapport au passé, Montréal, Boréal, 2011, 280 p.). Car ces données, dont on a fait grand cas dans les médias, d’où proviennent-elles, au fond?
Sur les mémoires et thèses produits en histoire du Québec depuis 1995
Comme d’autres l’ont mentionné, en particulier Donald Fyson et Denyse Baillargeon, le clivage disciplinaire proposé par les auteurs ne tient pas, les frontières entre histoire nationale et histoire sociale étant poreuses. Cela dit, acceptons leur cadre d’analyse a priori. Histoire nationale d’un côté, histoire sociale de l’autre. Partant de ces catégories, les auteurs se sont intéressés aux mémoires et aux thèses en histoire du Québec produits depuis 1995 dans les départements francophones. Ils ont recensé 575 mémoires et 141 thèses qu’ils ont classés sous ces deux catégories rien qu’en consultant les titres. C’est ainsi que 35 % des mémoires et 33 % des thèses auraient été faites en histoire nationale, contre 65 % des mémoires et 67 % des thèses en histoire sociale. Ce qui donne, dans les deux cas, un total de 100 % (p. 29).
Deux choses. Primo, je suis surpris que les auteurs aient été en mesure de catégoriser tous ces 716 ouvrages sans que le moindre cas critique, inclassable ne se présente. N’ont-ils pas rencontré le moindre mémoire ou thèse où il aurait été préférable de s’abstenir, le cas échéant? Secundo, un titre ne dit pas tout. Un titre devrait nous en apprendre sur le « qui », le « quoi », le « quand » et le « où ». Pour ce qui est du « comment » – soit la perspective, la méthode, etc. –, consulter les résumés aurait été bien plus fécond dans les circonstances.
Ce point est en fait essentiel : on ne peut classer un texte, quel qu’il soit, à la lumière du seul titre. Bien sûr, consulter les résumés est plus fastidieux que de se contenter des titres… Mais n’est-ce pas le lot de la recherche?
La situation des Départements d’histoire dans les universités québécoises
Le constat des auteurs est que l’histoire nationale est négligée dans l’enseignement et la recherche universitaires au Québec : le titre de l’étude est on ne peut plus explicite là-dessus. Ils reviennent ainsi sur l’offre de cours dans les départements d’histoire, où l’histoire nationale serait négligée au profit de l’histoire sociale. Mais cette offre, il ne faut pas l’oublier, dépend des professeurs. Les départements d’histoire n’engageraient plus suffisamment de professeurs en histoire politique, comme c’est le cas à l’UQÀM où l’« équilibre en histoire sociale et nationale a été rompu récemment à la suite de départs à la retraite et de nouvelles embauches » (p. 18).
Dans l’esprit de l’étude, restons sur le cas de l’UQAM, où les auteurs soutiennent que les embauches récentes de Magda Farhni et Martin Petitclerc « ont renforcé la sous-discipline de l’histoire sociale, déjà très bien représentée par des historiens comme Joanne Burgess, Jean-Marie Fecteau ou Yolande Cohen » (p. 26). Mais que dire de l’embauche bien plus récente encore – elle date de 2011! – de Stéphane Savard au Département d’histoire de l’UQAM, lui qui se spécialise en histoire politique, au Québec. C’en est à se demander pourquoi les auteurs ne mentionnent pas son cas… Mais poser la question, n’est-ce pas y répondre?
Quel est l’état, en fait, des départements d’histoire des universités québécoises depuis une quinzaine d’années? C’est bien beau de parler des « rares chercheurs intéressés par l’histoire politique » (p. 24) ou encore que les « professeurs dirigeant des thèses et des mémoires en histoire politique et nationale sont rarissimes » (p. 22), mais encore? Quels chercheurs ont été engagés – les uns au Québec, les autres au Canada et ailleurs… – et sur quoi portaient leurs travaux? Ces questions, dont les réponses auraient éclairé notre compréhension de la recherche en histoire des dernières années, n’ont toutefois pas été abordées par les auteurs de l’étude. On ne peut que le regretter.
Les Rébellions et les départements francophones au Québec
C’est aujourd’hui devenu un cri de ralliement : il n’y a pas de spécialiste des Rébellions dans les départements d’histoire francophones au Québec! Un fait d’ailleurs repris par les auteurs pour soutenir leur thèse. La première fois que j’ai entendu cela, j’en fus étonné. Pour ensuite me demander : mais pourquoi spécifier francophones? J’ai alors appris qu’il y avait Allan Greer à McGill et Louis-Georges Harvey à Bishop. Depuis, je me demande… quel est le problème au fond ?
Voilà deux directeurs potentiels pour tout étudiant intéressé par la question des Rébellions. S’il n’y en avait aucun, je ne dis pas, mais en voilà deux! N’est-ce pas suffisant? L’étudiant intéressé par ces questions devra aller à McGill ou Bishop, certes, mais cela fait partie de l’ordre des choses pour tout étudiant de choisir le meilleur encadrement possible, quitte à déménager pour cela. Et cela, sans compter les spécialistes en dehors du Québec, tel Michel Ducharme à la University of British Columbia. Non, décidément, je ne vois pas quel est le problème ici.
Qui plus est, comme si ce n’était pas suffisant, il est plus que possible pour un étudiant intéresser à travailler sur les Rébellions d’entreprendre un doctorat en histoire dans une université francophone au Québec. C’est d’ailleurs le cas de Julien Mauduit, inscrit au doctorat en histoire à l’UQAM sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection d’Allan Greer. Un cri de plus proféré en vain, une autre pièce à apporter au dossier…
Conclusion
L’histoire nationale est-elle négligée dans l’enseignement et la recherche universitaires au Québec? Malgré son titre-choc, ce rapport ne fournit pas de réponse satisfaisante à cette question en raison des failles inhérentes au cadre d’analyse. En fait, je ne mâcherai pas mes mots. Il s’agit d’un rapport bâclé qui manque à la fois de rigueur et de sérieux, où la démarche des auteurs a été par moments maladroite, par d’autres moments brouillonne. C’est bien dommage, car l’histoire nationale méritait de meilleurs défenseurs et, surtout, de bien meilleures assises dans ce débat pour le moins inégal.