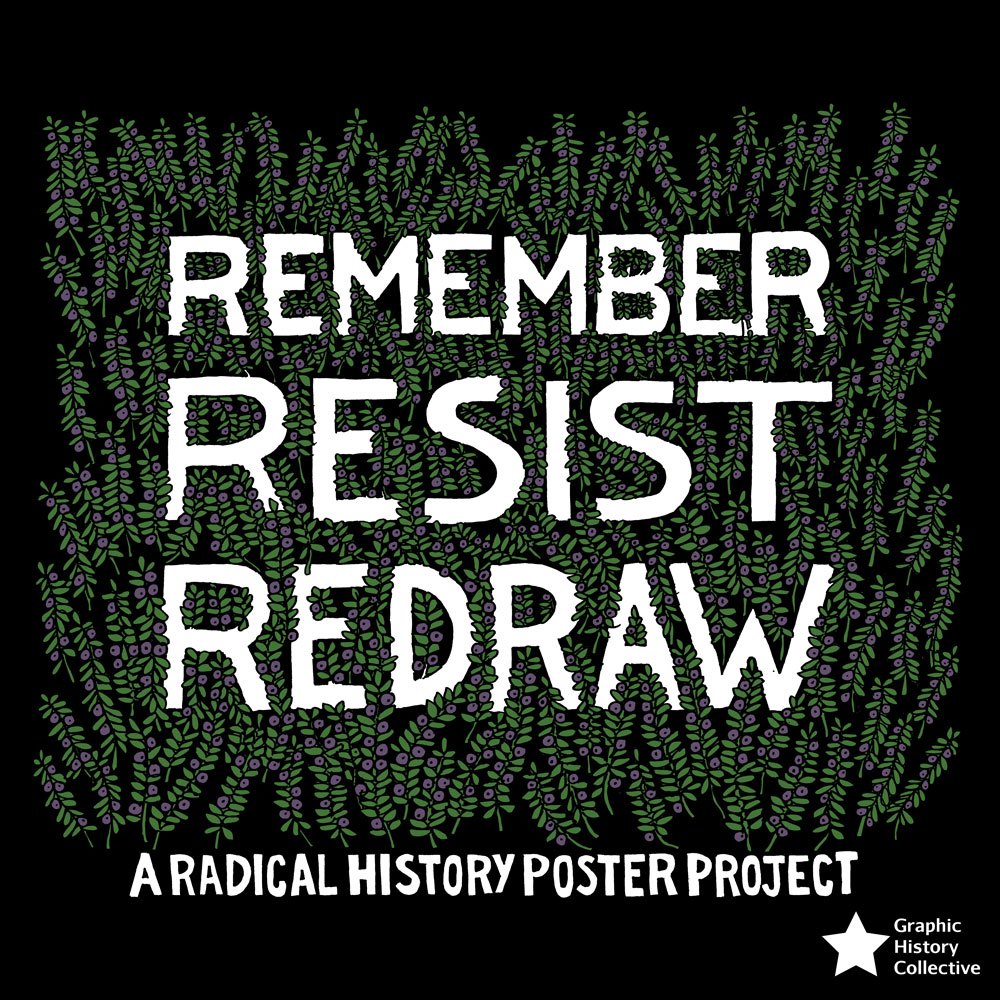Les labours de l’oubli. La Révolution tranquille dans le roman contemporain
12 min
Par Daniel Letendre, postdoctorant à l’Université Laval
Version PDF

Crédit : Arslan (Flickr).
Devant le spectacle du démantèlement à coups de massue du « modèle québécois » mis en place dans les années 1960, comme devant celui des Belles-sœurs devenues comédie musicale rose bonbon, on peut légitimement se demander ce qu’il reste aujourd’hui des innovations sociales, politiques, littéraires et discursives qui forment le legs des acteurs de la Révolution tranquille. Toutefois, la question à poser est peut-être moins celle de ce qui reste de cette époque que ce qu’on en a conservé. Comme l’écrivait Bourdieu dans Les règles de l’art à propos du Frédéric Moreau de L’éducation sentimentale, c’est bien d’avoir un héritage, mais encore faut-il l’accepter, ou plutôt convenir d’en « être hérité », accepter que « le mort […] saisi[sse] le vif[1] ». Le nœud gordien de toute réflexion sur l’héritage est formé par l’entrelacement de ces trois composantes : celui qui lègue, l’héritage lui-même, et l’héritier, qui accepte ou rejette ce qu’il reçoit, qui le conserve tel quel ou l’assimile et le transforme pour le faire sien de manière à ce qu’il devienne une part inextricable de sa lecture du monde. « Être hérité » est donc autant le prédicat du legs (qui résiste ou non au travail de l’héritier) que de l’héritier lui-même, qui accueille cet héritage en consentant à sacrifier une part de lui-même pour lui ménager une place dans son expérience.
Dans L’écologie du réel – référence de toutes les références lorsqu’on traite de la littérature et de son rapport à la fois aux années soixante et à la « postmodernité » – Pierre Nepveu relie la littérature à la difficile « naissance » – ou à tout le moins à sa représentation – du sujet identitaire et national québécois[2]. Plus d’une cinquantaine d’années après la stabilisation de l’institution littéraire québécoise, conséquence directe de la Révolution tranquille, il convient ainsi de s’interroger sur la persistance, dans les œuvres d’aujourd’hui, de certains éléments de cette période charnière de l’histoire de la Belle Province.
Quelle Révolution tranquille ?
Avant toute chose, avant de s’interroger sur ce qu’il reste de la Révolution tranquille dans la littérature d’aujourd’hui, il convient d’abord de circonscrire l’objet « Révolution tranquille ». De quoi parle-t-on, précisément, quand on fait référence à la Révolution tranquille ? D’une période s’étalant entre la mort de Maurice Duplessis en 1959 et l’élection du Parti Québécois en 1976 ? Des réformes législatives ayant mené à la modernisation de l’État québécois ? De « l’éclosion » d’une littérature et, plus largement, d’une culture québécoise ? D’une redéfinition quasi complète des sujets sociaux et historiques ? Cette longue série d’hypothèses – et surtout l’impossibilité d’en élire une seule comme signifié principal du signifiant « Révolution tranquille » – met en lumière le caractère construit de cet objet, de l’alliage historique et identitaire qu’il est devenu au fil des décennies. Face à ce constat, et considérant l’expérience que nous faisons encore aujourd’hui des années soixante, impossible de ne pas se rallier aux conclusions de Paul Ricœur qui, dans Temps et récit[3], affirmait que tant l’histoire que l’identité sont le produit d’un récit. Aux questions « qu’est-ce que la Révolution tranquille » et « qu’en reste-t-il ? », on ne peut donc que répondre : « un récit[4] ». En conséquence, s’intéresser à l’héritage laissé par la Révolution tranquille puis repris par les écrivains contemporains oblige à l’analyse du triple récit qui en forme l’objet historique et identitaire : le récit d’elle-même que la Révolution tranquille a laissé ; le récit de la conservation ou du rejet de ce récit premier ; finalement, la mise en récit, aujourd’hui, de la Révolution tranquille.
En se plaçant du point de vue des narrateurs contemporains et des personnages qu’ils racontent, cette période de l’histoire québécoise est envisagée de manière tant positive que négative. Si elle a permis une émancipation certaine du sujet québécois et de la culture qui lui donne forme et en est la représentation, la Révolution tranquille à également traîné avec elle une bonne dose d’oubli que Catherine Mavrikakis, Louis Hamelin et Raymond Bock, entre autres, s’efforcent justement d’oublier, de réparer, ou de sauver. Dans Ça va aller (2002), La constellation du lynx (2010) et Atavismes (2011), est mis en scène sinon la Révolution tranquille elle-même (Hamelin, par exemple, s’intéresse directement au récit factuel de la Crise d’octobre), du moins à ce qu’elle masque ou impose au sujet contemporain. L’oubli demeure néanmoins un trait essentiel de la mémoire de Révolution tranquille conservée jusqu’ici. Les écrivains tout juste mentionnés se partagent en effet les différents types d’oublis qui traversent le récit de la Révolution tranquille et sa postérité : des oublis fâchés et fâcheux, des oublis encombrants ou éclairants, des oublis qui trahissent parfois une vérité beaucoup plus ambiguë que celle colportée par les canaux officiels. Surtout, des oublis qui forcent à prendre position, qui obligent à jouer le rôle de l’héritier, au moins pour décider si on souhaite « être hérité » par les récits et les « trous » qu’ils contiennent et propagent.
Travailler l’oubli (ou l’oublier)
Dans les trois œuvres nommées plus haut, le récit de la Révolution tranquille agit comme un souvenir-écran cachant un refoulé inacceptable. Or ce refoulé est complexe. Il est tissé, d’une part, de la « nouveauté de l’avenir […], l’impensable des jours à venir[5] », bref, de la liberté d’inventer, aujourd’hui, le Québec. Sappho-Didion Apostasias, héroïne narratrice de Ça va aller, souhaite laisser une page blanche à sa fille pour qu’elle n’ait pas à subir la contrainte d’une présence absente, celle des idéaux identitaires des années soixante. Sappho-Didon agit comme métaphore d’une génération qui a rêvé puis a été déçue par ces idéaux constamment répétés, célébrés, glorifiés, mais jamais concrétisés par ceux qui les ont portés. Ils sont – ces rêves et leurs rêveurs – à l’image de ce Robert Laflamme, figure ducharmienne dont la gloire et l’effacement de l’espace public envahissent pourtant ce même espace au point de ne laisser aucune place à ses successeurs qui souhaiteraient l’habiter. Ça va aller est le reniement violent de l’héritage de la Révolution tranquille, legs constitué de fausses promesses qui contraignent l’avenir à leur répétition. Créer l’oubli pour que l’avenir et sa possibilité ne soient plus ce qu’on oublie, voilà le travail de l’héritier chez Mavrikakis.
Souvenir-écran qui camoufle et provoque le refoulement de l’avenir chez Mavrikakis, ce même récit hérité de la Révolution tranquille, fabriqué d’enflure et de fausses vérités, sert d’autre part, comme chez Hamelin et chez Raymond Bock, à oblitérer du récit officiel une foule de détails qui permettraient de raconter l’histoire autrement. Hamelin interroge le récit de la Crise d’octobre pour en révéler les apories et démontrer, par l’exemple, que l’histoire peut être trafiquée et arrangée afin de servir des causes politiques. En proposant une nouvelle organisation narrative des événements ayant mené à la mort de Pierre Laporte, en évoquant la possibilité d’une autre histoire de ces années houleuses, histoire où les rôles sont distribués autrement, Hamelin fait bouger les certitudes et révèle toutes les ambiguïtés d’un épisode important de l’histoire récente. En somme, il fait la preuve qu’il ne faut se fier à aucun récit.
Bock, de son côté, ressort du passé à la fois colonial, canadien-français et révolutionnaire du Québec, mais également du présent le plus pragmatique, des atavismes que le récit omniprésent de la Révolution tranquille a laissé de côté. La succession des « histoires », comme l’indique le sous-titre du livre, et le fait que celle qui inaugure le recueil raconte un violent événement rappelant l’enlèvement et l’assassinat de Pierre Laporte, détruit l’illusion des années soixante comme moment de la naissance « tranquille » de l’identité québécoise. L’héritage de la Révolution tranquille oscille entre une situation économique, une « belle abondance […] qui offraient des avantages incontestables[6] », et une sorte de romantisme révolutionnaire s’inscrivant dans le prolongement de celui du « courageux Montcalm[7] » et du dévouement des Patriotes de 1837-38. Bock fouille l’histoire nationale en prenant soin de montrer que chaque moment est une fin et un recommencement, une lassitude et un espoir, qu’il n’y a pas une histoire, mais des histoires qui constituent le récit d’un peuple. L’Histoire est reléguée au niveau des anecdotes qui la construisent, anecdotes qui prennent à bras-le-corps l’inconscient collectif, cet oubli que le récit dominant a créé. Dans « Effacer le tableau », par exemple, qui prend place dans un futur indéterminé, un groupe révolutionnaire tente par les armes de faire tomber le système néolibéral hérité des années soixante. Ayant pour Bible un exemplaire pourri du Refus global, un commando a pour mission de protéger le pavillon québécois au Musée des arts canadiens. Après avoir essuyé plusieurs salves lancées par l’armée, obligés de s’enfuir dans les couloirs du métro en apportant avec eux les tableaux décrochés rapidement et à l’aveuglette, les membres encore en vie du groupuscule font une pause pour admirer le seul tableau qu’ils ont pu sauver de la bataille : « Un Holgate, tabarnac [8]! » Comment lire cette finale autrement que comme le retour du refoulé identitaire ? Ayant passé la quasi-entièreté de sa vie à Montréal, Holgate fait partie de la culture d’ici, il définit l’identité québécoise et, en ce sens, doit lui aussi être sauvé de l’assimilation.
Sauver la culture québécoise, préserver son unicité, c’est également protéger son ambivalence, sa complexité et, surtout, l’ironie de l’histoire qui la détermine, cette ironie qui, bien qu’on tente d’ensevelir sous des couches d’épisodes héroïques et de discours patriotiques et orgueilleux la honte d’avoir été abandonné, nous le rappelle constamment.
Créatrice d’histoire et d’identité et, pour ce faire, créatrice d’oubli, la Révolution tranquille a laissé aux écrivains contemporains un récit en jachère. Il faut alors choisir son camp : percevoir ce récit-écran comme une terre brûlée, stérilisée après avoir donné des fruits imparfaits, mais qui ont été les seuls qu’on pouvait espérer ; ou bien le voir comme une terre en attente de nouvelles semences. Qu’elles soient plantées par un bras mû par l’indignation ou par la force d’une mémoire ensevelie devant être racontée importe peu. Car ce qui compte est d’accepter de le travailler, ce récit, d’en « être hérité » et d’en retourner la terre pour qu’il respire un peu.
Pour en savoir plus
BOCK, Raymond. Atavismes. Montréal, Le Quartanier, 2011, 230 p.
BOURDIEU, Pierre. Les règles de l’art. Paris, Seuil, 1992, 480 p.
HAMELIN, Louis. La constellation du lynx. Montréal, Éditions du Boréal, 2010, 600 p.
LAPOINTE, Martine-Emmanuelle. Emblèmes d’une littérature. Montréal, Fides, 2008, coll. « Nouvelles études québécoises », 368 p.
MAYRIKAKIS, Catherine. Ça va aller. Montréal, Leméac, 2002, 160 p.
NEPVEU, Pierre. L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine. Montréal, Éditions du Boréal, 1988, 243 p.
RICOEUR, Paul. Temps et récit, Paris, Seuil, 1982-1985, 3 volumes.
[1] Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Paris, Seuil, 1992, p. 34.
[2] Pierre Nepveu, L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, Montréal, Éditions du Boréal, 1988, 243 p.
[3] Paul Ricœur, Temps et récit, Paris, Seuil, 1982-1985, 3 volumes.
[4] Il est à noter que la constitution de la Révolution tranquille en récit a été faite dès les années 1960, notamment en ce qui a trait aux œuvres littéraires qui en seraient la représentation. À ce sujet, voir le très bon ouvrage de Martine-Emmanuelle Lapointe, Emblèmes d’une littérature, Montréal, Fides, 2008, coll. « Nouvelles études québécoises », 368 p.
[5] Catherine Mavrikakis, Ça va aller, Montréal, Leméac, 2002, p. 149.
[6] Raymond Bock, Atavismes, Montréal, Le Quartanier, 2011, p. 153.
[7] Ibid., p. 156.
[8] Ibid., p. 175.
Articles sur les mêmes sujets