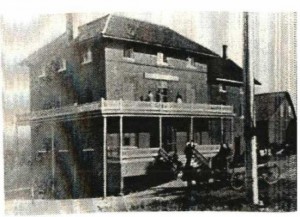Prise de parole: réflexion sur les recherches en archives et les traumatismes individuels
13 min
Par Guillaume Vallières, étudiant à la maîtrise en histoire à l’Université de Montréal et membre étudiant au Centre d’histoire des régulations sociales
Il est souvent difficile pour les étudiant.e.s en sciences humaines et sociales de s’ouvrir sur leurs émotions et sur leur vécu dans le milieu universitaire. Bien que la réalité ne soit pas la même dans toutes les disciplines et dans toutes les universités, le contexte scolaire est généralement inadéquat pour ce genre de comportements, considéré comme un débordement, une digression à une loi non écrite demandant une neutralité émotionnelle. Lorsque les sujets d’étude mènent à l’émotivité, les universitaires se retrouvent tiraillé.e.s entre le désir de répondre aux exigences de performances qui leur sont imposées et une série d’émotions qui leur demandent de prendre une pause, une forme de considération plus profonde ou un peu de recul face à leur terrain.
Les sources peuvent parfois être totalement impitoyables de par la charge émotive qu’elles portent en elles. Dans ces circonstances, certain.e.s étudiant.e.s se trouvent désavantagé.e.s par rapport aux autres. Toutes les archives ne sont pas aussi émotivement « chargées » et tous.tes les étudiant.es n’ont pas le même vécu. Impossible donc de réagir de la même façon face aux documents étudiés. Malheureusement, nous ne pouvons pas laisser nos traumatismes à l’entrée des centres d’archives avec nos sacs à dos. Non… nous les trainons jusque dans les salles de consultation et devons parfois les voir ressurgir dans les sources analysées.
Cette réalité est d’autant plus vraie chez ceux et celles qui se concentrent sur des sujets émotionnellement « chargés ». Ceux et celles qui, dans le cadre de leurs recherches, se penchent sur la mort, les oppressions et les violences. C’est un peu pourquoi ma dernière visite aux Archives gaies du Québec s’est soldée par un inconfort si grand que j’ai dû quitter promptement l’endroit.
En feuilletant les différents fonds et collections du centre d’archive, je suis tombé sur une série de sources journalistiques et militantes témoignant de la violence policière et de l’histoire d’homosexuel.le.s ayant dû faire face à la justice pour avoir été ce qu’ils sont, et pour avoir osé le montrer à la face du monde. Difficile pour le militant homosexuel que je suis de ne pas me sentir concerné par ce témoignage. Difficile de ne pas sentir mon cœur se serrer et ma gorge se nouer. Difficile de faire face à une violence si explicitement démontrée, et pourtant si commune.
L’inconfort m’étreignant, j’ai pris la décision de quitter abruptement les archives. Des images et des souvenirs désagréables de manifestations me viennent à l’esprit. J’aurais pu rester plusieurs heures aux archives et travailler. J’aurais pu être « efficace ». J’aurais pu refouler l’émotion et me mettre à la tâche, mais le tout aurait été malsain. J’aurais dû mettre de côté une partie de ce que je suis pour pouvoir répondre à une norme voulant que je performe, peu importe le contexte. Bref, j’aurais dû mettre de côté la partie de moi qui me pousse à faire ce genre de recherches. Tout aurait alors perdu son sens. Est-ce que cette réaction fait de moi un mauvais chercheur ? Non, je ne crois pas.
Cette expérience me pousse à penser plus largement à la culture académique liée à l’émotivité en recherche. Que faire face à cette situation ? Comment concilier émotions et recherches universitaires en histoire ? Comment faire face à des sources aussi dures ? J’écris ces lignes dans l’espoir de susciter un intérêt face à une situation qui, j’en suis certain, touche bon nombre de chercheurs.euses en sciences humaines et sociales. J’inviterais la communauté universitaire concernée à mettre de l’avant ces expériences et à initier une discussion sur le sujet, pour que l’on réalise que la colère, l’incompréhension, la peur, la tristesse et l’angoisse accompagnent nos recherches sans nécessairement se refléter dans nos conclusions et dans nos publications. Accepter que ce que l’on vit, seul.e face à nos sources, est un sentiment valide qu’on ne devrait pas rejeter du revers de la main.
L’historien Dominick LaCapra présente l’histoire comme étant indissociable des traumatismes qu’une société porte en elle et que les individus ont intériorisés. Dans cette optique, les traumatismes vécus par les populations marginalisées ne sont pas à mettre de côté, mais bien à inclure dans le récit historique. Le trauma et sa réception font partie intégrante de l’histoire que l’on se raconte[1]. Nous ne devrions donc pas être mal à l’aise face à nos propres réactions qui, de toute façon, ne sont pas absentes de la recherche. Je pense à la professeure Mi’kmaq Pam Palmater, spécialiste des enjeux autochtones au Canada, qui explique qu’elle voit souvent ses étudiant.e.s être choqué.e.s, tristes, colériques et défensifs.ives face à des récits historiques qui n’occultent pas l’horreur du génocide autochtone[2]. Je pense à cet homme qui a pleuré à l’écoute d’une source orale relatant les ravages du VIH/SIDA sur la communauté gaie. Je pense à toutes ces personnes afro-descendantes qui travaillent sur l’esclavage et qui doivent vivre avec la violence des archives dans lesquelles ils et elles plongent. Je pense à cette amie, spécialiste en histoire des femmes, qui s’est fait étiqueter, en plein séminaire, comme étant biaisée, parce que « trop proche de son sujet d’étude ». Je pense à tous ceux et celles qui, face à leurs sources ou à leur terrain se sentent bouleversé.e.s.
Les réalités exposées ci-haut s’articulent autour de deux grandes tendances. La première concerne les récits historiques dominants et la manière dont nous les transmettons. En omettant de parler de l’horreur et des aspects plus chargés de l’histoire, il devient d’autant plus difficile et choquant de les voir ressurgir dans les archives et les trames historiques non-dominantes. Nous n’avons jamais appris à vivre avec ces faits historiques liés à la domination, pas plus que nous avons été capables de les regarder en face. Ce qui est difficile dans cette situation, c’est d’être confronté à ces atrocités en plus de réaliser qu’elles s’opèrent encore de nos jours dans une indifférence presque totale.
La seconde tendance, quant à elle, renvoie directement aux individus marginalisés, surtout les personnes racisées, qui traitent d’oppression et de marginalité dans leurs recherches, mais qui n’en parlent peut-être pas, de peur d’être discrédité.e.s par une discipline historique qui les a invisiblisés ou de peur d’être accusé.e.s de « victimisation » par une masse d’académiques qui se perçoivent comme « neutres ». Leilani Sabzalian s’exprime d’ailleurs sur la question sur Twitter en affirmant que « it’s easier for white academics to publish and make tenure writing about colonization…the archives don’t haunt them, the trauma doesn’t live in their bones, and they don’t have to put the books down to breathe… » [3]. Les personnes issues des minorités, surtout racisées, sont les plus susceptibles de vivre ce genre de réaction et d’oppression.
Force est d’admettre que, dans les deux cas de figure étalés ici, c’est le silence qui prime ; le silence de l’invisibilisation de l’horreur et le silence de ceux et celles qui sont exténué.e.s de devoir sans cesse se justifier par rapport à leur vécu et à leurs recherches.
Cette culture académique du silence vient alors créer un problème de nature épistémique et relègue, encore une fois, les populations opprimées en marge de la recherche académique. En n’étant pas ouvertes à cette réalité, les universités se privent d’un regard valide et essentiel à la compréhension des enjeux analysés. On vient alors créer un environnement où seul.e.s les chercheurs.euses dit.e. « neutres » ont la crédibilité nécessaire pour se pencher sur l’ensemble des questions du domaine. C’est la fragile diversité du monde académique qui souffre de cette situation. C’est, encore une fois, une manifestation du pouvoir de la majorité sur les minorités. Ce sont toutes les oppressions qui se révèlent sous un nouveau jour dans un système académique qui les tolère et qui les encourage implicitement.
Alors que le sujet des émotions dans le rapport aux archives est peu discuté dans les cadres officiels du monde académique, certain.e.s historien.ne.s et chercheurs.euses se tournent vers les réseaux sociaux pour mettre de l’avant des expériences bouleversantes générées par leurs recherches. Prenons l’exemple de Heather Ann Thompson, historienne américaine travaillant sur le milieu carcéral, qui a récemment publié ceci sur Twitter: « Confessions of a serious historian of the carceral state: the only way I can do this work, not crumble in despair, is to escape, with a glass of wine or whiskey, into a regular dose of trashy tv. Yep, I admit it[4] ». Ce gazouillis a été commenté par environ une quinzaine d’autres personnes ayant un vécu semblable, démontrant du même coup qu’il s’agit là d’un phénomène bien réel. Le sociologue américain Philippe Duhart répond que la situation est « the same for sociologists studying terrorism. Triple if the subject is white supremacist terrorism[5] ». Une autre historienne ajoute alors ceci : « So true. Archival research for me has always been the most painful. Esp when I researched STRESS in Detroit. So brutal and dehumanizing. I thought I’d be detached enough, but then I thought, these are actual things that happened to actual human
beings[6] ».
La charge émotionnelle du travail avec les archives « difficiles » pose alors la question de l’impact sur la santé psychologique. Que font les universitaires quand les émotions sont fortes? Vers quelles ressources peuvent-ils et elles se tourner? Alors qu’on sait aujourd’hui que la détresse psychologique est une réalité inquiétante dans le monde académique, comment ces chercheur.euse.s font-ils et elles pour faire face à de potentielles détresses psychologiques? Dans les faits, il faut souvent se taire ou accepter de faire face à un silence gêné ou l’incompréhension de la part de ses paires lorsqu’on ose s’ouvrir sur cette question. Au final, ceux et celles qui souffrent de leurs recherches semblent n’avoir d’autre choix que de se consoler entre eux et elles, et encore faut-il avoir le courage de mettre publiquement de l’avant notre vécu.
Pourtant, les réactions exposées ci-haut ne sont pas totalement inconnues du milieu de l’archivistique et de la recherche en archives. En effet, Yvon Lemay, Anne Klein et leurs collaborateurs ont déjà fait état d’une expérience menée par la section de la région de Montréal de l’Association des archivistes du Québec sur la question des émotions et des archives. Ayant eu lieu en 2013, l’expérience en question visait à présenter cinq documents d’archives, à les analyser et ensuite de discuter des émotions qui ont été suscitées par lesdits documents[7]. Suite à l’expérience[8], les auteurs.trices évoquent qu’
[i]l est clair, soulign[e] Olivier Dumas, que : « Notre regard sur les archives est intrinsèquement influencé par nos connaissances des sujets, notre curiosité intellectuelle, notre âge, notre parcours académique et notre cheminement culturel et sociopolitique. »[9]
Le groupe ajoute qu’
[a]utrement dit, l’émotion ne peut surgir que d’une rencontre entre un objet et un individu. Une rencontre, précise Anne Klein, entre d’une part un utilisateur, son champ de connaissances, sa culture, son univers et d’autre part, les archives, leur matérialité, leur contenu, leur contexte.[10]
Malgré le développement d’une certaine littérature sur le sujet, ce type de prise de parole semble encore tabou dans les milieux dits officiels. Je conclus donc ce texte en lançant un appel aux milieux historien québécois, un appel à partager votre expérience avec un ou des fonds d’archives émotionnellement chargés. Que ce soit dans la littérature scientifique ou sur les médias sociaux, chaque expérience est valide. Votre vécu compte. Pour ma part, je partirai le bal sur Twitter dès que ce texte sera publié. J’utiliserai le mot-clic #archivesetemotions. Je vous invite à faire de même, parce que j’ai la ferme conviction que ce petit mouvement peut, à tout le moins, susciter une réflexion nécessaire et pertinente quant à une remise en question de la pratique historienne.
[1] Cette vision de l’histoire fait partie intégrante de l’argumentaire présenté par Dominick LaCapra dans « Writting History Writting Trauma », 2001, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 225 p.
[2] Pam Palmater parle plus largement des réactions auxquelles elle doit faire face dans cette vidéo : https://www.tvo.org/video/why-do-indigenous-topics-cause-such-emotional-discomfort
[3] Propos tenus sur Twitter par Leilani Sabzalian le 7 septembre 2018. https://twitter.com/leilanisabz/status/1038127669907312640
[4] Propos tenus sur Twitter par Heather Ann Thompson le 16 août 2019. https://twitter.com/hthompsn/status/1162551189898240002
[5] Propos tenus sur Twitter par Philippe Duhart le 17 août 2019. https://twitter.com/PhilippeDuhart/status/1162732908576219137
[6] Propos tenus sur Twitter par Kenneth Alyass le 17 août 2019. https://twitter.com/kenalyass/status/1162739172320448514
[7] Yvon Lemay, Anne Klein et al., « Les archives et l’émotion : un atelier d’exploration et d’échanges », Archives, volume 44, no 2, 2012-2013, p. 91-92.
[8] Une étude plus large sur une question semblable a aussi été menée à Anger en 2012. Plus orienté vers les statistiques dans la présentation de leurs résultats, le groupe de recherche arrive à des conclusions précises sur le sujet. Christine Dufour, Anne Klein et Sabine Mas, «Émouvantes, les archives ? Le point de vue des archivistes français », dans La Gazette des archives, no 233, 2014-1. Les archives, aujourd’hui et demain… Forum des archivistes 20-22 mars 2013 (Angers) p. 75-90.
[9] Yvon Lemay, Anne Klen et al. Loc. cit., p. 100.
[10] Ibid.
Articles sur les mêmes sujets