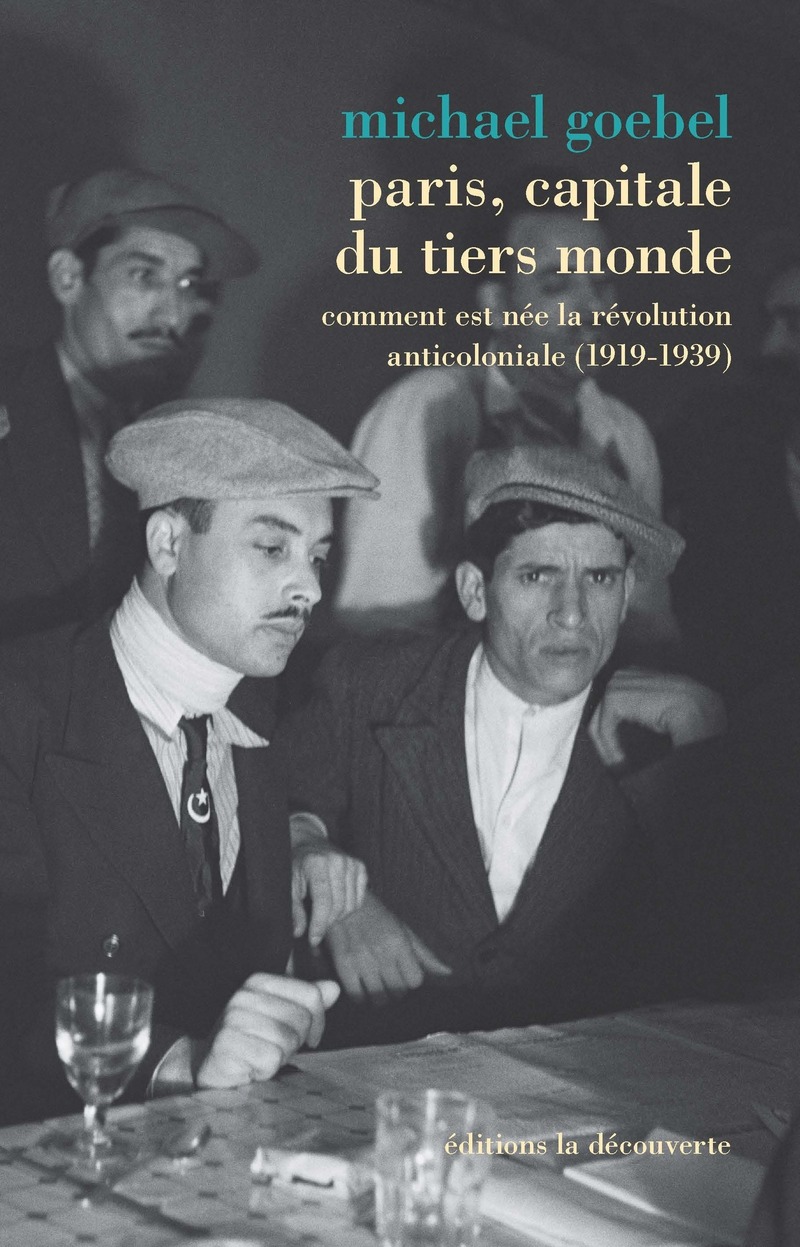Repenser l’absolutisme en France aux XVIe et XVIIe
siècles. Note de lecture sur
Le Prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique d’Arlette Jouanna
20 min
Par Christian Legault, candidat à la maîtrise à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
Version PDF

JOUANNA, Arlette. Le pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté. Paris, Gallimard, 2013, 436 p.
La manière dont le pouvoir politique s’est conceptualisé dans un régime absolutiste au XVIIe siècle façonne toujours nos sociétés d’aujourd’hui. Les Français y voient encore une époque où le pouvoir y était « arbitraire », « despotique », « inique » et « illégitime »[1]. S’interroger sur l’absolutisme n’est toutefois pas quelque chose d’inutile, car cela représente une occasion de retracer la genèse du pouvoir politique vers les régimes démocratiques modernes. Pour les historiens, l’étude des doctrines absolutistes permet notamment d’étudier l’interaction entre le discours politique et ses limites concrètes, la monarchie absolue du XVIIe siècle n’ayant pas su imposer un appareil d’État pouvant soumettre l’entièreté des sujets à l’obéissance d’un seul homme. Les notions de pouvoir absolu et de prince absolu sont au fondement d’un nouveau dogme politique qui s’installe dans la France des XVIe et XVIIe siècles. Or, ces idées restent de nature théorique, à la fois ambivalentes et polysémiques, et enracinées dans des discours où les significations sont portées à changer, selon les cadres spatio-temporels, les régimes politiques, les différentes formes de régulations sociales, ainsi que les multiples contextes intellectuels et culturels dans lesquels ces notions émergent. Il devient alors nécessaire de revenir sur ce qu’était l’absolutisme dans la France de l’époque moderne, afin de comprendre comment le pouvoir se construit et pour quelles raisons ce dernier fut qualifié – mais nuancé aujourd’hui par les historiens – d’absolu.
Dans Le Prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, deuxième opus d’un diptyque, commencé avec le livre, Le pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Arlette Jouanna nous convie à comprendre les notions de pouvoir absolu, de prince absolu et d’absolutisme par une étude approfondie croisant l’histoire politique et l’histoire des idées politiques. Par l’étude des débats de l’époque entourant les théoriciens philosophiques du pouvoir politique, elle retrace comment ces notions se construisent dans l’imaginaire monarchique en France à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Identifiant les guerres de religion du XVIe siècle, ainsi que les guerres civiles du XVIIe siècle, comme des éléments déclencheurs dans cette redéfinition du pouvoir politique, l’historienne en vient à identifier la nature traumatisante de ces événements; elle montre comment la peur du désordre, suivi de la mémoire des horreurs des guerres civiles, obséda les esprits, contribuant à faire accepter un renforcement considérable de l’autorité monarchique[2].
En ce sens, l’ouvrage de Jouanna réussit non seulement à nous instruire sur l’absolutisme, en montrant comment le pouvoir absolu fut construit en France autour de la figure du prince, mais il nous permet également de méditer sur des enjeux actuels du pouvoir. Il ne faut pas voir, cependant, dans Le prince absolu une volonté de l’historienne de comparer l’actualité politique à celle des XVIe et XVIIe siècles français, car cela ne fut jamais son objectif. Son but était d’étudier le pouvoir absolu dans son champ d’études circonscrit. L’historienne demeure, néanmoins, sensible aux enjeux sociaux entourant la mémoire de la monarchie absolue dans la France d’aujourd’hui. En effet, dans l’avant-propos du Pouvoir absolu, Jouanna mentionne comment la représentation de l’absolutisme – incarnant l’Ancien Régime, un univers de privilèges et de particularismes – a été utile pour mettre en contraste les nombreuses conquêtes de la Révolution française et valoriser ainsi une mémoire nationale républicaine[3]. De même que dans la conclusion du Prince absolu, elle fait le pont entre l’absolutisme du XVIIe siècle et le développement des idéologies du XVIIIe siècle; soit le libéralisme de Montesquieu qui théorisa la séparation des trois formes du pouvoir (législatif, exécutif et judiciaire), et le républicanisme de Rousseau, appuyé sur l’idée de souveraineté populaire[4]. Le premier représente une contestation de l’absoluité du pouvoir, tandis que l’autre suggère un retournement du pouvoir absolu en faveur du peuple, d’où l’idée d’un Contrat social. Rousseau écrivit d’ailleurs, que « comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte le nom de souveraineté[5]. »
En étant consciente des multiples formes d’interrogations que suscite l’ouvrage, à la fois savantes, sociales et mémorielles, cette note de lecture sera divisée en quatre points. Nous débuterons d’abord par un retour sur la notion d’obéissance, afin de comprendre comment le concept fut pensé et théorisé par les intellectuels de l’absoluité du pouvoir politique. Nous poursuivrons ensuite avec des réflexions sur la sacralité du souverain, et comment cette sacralité peut être reliée à la notion de raison d’État. Nous aborderons dans un troisième temps la pensée politique du philosophe anglais, Thomas Hobbes, et son influence chez certains philosophes français. Nous terminerons en nous interrogeant sur l’ambivalence du régime absolutiste, notamment dans la distinction entre son cadre éthique et juridique, ainsi que comment Louis XIV réussit à incarner, à la fois, l’apogée et le déclin de l’absolutisme.
L’obéissance comme fondement de l’absoluité du pouvoir?
L’obéissance, concept central dans le présent ouvrage de Jouanna, est présentée explicitement dès son deuxième chapitre, L’obéissance absolue, où l’historienne s’emploie à comprendre l’interaction entre puissance absolue et obéissance absolue; pour elle, l’une ne peut être envisagée sans l’autre[6]. Les théoriciens de l’absoluité du pouvoir en furent bien conscients. En étudiant les écrits du philosophe Pierre Charron, moraliste du XVIe siècle, Jouanna montre comment l’obéissance absolue relève de la « dissociation entre la conduite extérieure de soumission et le jugement cantonné dans le for intime[7]. » Dans son œuvre, De la Sagesse (1601), le philosophe évoque la connexité entre le « commander » et « l’obéir », tout en affirmant « que le “ mal obéir ” est beaucoup plus dangereux que le “ mal commander ” »[8]. Pour Charron, « obéir extérieurement tout en réservant son opinion intime, ce n’est pas, répète-t-il, se résigner peureusement; c’est agir noblement et sagement »[9]. En d’autres mots, peu importe si l’ordre et le régime monarchique sont injustes, ce qui compte, c’est l’autonomie de la conscience et le maintien de l’ordre établi, car pour le philosophe, l’obéissance est le socle d’une paix collective et d’une tranquillité d’esprit[10]. Or, l’obéissance absolue ne signifie pas l’absence de liberté. Toutefois, pour concevoir l’idée d’une « obéissance libre » – terme employé par Jouanna – il fallait situer la liberté, soit comme Pierre Charron la concevait, c’est-à-dire dans un « détachement du for intérieur à l’égard des inévitables imperfections de l’ordre établi », soit comme les libertins[11] du XVIIe siècle, dans la dissimulation d’opinions hétérodoxes[12]. Peu importe ce choix, l’obéissance absolue demeure, pour ces théoriciens, l’un des fondements du pouvoir absolu monarchique.
La raison d’État au service de la sacralité du monarque?
Si toutefois on avait retranché la liberté dans la conscience individuelle, comment en retour assurer l’obéissance? La sacralité du pouvoir jouera désormais un rôle essentiel. La notion de sacralité, présentée dès l’introduction de l’ouvrage, est utilisée selon la définition que lui donne Marcel Gauchet : « il y sacré lorsqu’il y a attestation tangible de l’au-delà dans l’ici-bas, matérialisation de l’invisible dans le visible – dans un lieu, un corps, un objet[13]. » Auparavant, cette matérialisation se trouvait dans une communauté politique, assimilée à un corps, dont le roi était la tête. À partir du règne de Louis XIII, comme l’expose Jouanna, il devient représenté par le prince lui-même[14]. Le corps politique se désacralise donc en se séparant du monarque. À cet effet, l’historienne prend l’exemple de Richelieu, qui écrivait, dans son Testament politique : « il se trouve souvent des occasions où, quelque authorité qu’ait un ministre, elle ne peut estre assez grande pour produire certains effets qui requièrent la voix d’un souverain et une puissance absolue[15]. » Ceci démonte alors la figure machiavélique qu’Alexandre Dumas avait construite dans Les trois mousquetaires et montre que, contrairement à l’image qu’en donne la culture populaire actuelle, Richelieu se soumettait au dogme de la puissance absolue du monarque. La sacralité appartenait ainsi au roi et Richelieu demeurait strictement dans sa mission d’agent exécutif du pouvoir[16].
De la même manière, Richelieu s’efforçant, par le moyen des écrits de ses publicistes, de faire intérioriser au peuple la notion de « mal nécessaire ». La violence d’État était conçue telle qu’un mal qui lésait considérablement la société française, nécessaire toutefois, suite aux bénéfices qu’elle accordait au corps politique[17]. Puis, sous Richelieu, cette dernière apparaît dorénavant comme un bien, voire un « remède douloureux »[18], pouvant éradiquer les maux des gouvernés. Le cardinal associe alors la violence absolue à la notion de raison d’État. Dans son Testament politique, Richelieu suggère que l’autorité du prince renvoie à l’obéissance – incontournable, comme nous l’avons expliqué précédemment –, c’est pourquoi il faut – à défaut de laisser les sujets à eux-mêmes, avec comme contrainte d’obéir aveuglément, mais sans amour pour le souverain – instruire le peuple, afin de le persuader que raison d’État est synonyme d’intérêt général[19]. Le prince agirait alors en fonction de l’intérêt de son peuple. En propageant la foi du dogme absolu, on assurait l’obéissance des gouvernés[20].
Hobbes et le pouvoir absolu
La sacralité du roi lui procurait un pouvoir de coercition sur ses sujets, afin qu’ils obéissent et se soumettent à lui. Sous cet angle, la monarchie absolue pouvait être qualifiée « d’impitoyable machine d’autorité »[21]. Thomas Hobbes, célèbre philosophe anglais, connu notamment pour son œuvre philosophique sur le pouvoir politique, donna, en 1651, le nom de Léviathan « à l’entité suprahumaine que symbolise cette “ machine ” du pouvoir »[22]. Dans Elements of Law, le philosophe explique que pour échapper aux risques éventuels de l’État de nature, soit la guerre généralisée de tous contre tous, « les hommes ont conclu une “ union ” qui leur garantissait la sécurité et la concorde »[23]. Ce pacte vertical, où les individus renoncent volontairement à leurs droits, procure une autorité et un pouvoir absolu au souverain; par l’aliénation de leurs droits, les hommes ont abandonné leurs droits et libertés, ainsi que leur pouvoir d’agir, car cela représentait dans l’État de nature une « liberté farouche et brutale »[24]. En échange de la liberté, ils reçurent la sécurité. Or, dans l’État politique, l’obéissance au souverain – incarnée par un ou plusieurs hommes, selon Hobbes – est synonyme de bien commun; « il [le souverain] est alors amené à se délivrer des passions ordinaires et à gouverner sagement »[25]. En postulant que la nature des Hommes est fondamentalement mauvaise, Hobbes explique que le recours à la coercition par l’État n’est pas une pratique inévitable, mais elle est nécessaire, car elle est porteuse d’unité. L’instauration de la paix passe alors inévitablement par la nécessité d’un État fort. Le recours à la force légitime représente le moyen d’établir cette dernière. Le pouvoir n’est absolu que parce qu’il a la nécessité de l’être.
En abordant la figure du Léviathan, Jouanna cherche non seulement à comprendre comment le pouvoir absolu était conçu dans l’œuvre de Thomas Hobbes, mais elle s’intéresse aussi à la manière dont la pensée du philosophe anglais s’insère dans le contexte français du XVIIe siècle. Elle montre, par exemple, comment Hobbes a réussi à influencer le philosophe français Jean de Silhon dans sa conception du pouvoir. Silhon conçoit, par exemple, la liberté des sujets dans leur capacité à se soumettre à l’obéissance absolue. Tout comme Hobbes, il perçoit une faiblesse dans la nature humaine. Incapable d’être totalement indépendant politiquement, les sujets se retrouvent en situation d’infériorité. Cette situation « naturelle d’infériorité » les pousserait, selon Silhon, à se tourner vers une force politique plus fort[26]. Ainsi, en acceptant leur condition de servitude, les sujets reconnaissent que l’ordre du pouvoir leur est bénéfique[27]. Si le philosophe français ne s’est jamais explicitement référé à Hobbes, il est indéniable qu’il fut influencé par ce dernier dans sa conception du pacte de soumission[28]. On remarque donc que par la mise en place d’un nouveau discours théorique, où l’État est désormais incarné par la sacralité d’un seul homme, l’obéissance et la servitude volontaire à un régime absolutiste seraient alors devenues justifiables dans la pensée de la société française du XVIIe siècle, comme un moyen de régulations sociales.
Un monarque absolu au-dessus de tout?
La sacralisation du monarque permit, en somme, une obéissance de la part de ses sujets. Cette sacralisation du prince législateur lui donnait désormais le droit absolu à la parole autorisée[29]. Affirmer le droit, c’était dire le juste. Or, le rapport entre l’intemporalité juridique du souverain et la justice commençait à illustrer une ambiguïté; la sagesse « naturelle » du roi ne peut empêcher la possibilité d’une « disjonction entre l’ordre juridique et l’ordre éthique, c’est-à-dire, entre la morale et le droit »[30]. Les penseurs du pouvoir politique ont donc été amenés à faire « de l’autolimitation du monarque non plus le signe de sa soumission à une norme extérieure, mais la marque par excellence de l’absoluité de son pouvoir »[31]. La soumission des sujets à l’obéissance du monarque eut comme conséquence une séparation radicale entre le devoir civique et le devoir moral[32]. Dans son livre, La République, Bodin retrace notamment les traits qualitatifs d’un bon roi face à un tyran, mais le philosophe a également compris la difficulté du pouvoir; « la puissance absolue l’avait amené à soutenir que les lois d’un tyran étaient juridiquement valides »[33]. L’absolutisme français des XVIe et XVIIe siècles repose donc sur un système de droit. À la différence de nos démocraties et de nos républiques actuelles, l’absoluité du monarque reposait sur une obéissance de ses sujets, où son jugement devenait le seul vecteur de légitimité. Les gouvernés devaient désormais s’en remettre à lui et espérer que, par sa « surhumanité en tant que monarque », qu’il serait en mesure de transcender ses désirs égoïstes du pouvoir, afin d’apporter les réformes nécessaires répondant ainsi à leurs maux sociétaux[34].
Le prince devint dorénavant le centre d’une nouvelle sacralité, exprimée cette fois par le corps physique de ce dernier. Le règne de Louis XIV le démontre, où l’équilibre entre la dépersonnalisation du monarque et l’hyperpersonnalisation de l’autorité – c’est-à-dire où l’identité et la personnalité individuelles de Louis XIV, en tant qu’homme, est détaché du pouvoir au profil d’être transféré vers son devoir de souverain, où il incarne désormais une autorité suprême, l’État, écartant le partage du travail institutionnel – fut maintenu pendant la première moitié du XVIIe siècle. Puis, l’incarnation du monarque perdit sa force « évocatrice de l’invisible » – suite à une série de conjonctures, à la fois militaires, économiques et intellectuelles[35] – pour laisser place à une sacralité, centrée autour d’un homme solitaire, « livré à la relativité de son seul discernement pour gouverner le royaume »[36]. Pour Jouanna, le bilan du règne de Louis XIV demeure ambivalent. D’un côté, le monarque a remporté des succès indéniables : par exemple, il a triomphé de la vérification parlementaire et des risques du consentement de l’impôt par les États généraux[37]. D’un autre côté, l’exécution de sa volonté, principe issu d’une « conséquence théorique de sa justice immanente », était loin d’être une réalité applicable dans l’ensemble de son royaume[38]. Le règne de Louis XIV aura été, dans l’ensemble, caractérisé par la puissance d’un homme ancré dans le visible, et qui aura su incarner magnifiquement cette utopie absolutiste, cet idéal, comme Jacques-Bénigne Bossuet la décrivait dans son Sermon sur les devoirs des Rois (1662). Sans le savoir, l’art de gouverner de Louis XIV, centré sur cette union du vouloir et du pouvoir, avait transformé l’imaginaire politique, où la forte individualisation du pouvoir, en même temps de suggérer la transcendance de l’État, permit un renouvellement des concepts politiques de pouvoir absolu et de prince absolu[39].
Conclusion
Arlette Jouanna a donc réussi, dans Le prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, à proposer une autre vision de l’absolutisme. À défaut de percevoir l’apogée de ce dernier sous Louis XIV, puis son déclin au siècle suivant, il faut percevoir le règne de Louis XIV comme une manifestation simultanée de l’apogée et du déclin de son pouvoir absolu dans l’imaginaire de la société française du XVIIe siècle. En identifiant les guerres de religion comme un moteur de changement, dans l’élaboration d’un nouveau dogme politique, l’historienne montre également comment l’absolutisme, suite aux conflits des XVIe et XVIIe siècles, s’est construit dans l’imaginaire de la société française un dogme politique – centré sur la figure du prince – pour justifier le pouvoir absolu. À cet effet, elle illustre bien le transfert de sacralité entre la cité céleste, appartenant à Dieu, et le monde tangible, étant le Royaume du monarque. Jouanna s’inscrit alors dans un courant historiographique mixte, incluant à la fois les études révisionnistes[40] et les études traditionnelles portant sur l’absolutisme. Comme elle le mentionne, le modèle historiographique révisionniste ne contredit pas forcément la vision traditionnelle de l’absolutisme; s’il y a effectivement eu des contraintes auxquelles le Roi-Soleil a dû se résigner, inversement, la sacralité souveraine qu’il a su incarner lui permit une obéissance absolue de la part de ses sujets. L’historienne s’enracine donc dans cette continuité historiographique d’historiens, comme Robert Descimon et Fanny Cosandey, s’intéressant à la spécificité du régime absolutiste en l’examinant dans le cadre d’un « édifice théorique justifiant l’autorité politique exclusive du monarque »[41], mais également chez des historiens qui examinent la pratique même du pouvoir absolutiste, en cherchant à identifier les limites du pouvoir à l’apogée du règne louis-quatorzien.
Sans se restreindre au XVIIe siècle français, la notion de pouvoir absolu a continué de susciter de l’intérêt chez les historiens et les intellectuels à travers le temps. En s’intéressant au cadre théorique et à son application pratique, l’historienne n’a pas seulement apporté des connaissances sur cette période fondatrice du pouvoir politique, elle nous convie, encore une fois, à saisir comment s’opère la construction du pouvoir politique. Les conclusions d’Arlette Jouanna ne devraient pas seulement se retrouver dans les livres d’histoire, mais ils ont, à notre humble avis, tout intérêt à émerger dans l’espace public, où le regard de l’historienne permet de nous faire méditer sur les fondements des régimes politiques contemporains et de leurs limites. Car, derrière le projet savant de l’historienne, se dissimule un enjeu social considérable; produire une représentation du pouvoir monarchique, c’est aussi susciter la réflexion sur les fondements et la légitimité du pouvoir actuel.
Pour en savoir plus
CORNETTE, Joël. L’affirmation de l’État absolu : 1492-1652. Paris, Hachette, 2009, 320 p.
CORNETTE, Joël. La France de la monarchie absolue : 1610-1715. Paris, Éditions du Seuil, 1997, 576 p.
DELACROIX, Christian, François DOSSE, Patrick GARCIA et Nicolas OFFENSTADT, dir. Historiographies. Concepts et débats. Paris, Gallimard, 2010, 2 v., 1325 p.
DRÉVILLON, Hervé et Joël CORNETTE. Les rois absolus : 1629-1715. Paris, Belin, 2011, 640 p.
JOUANNA, Arlette. Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne : 1559-1661. Paris Fayard, 1989, 504 p.
JOUANNA, Arlette. Le pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté. Paris, Gallimard, 2013, 436 p.
JOUANNA, Arlette. Le Prince absolu. L’apogée et le déclin de l’imaginaire monarchique. Paris, Gallimard, 2014, 333 p.
MUCHEMBLED, Robert. Le temps des supplices de l’obéissance sous les rois absolus : XVe-XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 1992, 259 p.
[1] Arlette Jouanna, Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris, Gallimard, 2013, p. 9.
[2] Arlette Jouanna, Le Prince absolu. L’apogée et le déclin de l’imaginaire monarchique, Paris, Gallimard, 2014, p. 245-246.
[3] A. Jouanna, Le Pouvoir absolu…, p. 9.
[4] A. Jouanna, Le Prince absolu…, voir p. 252-254.
[5] J.-J. Rousseau, Du contrat social, tome III, livre II, chap.4, cité dans Ibid., p. 254.
[6] Ibid., p. 39.
[7] Ibid., p. 40.
[8] Idem.
[9] Ibid., p. 41.
[10] Ibid., p. 42.
[11] Pour les libertins, l’obéissance leur permettait de se détacher des préoccupations mondaines, notamment de savoir si le pouvoir était bon ou mauvais. Leur objectif était de maintenir leur tranquillité en minimisant toute possibilité de changement, car ce dernier amenait le risque d’y introduire un désordre non désiré. Voir Ibid., p. 49.
[12] Ibid., p. 56.
[13] Ibid., p. 13.
[14] Idem.
[15] Ibid., p. 92.
[16] Ibid., p. 92.
[17] Ibid., p. 93.
[18] Idem.
[19] Ibid., p. 96.
[20] Ibid., p. 98.
[21] Ibid., p. 105.
[22] Idem.
[23] Ibid., p. 113.
[24] Idem.
[25] Ibid., p. 117.
[26] Ibid., p. 112.
[27] Ibid., p. 111.
[28] Ibid., p. 112.
[29] Ibid., p. 58.
[30] Idem.
[31] Idem.
[32] Ibid., p. 59.
[33] Idem.
[34] Ibid., p. 71.
[35] Ibid., p. 208.
[36] Idem.
[37] Ibid., p. 223.
[38] Idem.
[39] Idem.
[40] Le modèle révisionniste présuppose que Louis XIV ne fut pas entièrement libre d’exercer sa liberté, suite aux contraintes que le roi subissait de la part de certains de ses sujets, ce dernier était forcé de coopérer afin d’arriver à exercer son pouvoir. Il se différencie du modèle traditionnel, qui suppose que le règne de Louis XIV fut le triomphe de l’absolutisme, où la volonté du monarque aurait été un signe de sa puissance absolue.
[41] Nicolas Schapira, « Absolutisme », dans Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, dir., Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, 2 v., p. 946.
Articles sur les mêmes sujets