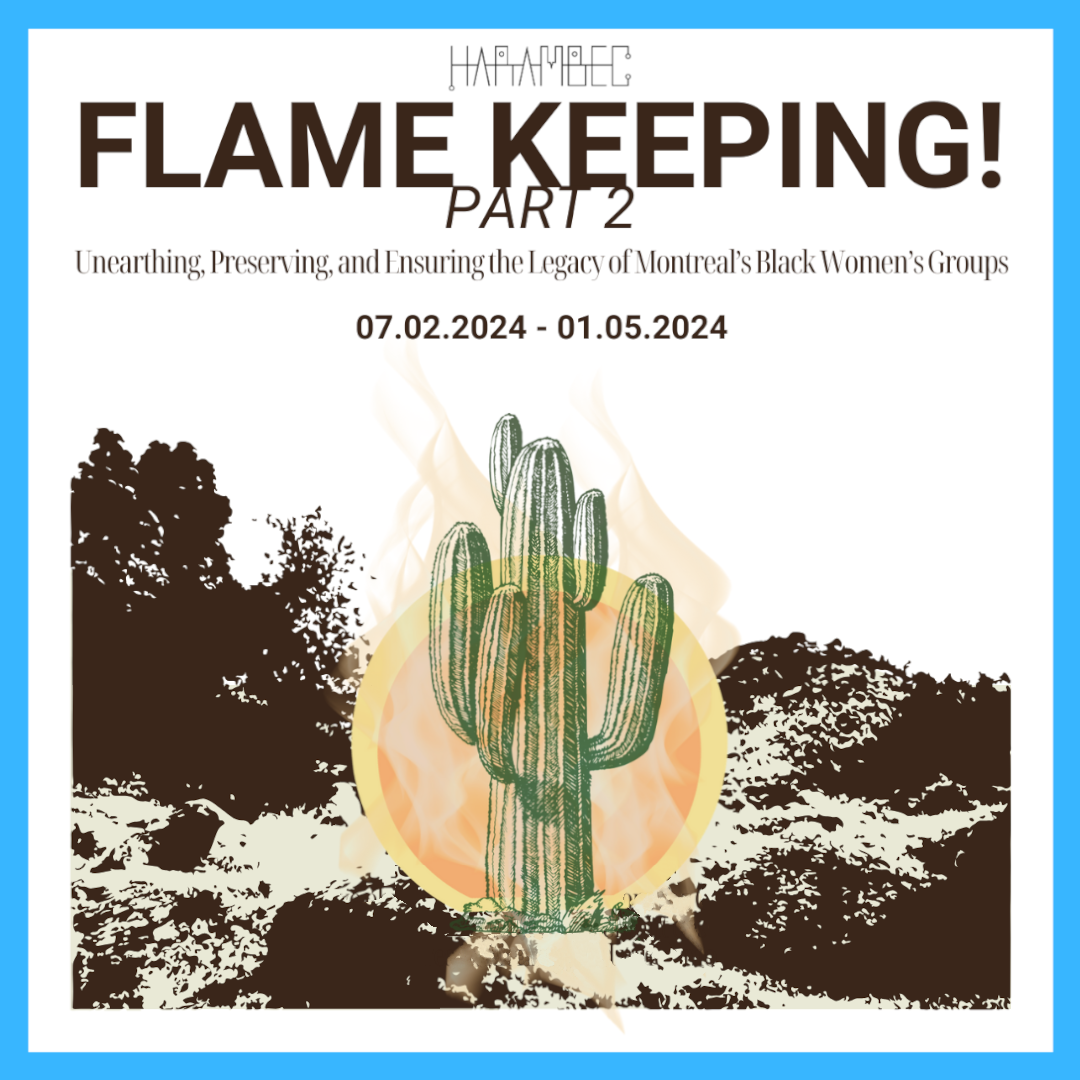Les programmes d’histoire appliquée se font rares dans les universités canadiennes*
6 min
Olivier Côté, Université Laval
Version PDF
L’histoire appliquée est, pour reprendre la définition de l’historien Lyle Dick, avant tout modelée par et pour le grand public. Elle comprend plusieurs domaines d’application : celui d’abord de la muséologie; celui ensuite de la mise en récit du passé dans la littérature; celui, plus récent, de la mise en forme télévisuelle et cinématographique du passé et de la conception de sites Internet à caractère historique. Citons ici les exemples récents des sites HistoireEngagee.ca et Activehistory.ca, qui ont l’ambition de situer les enjeux actuels dans une perspective historique. On peut aussi répertorier, au nombre des pratiques en histoire appliquée, l’expertise historienne dans le domaine judiciaire.
Tandis que les domaines d’application de l’expertise historienne se multiplient depuis les 30 dernières années, qu’en est-il de la formation historienne offerte actuellement dans les universités ? S’adapte-t-elle à cette nouvelle réalité ?
Une manière de mesurer ce niveau d’adaptation est de recenser les cours d’histoire sur ce sujet offerts en 2011 dans l’ensemble des universités canadiennes. Bien malin celui qui pourrait mesurer la totalité de l’offre de cours, considérant la variabilité des titres des cours et des variations de l’offre de cours d’une session à l’autre. Cela, c’est sans compter tous les cours offerts sur la mémoire, le patrimoine et l’histoire de l’histoire. Il faut aussi recenser dans le lot l’application, à l’Université Laval, d’une activité d’intégration et de transition obligatoire aux étudiants en fin de baccalauréat, qui vise à assurer la transition des étudiants vers le marché du travail.
Une autre façon de mesurer l’adaptation des programmes d’histoire à la nouvelle réalité du marché du travail est de répertorier les programmes universitaires offerts en histoire appliquée. Au baccalauréat, sur un total de 52 universités qui offrent un programme d’histoire de 1er cycle, on compte un profil « Histoire appliquée avec stage » (« Public history with intership ») à l’université Concordia (Montréal) et une majeure en histoire appliquée à l’université Bishop (Sherbrooke).
Sur une quarantaine d’universités canadiennes qui offrent des programmes d’histoire d’études supérieures, seulement trois universités proposent un programme d’histoire appliquée à la maîtrise. Il s’agit de la Carleton University, de l’University of Western Ontario et de l’Université du Québec à Montréal, la seule université francophone à offrir un tel programme. L’University of Waterloo a cessé d’offrir un programme de ce type en 2005.
Les études doctorales en histoire, le tremplin traditionnel qui mène à une carrière universitaire, sont orphelines d’un programme en histoire appliquée, bien que l’offre de cours puisse parfois suppléer cette faiblesse et que nombre d’universités donnent à leurs étudiants la possibilité de se spécialiser dans ce domaine. C’est dire qu’à tous les cycles l’histoire appliquée est surtout offerte au Québec et en Ontario, reflet hypothétique de la concentration géographique des offres d’emploi publiques et privées dans les domaines de prédilection de l’histoire appliquée.
On compte aussi quelques programmes de maîtrise en gestion de documents administratifs et en archivistique (Université Laval, University of British Columbia), de même qu’au doctorat (University of British Columbia). C’est sans compter les programmes en muséologie et en gestion muséale, qui ne sont que partiellement liés à la diffusion de l’histoire (Université Laval, Université du Québec à Montréal, University of Toronto, Ryerson University, University of Alberta), et les microprogrammes qui constituent un tremplin vers le monde de l’enseignement (DESS notamment).
Comment expliquer cette mauvaise répartition des programmes, du moins sur le plan géographique, et leur rareté ? Comment expliquer que, d’une part, la demande sociétale pour l’expertise historienne se diversifie et que, d’autre part, la vaste majorité des universités n’offre pas de profil ou de programme en histoire appliquée ? Nous nous retrouvons ici avec le paradoxe de l’œuf et la poule : assiste-t-on à la fixation de l’offre en histoire appliquée par les choix de cours des étudiants? Ou s’agit-il plutôt que le milieu universitaire s’en remet, pour l’essentiel, à des cours optionnels, souvent donnés par des chargés de cours de passage ou par de trop rares professeurs dont l’histoire appliquée est souvent un champ d’expertise secondaire ? Une troisième explication possible pourrait être qu’une bonne part des historiens universitaires perçoivent encore l’histoire appliquée comme un champ de recherche et d’expertise d’importance négligeable aux rudiments encore mal définis.
Avec l’embauche, de plus en plus restreinte, de nouveaux professeurs d’université en histoire, nous sommes en droit de nous demander pourquoi la formation universitaire aux cycles supérieurs est encore largement confinée dans la voie universitaire dite classique. Certes, c’est par la professionnalisation de leur formation que les historiens ont acquis leurs lettres de noblesse dans l’étude du passé; c’est également par leur formation universitaire qu’ils ont été et sont encore habilités à exercer leur capacité d’analyse et de recherche au plus grand bénéfice de la société. Certains seraient peut-être tenté de dire, évoquant l’importance du maintien de l’indépendance des universités si chèrement gagnée: l’université devrait-elle s’adapter aux demandes du marché du travail ? À cela, je répondrais par deux questions, qui s’inspirent de préoccupations éminemment étudiantes: ne devrait-on pas mieux outiller les étudiants, singulièrement ceux des cycles supérieurs, aux domaines d’application de l’histoire en dehors de l’université, sinon les prémunir contre cette idée que l’historien n’a pas de débouché en dehors de l’université, que la seule voie valable soit celle de l’historien universitaire de carrière? Ne pourrait-on pas s’assurer de la formation minimale de l’étudiant des cycles supérieurs à communiquer en dehors du cénacle universitaire ?
Pour en savoir plus
DICK, Lyle. « Public History in Canada : An Introduction ». The Public Historian, vol. 31, no1, p. 7.
Site Internet http://www.universityaffairs.ca/history-for-the-people.aspx, consulté le 13 février 2011.
*Article publié dans le Bulletin de la Société historique du Canada. Titre original de l’article: Le point sur la présence de l’histoire appliquée dans les universités canadiennes.
Articles sur les mêmes sujets