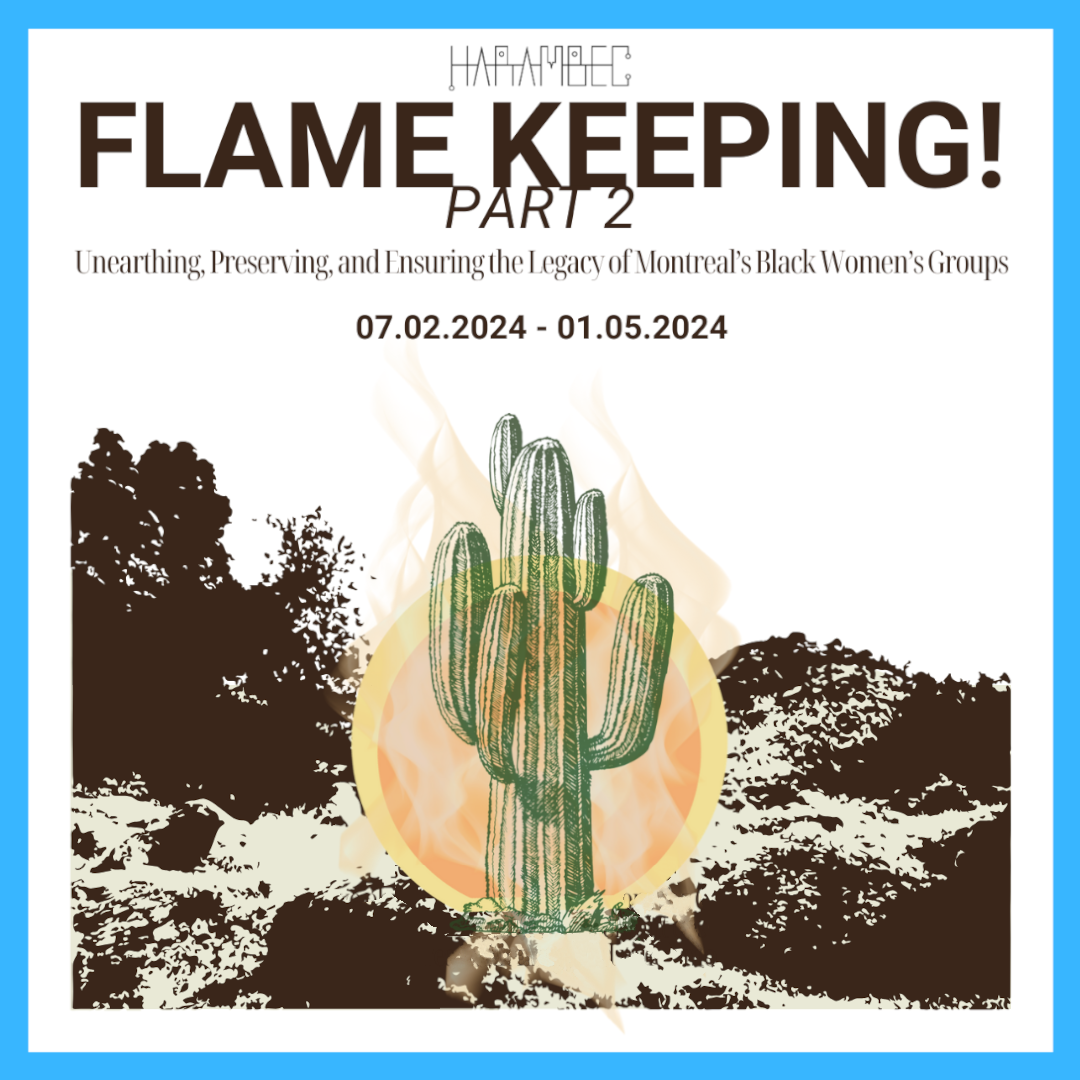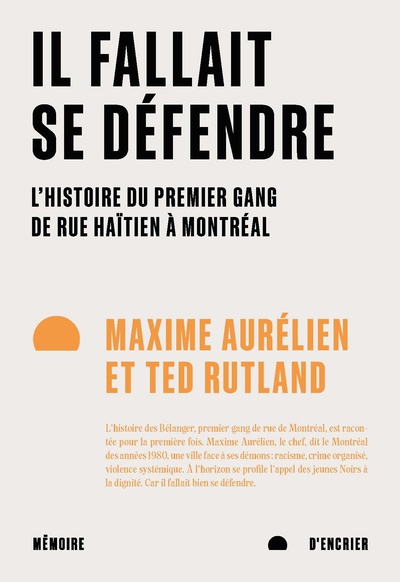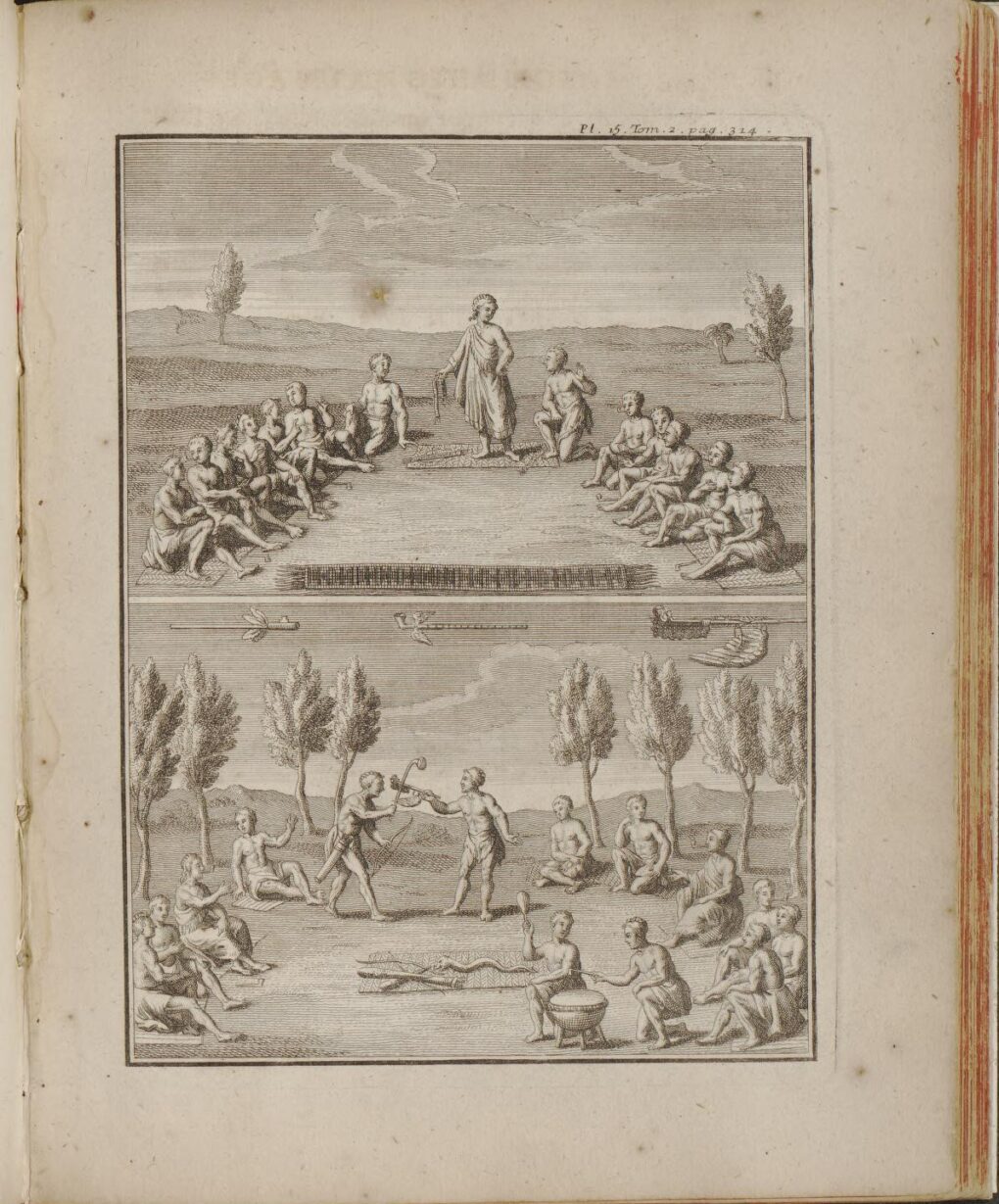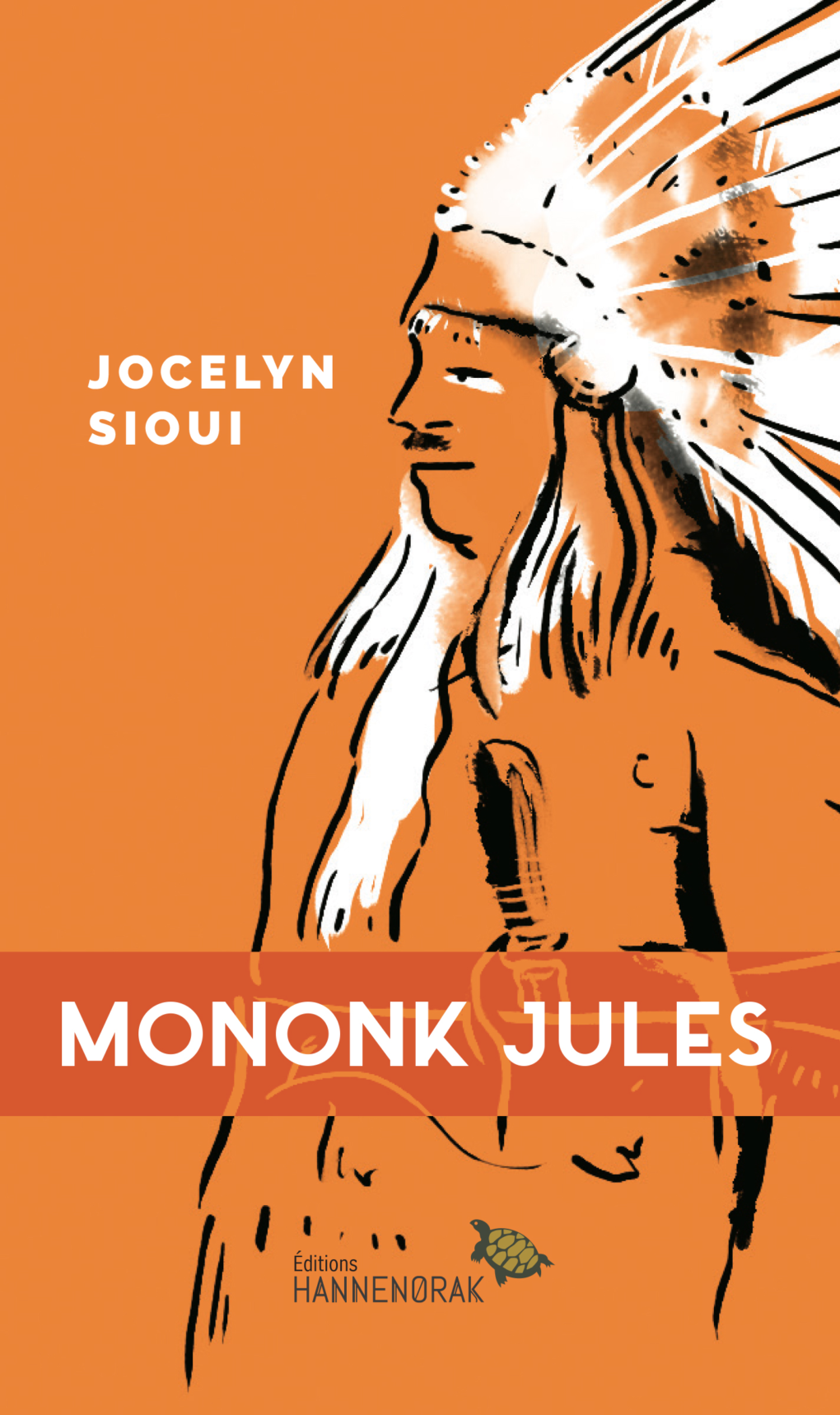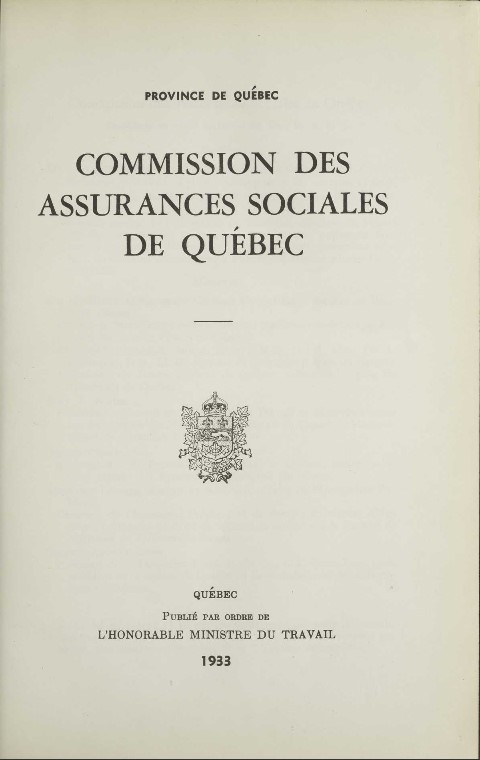Sujet : Québec
Lorsque des questions démocratiques liées à la liberté d’expression, à la critique des médias et à l’activisme archivistique se croisent, on pourrait s’attendre à une plus grande attention politique et médiatique dans l’affaire de la Coalition sortons les radios-poubelles devant les tribunaux.
Lire + d'articles ↓