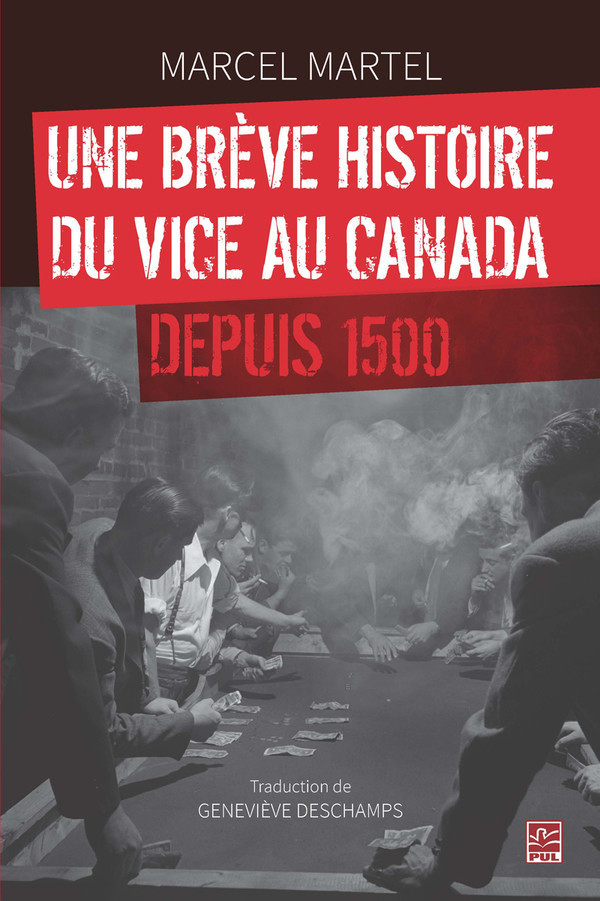Entretien avec Lucie Dagenais — deuxième partie*
Par Cory Verbauwhede

Crédit : Le Travail, vol. XI, no. 6, Montréal, Qc, juin 1964
Cette deuxième partie d’entrevue (voir la première partie) porte sur le conflit de travail de 1964 entre l’Alliance des infirmières de Montréal (AIM-CSN) et une vingtaine d’hôpitaux francophones gérés par des communautés religieuses. Ce conflit, moins bien connu que la grève des infirmières de Sainte-Justine en 1963 et que la grève générale dans les hôpitaux du Québec en 1966, constitue pourtant un point tournant dans les relations du travail entre les personnels et les directions des établissements au sein du système de santé québécois : la démission choc du président du tribunal d’arbitrage, le juge Paul L’Heureux, au cours de ce conflit a aussi contribué à mettre fin au régime de relations du travail d’exception dans les services publics.
L’action des infirmières s’inscrit alors dans la démarche de la Fédération nationale des services FNS-CSN, résolument engagée depuis 1962 dans l’harmonisation des conditions de travail au sein de tous les hôpitaux du Québec, étape nécessaire pour instituer un service public vraiment universel, qui offre des services comparables à travers la province.
Lucie Dagenais a participé à ce conflit en tant que conseillère syndicale auprès de l’Alliance des infirmières de Montréal (AIM-CSN), poste qu’elle a occupé de 1962 à 1970.
Cory Verbauwhede : Nous avons discuté lors de notre premier entretien des conflits à l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1962 et à Sainte-Justine en 1963. Pourquoi s’attarder plus particulièrement au conflit de travail des infirmières de 1964 ?
Lucie Dagenais : C’est principalement le conflit de 1964 qui a mis fin au déséquilibre des droits entre salariés publics et privés, qui existait depuis l’adoption, en 1944, de la Loi des relations ouvrières et de la Loi des différends entre les services publics et leurs salariés. Ce régime législatif octroyait un droit de grève – très encadré – aux syndiqués du secteur privé, mais l’enlevait à ceux des services publics. C’est en partie grâce à l’action audacieuse d’un petit nombre d’infirmières que le Code du travail, adopté le 22 juillet 1964, a étendu le droit de grève aux employés des hôpitaux et des autres « services publics », ce qui n’avait pas du tout été l’intention de départ du gouvernement. La possibilité de faire la grève a par la suite fait avancer les droits des syndiqués du secteur public d’une manière qui aurait été inconcevable sous l’ancien régime de relations du travail.
Comme le disait le directeur des services à la Fédération nationale des services (FNS devenue maintenant la FSSS), la discrimination et l’infériorisation du personnel des hôpitaux étaient inscrites au sein même des diverses lois du travail, à commencer par la loi régissant les différends entre les administrations des services publics et leurs salariés. En 1963, il résumait la condition des employés d’hôpitaux quant aux droits syndicaux, ou plutôt leur absence, en affirmant au début de cette négociation : « Voilà le salarié des services publics privé de son droit de grève et placé en état d’infériorité par le jeu des mesures dilatoires décrétées par la structure juridique elle-même ».1
Or, le conflit de 1963-64 a remis en question le régime d’arbitrage obligatoire et la politique du ministère de la Santé dans le secteur hospitalier.2 Les infirmières ont notamment obtenu la présence officielle du gouvernement à la table de négociation, ce qui a permis de corriger une situation, créée par l’assurance hospitalisation (1961), que l’on qualifiait alors de « fausse ». En effet, c’était le ministre du Travail qui nommait les présidents des tribunaux d’arbitrage et leur donnait leurs directives, c’était le Service de l’assurance hospitalisation qui déterminait les montants versés aux hôpitaux et c’était en définitive le gouvernement qui payait. Pourtant, le gouvernement n’était pas officiellement partie aux négociations. Les gains obtenus au terme de la négociation étaient d’autant plus surprenants que les syndicats de l’Alliance représentaient une minorité des 13 435 infirmières pratiquantes dans 22 hôpitaux sur 147.
CV : Pouvez-vous nous rappeler le contexte immédiat entourant cette menace de grève ?
LD : En 1964, la Révolution tranquille politique commençait à s’essouffler, mais la révolution sociale prenait de l’élan. Les syndicats recrutaient de plus en plus de membres (dans le secteur hospitalier, le nombre de syndiqués est passé de 9 000 en 1960 à 36 000 en 1966), alors que s’organisait aussi la fonction publique proprement dite (ouvriers, fonctionnaires, professionnels du gouvernement provincial). C’était aussi une année de conflits majeurs dans divers secteurs : à La Presse, chez les débardeurs de Montréal, à la Canadian Vickers… et une année de grands débats sur le Code du travail ainsi que sur le Régime de rentes du Québec.
CV : Parlez-nous des problèmes du système d’arbitrage obligatoire et des critiques soulevées par les syndicats.
LD : Les syndicats d’infirmières n’aimaient pas l’arbitrage des conventions. Bien qu’ayant bénéficié d’une première sentence arbitrale très avantageuse après leur premier arbitrage en 1947, les infirmières affiliées à la CSN, de concert avec la FNS et la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC, devenue la CSN), ont rapidement dénoncé la formule d’arbitrage. « Système d’arbitrage et règne de l’arbitraire », disaient-elles. Lors d’un arbitrage, par exemple, un procureur syndical avait demandé à l’administratrice Sœur Marie de L’Ange-Gardien quel était le niveau des salaires à l’Hôpital Saint-Michel Archange. Lorsqu’on lui a fait remarquer que les salaires étaient moins élevés qu’elle ne le disait, elle avait affirmé : « Je suis économe. Je viens de décider que les salaires sont du montant que je viens de mentionner ».3
En 1958, il est revenu aux infirmières de Hull de briser le modèle établi des règlements de conflits dans le secteur hospitalier. L’Association professionnelle des infirmières licenciées de l’hôpital Sacré-Cœur de Hull avait entamé une négociation avec les sœurs de la Providence, représentées par le très dur Arthur Matteau. Le syndicat demandait d’augmenter le salaire de base de 205 $ pour une semaine de 48 heures à 260 $ pour une semaine de 40 heures. Ces demandes ont été ignorées. La partie patronale proposait plutôt des augmentations salariales insignifiantes et la réduction de la semaine de travail de 48 à 44 heures. Réunies en assemblée générale, les infirmières ont manifesté leur désaccord et, à l’unanimité, se sont dit prêtes à interrompre leur travail dès le lendemain et même à démissionner. Puisque la grève était interdite, elles ont effectivement démissionné en bloc le 29 mai 1958. Il est intéressant de noter qu’il n’y avait pas de lignes de piquetage, ni de scabs – j’attribue ce dernier point au grand respect qu’inspiraient leurs actions.
Les négociations se sont terminées après un mois de tractations par une victoire éclatante du syndicat. Les salaires sont passés de 225 $ à 290 $, ce qui faisait des infirmières de Hull celles qui étaient les mieux payées au Québec. La semaine de travail est passée de 44 à 40 heures dès décembre 1958. Les salariées avaient désormais droit à dix fêtes chômées par année. On leur reconnaissait également quatre semaines de vacances après cinq ans de service. Un autre fait important : toutes celles qui avaient démissionné ont pu réintégrer leur poste sans aucune pénalité ni préjudice.
CV : Comment s’est déroulée la négociation menant à l’affrontement final de 1964 ?
LD : Il y avait bien eu quelques grèves, mais l’arbitrage était la règle. En 1963-1964, l’Alliance s’y était soumise, utilisant cette tribune au maximum pour faire connaître la condition des infirmières. La négociation a débuté en avril 1963, avec quatre syndicats d’infirmières. D’autres s’y sont joints entre décembre 1962 et mai 1963. Ils étaient vis-à-vis autant d’hôpitaux qui étaient représentés par leurs associations, fusionnées ou en voie de l’être à l’instigation et même sous la pression des autorités religieuses : « Les directives romaines étaient claires : là où l’État est prêt à assumer les services sociosanitaires, l’Église catholique et ses congrégations doivent se retirer de ce champ d’action ou du moins ne pas entraver la prise en charge totale ou partielle de ces activités par l’État ».4 Nous n’étions pas alors informées de ces politiques, et cela nous aurait été bien utile. Au terme de la négociation, 22 syndicats affiliés à la CSN, provenant surtout de Montréal et de quelques autres régions, ont signé une même convention. Le gouvernement n’était pas représenté officiellement aux négociations, mais il y déléguait un ou des observateurs.
Le comité syndical de négociation comprenait une représentante élue de l’exécutif local de chaque hôpital, dont le rôle était déterminant, ainsi que l’équipe technique de l’Alliance dirigée par deux avocats, Bruno Meloche et Gilles Corbeil, et deux infirmières conseillères syndicales auprès de l’AIM, Géraldine Dumas et moi-même. L’Alliance avait mis sur pied une formation pour les représentantes élues qui visait à leur faire prendre conscience des grands enjeux du monde du travail, de leur rôle social et de la nécessaire solidarité entre les divers groupes. Une telle solidarité était loin d’être acquise : par exemple, dans mon hôpital, les infirmières avaient leur propre cafétéria, séparée de celle des employés généraux et de celle des médecins. On partageait un espace commun seulement la nuit. Les infirmières ne comprenaient pas toujours le contexte plus large et certaines pensaient : « De quoi il se mêle lui [NDLR : le formateur], c’est notre conflit à nous-autres! »
Un jour, alors que l’avocat Bruno Meloche nous avait fait lire à tour de rôle des extraits de lois, une infirmière s’est objectée en disant : « On n’est pas venues ici pour lire des lois ». Bruno lui a répondu : « Si on veut changer le monde, il faut apprendre à lire les lois ». Les assemblées de déléguées étaient fréquentes. On les invitait à noter les problèmes d’organisation du travail et ses conséquences sur la qualité des soins. C’était aussi un moment de débat pour élaborer certaines revendications. Ces rencontres permettaient enfin de partager un bagage commun et ont contribué au fil des événements.
CV : Quelle était la position des directions d’hôpitaux dans tout ce processus ?
LD : Leurs relations avec les déléguées étaient cordiales, mais leurs représentants ne semblaient assumer aucune responsabilité. Ils se justifiaient ainsi : « Cela dépend désormais du gouvernement. Les autorités de la province nous ont en effet prévenues que si nous décidons de négocier des dispositions nouvelles, nous sommes libres de le faire, mais que l’assurance santé ne tiendrait pas nécessairement compte des augmentations de salaires dans les paiements qu’ils devraient nous faire. C’est pourquoi nous ne voulons pas négocier. Si l’arbitrage, par décision exécutoire, nous force à des augmentations, alors le gouvernement devra payer ».5
Après cinq mois de rencontres, la plupart des demandes syndicales avaient été rejetées. C’est pourquoi l’Alliance a demandé la conciliation le 11 juillet 1963, étape nécessaire avant l’arbitrage. Le tribunal était composé du président, le juge Paul L’Heureux, de Me Jean Filion comme arbitre patronal, alors que Marcel Pepin agissait comme arbitre syndical. Pepin, alors secrétaire général de la CSN, avait accepté exceptionnellement d’agir à ce titre, ce qui témoigne de l’intérêt de la direction de la CSN pour la cause des infirmières et, plus largement, de l’importance de ce conflit dans l’évolution des relations de travail dans les hôpitaux et dans les services publics.
À partir d’octobre 1963, l’Alliance a présenté ses arguments en 11 séances. Son procureur, Me Bruno Meloche, a fait entendre une série de témoignages d’infirmières pour prouver la pertinence de leurs demandes. La présidente, Madeleine Morgan, infirmière de Sainte-Justine, a expliqué l’importance de la mise sur pied de comités de nursing, où les plaintes des travailleuses pourraient être entendues. Me Meloche a aussi présenté une étude, préparée par une équipe de recherche de l’Université de Montréal, qui visait à démontrer la pénurie d’infirmières au Québec, en comparaison avec d’autres provinces canadiennes. Ainsi, le nombre de lits par infirmière diplômée était de 3,6 au Québec, alors qu’il était de 2,6 au Canada. Les conclusions démontraient également le manque de formation d’une partie du personnel soignant. Le taux de roulement des infirmières diplômées était d’ailleurs très élevé : près de 60 % d’entre elles travaillaient alors depuis moins de deux ans dans leur établissement. Ceci est à situer dans un contexte où le ratio de lits d’hôpitaux était de 1,86 par 1000 habitants au Québec, alors qu’il était de 1,93 au Canada.
La partie patronale était consciente du mécontentement croissant chez les infirmières, et l’essentiel de sa démarche consistait à solliciter du tribunal une sentence provisoire pour augmenter de 5 $ par semaine l’échelle des salaires en vigueur. L’Alliance a dénoncé cette mesure dilatoire qui ne répondait pas du tout aux nombreuses revendications des infirmières. Nous considérions qu’une telle sentence intérimaire consacrerait la primauté de l’item salaire au détriment des autres questions auxquelles nous attachions encore plus d’importance.
Sur réception de cette réponse, le tribunal a convenu de ne pas procéder, mais plutôt de commencer le délibéré. Mais, à la surprise de tout le monde, le juge L’Heureux a démissionné au terme de sept séances de délibération.
CV : Cette démission a-t-elle eu de grandes conséquences ?
LD : Effectivement, elle a eu une importance politique inattendue. Dans la lettre qu’il a adressée à l’Alliance le 14 mai 1964, le juge L’Heureux s’expliquait ainsi : « Les règlements actuels, dont il semble que tout le monde soit prisonnier, ne me permettent pas de m’acquitter des obligations que j’ai assumées en prêtant le serment d’office […]. Lorsque j’ai acquis la conviction que rien ne serait fait pour remédier au problème et qu’il m’était impossible, dans les circonstances, de rendre une décision juste et équitable pour les parties, à la satisfaction de ma conscience, j’ai prié le Ministre concerné de ne pas renouveler le mandat de ce conseil d’arbitrage qui était déjà expiré. »
À la suite de cette démission, le gouvernement a nommé le juge Ignace Deslauriers pour remplacer le juge L’Heureux. À l’assemblée suivante du Conseil général de l’AIM, Madeleine Morgan déclara : « Après 15 mois de procédure, les infirmières ne sont pas prêtes à tout reprendre à zéro. La présence du gouvernement nous apparaît indispensable puisque, en dernier lieu, c’est lui qui doit solder le coût. D’ailleurs, nous ne sommes pas les premières à poser un tel geste. Il en fut ainsi pour les radiologistes, les pathologistes, les hématologistes et les internes des hôpitaux, qui ont procédé à des pourparlers directs avec le ministère de la Santé ».6
Les infirmières se déclarèrent alors prêtes à se rendre jusqu’à la grève plutôt que de reprendre la procédure d’arbitrage. Elles ont voté une résolution demandant une rencontre aux représentants du gouvernement et des hôpitaux pour trouver une solution rapide. Une telle rencontre a eu lieu au bureau du ministre de la Santé. Le ministre a accepté que les négociations directes reprennent en présence des délégués du gouvernement : Roch Bolduc et Gaston Cholette, auxquels s’est joint le sous-ministre du Travail, Donat Quimper, qui a agi comme médiateur à compter du 1er juin. La vieille procédure d’arbitrage ne tenait plus.
Bien rapidement, les infirmières ont toutefois réalisé que le gouvernement n’était pas leur allié. Rappelons que Lesage avait promis de mettre en place l’assurance-hospitalisation (réalisée en 1961), mais aussi de ne pas augmenter les impôts. Évoquant sa préparation du budget avec ses ministres, son biographe écrit que « les négociations opiniâtres mettaient en lumière l’optique essentiellement conservatrice de Lesage en matière de finances publiques. Dans les affaires privées, il jugeait les dettes intolérables ».7 Entre les attentes de la population, l’extension du syndicalisme et le conservatisme financier du gouvernement, la table était mise pour des affrontements d’une nouvelle nature dans le secteur hospitalier.
Lors des premières rencontres, les représentants gouvernementaux ont remis sur la table les propositions des hôpitaux, déjà rejetées deux fois par l’Alliance. Il y avait entente sur des questions secondaires, mais aucune avancée sur les priorités de l’Alliance : comités de nursing, promotion des laïques aux postes d’hospitalières et augmentation des salaires. Manifestant leur impatience, 800 membres réunies en assemblée générale, par un vote de 97 %, ont autorisé le comité exécutif à convoquer toutes ses membres à des « journées d’étude », c’est-à-dire à des arrêts de travail concertés, dès qu’il le jugerait à propos.
Commençait alors une joute entre les syndicats et le gouvernement. Des contacts de Jean Marchand, président de la CSN, ont alors tenté d’attirer l’attention du Premier ministre Lesage par l’intermédiaire de René Lévesque. La mobilisation était difficile. La présidente de section de l’Hôtel-Dieu de Montréal affirma : « Ce qui frappe à première vue, c’est l’état de lassitude des infirmières qui semble causé par la trop grande tension et longue attente. Également une perte de confiance envers le syndicat […] ».8 D’autres déléguées insistaient pour « sortir » sans délai. L’été approchait et certaines étaient pressées de recevoir les augmentations salariales. Il était difficile de maintenir la cohésion du groupe. Pour encourager les infirmières, Madeleine Morgan, une leader naturelle, pouvait monter sur les tables pour inciter les infirmières à continuer la lutte, en rappelant qu’« on ne fait pas ça pour nous autres, on fait ça pour les malades ». Lesage, pour sa part, était furieux. Ce n’était pas de gaieté de cœur qu’il avait autorisé des négociations avec un syndicat qui menaçait de faire la grève !
Finalement, le 8 juin, à la suite de la rencontre entre le président de la CSN et le Premier ministre, c’est à l’Assemblée législative du Québec que ce dernier a annoncé la reprise des pourparlers avec l’Alliance. Ce n’est que grâce à une sérieuse menace de grève illégale que la véritable négociation a commencé.
CV : Quelles étaient les priorités des infirmières ? Quels ont été les gains ?
LD : Ce conflit marque en définitive la fin de l’arbitrage des conventions collectives dans les établissements de santé : le 22 juillet 1964, le Code du travail a octroyé le droit de grève, à partir du premier septembre, aux employés syndiqués des hôpitaux – et seulement plus tard aux fonctionnaires provinciaux, aux enseignants et à d’autres.
La convention a été adoptée le 17 juin 1964 par un vote de 95 % des membres réunies en assemblée générale. En termes de structures, les syndicats étaient passés de la négociation locale à la négociation regroupée de tous les syndicats d’infirmières affiliées à la CSN, assurant la quasi-parité des salaires et autres conditions de travail.
La reconnaissance des comités de nursing avait été notre première priorité, et nous l’avions obtenue. Il y avait en effet une volonté de participation aux décisions concernant l’organisation des soins, qui s’exprimait principalement dans la revendication d’un comité de nursing dans chaque établissement. Ainsi, la convention négociée débordait le cadre traditionnel des conditions habituellement prévues dans les conventions (durée du travail, salaire et avantages sociaux, protection de l’emploi, sécurité syndicale), puisqu’elle mettait en place des mécanismes d’intervention collective sur l’organisation du travail. Ces comités de nursing auraient la responsabilité d’examiner le fardeau de travail ainsi que toute autre question d’organisation rapportée par les infirmières. À défaut d’entente, un arbitre trancherait. Parallèlement, la convention limitait les droits de gérance des employeurs. Il s’agissait d’une procédure de grief simplifiée qui donnait la possibilité de présenter un grief sur tous les éléments des conditions de travail, même si cela n’était pas abordé dans la convention.
Notre deuxième priorité était une « clause de promotion » qui visait à permettre l’accès aux postes d’hospitalières pour les infirmières laïques (voir la première partie de notre entretien). Les infirmières étaient particulièrement choquées par ce privilège injustifié qu’avaient les religieuses. Mais l’idée de l’abolition de ce privilège provoquait une résistance énorme du côté patronal, surtout chez les sœurs de la Providence qui contrôlaient un grand nombre d’hôpitaux.
CV : Pourquoi n’avez-vous pas eu gain de cause sur la question de ces privilèges ?
LD : Il faut se reporter à l’époque pour mesurer le pouvoir des communautés religieuses qui étaient propriétaires et contrôlaient la majorité des établissements de santé.
Dans ses mémoires intitulés Au service du Québec, l’ancien haut fonctionnaire Gaston Cholette raconte qu’au cours de la médiation, l’« économe » des sœurs de la Providence avait déclaré : « Nous tenons pour essentielle à notre efficacité la pratique selon laquelle nous faisons circuler nos religieuses d’un hôpital à l’autre en leur réservant partout la fonction d’hospitalière. Si un jour il devenait impossible de continuer à agir ainsi dans les hôpitaux québécois, nous nous retirerions du Québec et irions ailleurs ».9
Dans le même livre, Gaston Cholette rapporte que Jean Lesage et le ministre Couturier ont pris au sérieux cet avertissement. Jean Marchand, ne voulant pas que le conflit tourne en guerre ouverte contre les communautés religieuses, est intervenu auprès de l’AIM pour faire miroiter les gains substantiels obtenus par ailleurs et faire accepter le fait que la promotion au poste d’hospitalière s’obtiendrait par étapes. La convention de 1964 n’a donc finalement pas reconnu la « clause promotion » que nous demandions, à la grande déception de l’organisation syndicale.
Après la signature de la nouvelle convention, l’exécutif de l’Alliance a recommandé à ses responsables d’identifier dans chaque hôpital des religieuses hospitalières afin de remettre en question leur compétence et de vérifier leur inscription au registre de l’Association des infirmières du Québec. L’on a pu constater que certaines n’étaient même pas infirmières. Cette lutte a culminé lors de la grève générale de 1966. Cette fois, les hôpitaux ont été mis sous tutelle par le gouvernement et celui-ci a enfin mis un terme à ce privilège des infirmières religieuses.
CV : Qu’en était-il des autres conditions de travail ?
LD : Après la création des comités de nursing et la promotion des laïques aux postes d’hospitalières, la question des salaires était la troisième priorité du syndicat. Alors qu’on déplorait la pénurie d’infirmières, on faisait remarquer que les bas salaires n’étaient pas de nature à retenir celles-ci dans la profession. De plus, les années d’expérience ne valaient que pour l’établissement concerné, et n’étaient pas transférables d’une institution à l’autre. La reconnaissance de l’expérience acquise dans tout le réseau représentait un gain important pour bon nombre des membres, tout comme la pleine rétroactivité des salaires au début des 15 mois de négociation. C’était l’un des reproches que l’on faisait aux arbitrages, qui n’octroyaient la rétroactivité que rarement. Le salaire de base d’une infirmière en service général passait ainsi de 66,50 $ à 82 $ par semaine, en plus de nombreuses primes.
Les avantages sociaux faisaient également partie de nos priorités. À cet égard, c’est le congé de maternité qui constituait une nouveauté pour une convention collective. Nous demandions un congé de maternité sans solde, considérant, après un débat difficile, que ce n’était pas à l’employeur, mais à l’État de rémunérer un tel congé. Les quatre semaines de vacances, après un an de service, ont été pour leur part obtenues sans trop de difficultés pour les infirmières. Cette mesure existait déjà dans certains hôpitaux.
L’instauration d’une caisse de retraite obligatoire, financée par les cotisations syndicales et patronales paritaires, dans les hôpitaux était une autre première dans une convention collective au Québec. Cette revendication, avancée par une minorité de membres du syndicat, avait rencontré une forte résistance dans l’organisation. Plusieurs membres croyaient qu’elles « ne se rendraient pas là ». Le comité de négociation craignait tellement que cette revendication soit rejetée par les membres qu’il avait demandé l’assistance de Jean Marchand, alors président de la CSN, pour convaincre l’assemblée générale de son importance.
Nous demandions enfin, et avons obtenu, la formule « Rand », que nous considérions comme essentielle à la bonne entente entre toutes les bénéficiaires de la convention collective. Toutes les salariées, syndiquées ou non, devraient désormais participer au financement du syndicat par une cotisation perçue par l’employeur.
CV : Que retenez-vous de cette histoire passionnante ?
LD : L’Alliance des infirmières de la CSN avait mis en place des moyens exceptionnels pour faire valoir les revendications, qui ont durablement marqué les négociations collectives au Québec. L’implication directe des membres à toutes les étapes des négociations, la clairvoyance et l’audace des dirigeants syndicaux, la qualité des communications avec les médias, tout cela a permis de vaincre l’obstruction patronale et d’imposer la libre négociation dans le secteur hospitalier.
Une intervention de Pierre Vadeboncoeur au congrès de la CSN de 196410 a été un baume après tant de mois de lutte :
C’est avec beaucoup d’émotions que j’ai retracé les événements de cette période. J’ai beaucoup d’admiration pour les militantes qui ont mené ce combat et pour la CSN qui nous a soutenues.
À écouter les informations sur les conflits entre les personnels et les directions hospitalières et ministérielles, je déplore qu’aient été mis de côté les mécanismes obtenus alors, qui s’appuyaient davantage sur la parole et le point de vue des soignantes à la base, dans des établissements à taille humaine. Comment peut se faire entendre la parole des infirmières sur le terrain dans les structures archi-complexes mises en place dans la dernière décennie ? Il faut espérer que le système de santé québécois retrouve sa bonne réputation et sa bonne humeur.
Dans la troisième et dernière entrevue, nous couvrirons la grève provinciale des hôpitaux de 1966.
*Cet article a d’abord été publié sur le blog du Centre d’histoire des régulations sociales
Pour aller plus loin :
Madeleine Morgan, La colère des douces, La grève des infirmières de Sainte-Justine en 1963, Montréal, CSN, 2003.
Luc Desrochers, Une histoire de dignité. FAS (CSN) 1935-1973, Beauport, Qc., MNH, 1997.
Gaston Cholette, Au service du Québec. Souvenirs, Sillery, Qc., Septentrion, 2010.
Martin Petitclerc et Martin Robert, Grève et Paix, Montréal, Lux, 2018.
Références
1 Jacques Archambault, « Le salarié en face des lois ouvrières », Relations industrielles, vol. 13, no 4, octobre 1957, p. 360.
2 Fédération nationale des services, CSN, Procès-verbal du Congrès 1964, p. 18.
3 André Valiquette, Entrevue de Pierre Vadeboncoeur 8/3/83.
4 Luc Desrochers, Une histoire de dignité. FAS (CSN) 1935-1973, Beauport, Qc., MNH, 1997, p. 186.
5 Ibid, p. 175.
6 Le travail, vol. XL, no 6, juin 1964, p. 6.
7 Dale C. Thomson, Jean Lesage et la Révolution tranquille, trad. Francis Dufau-Labeyrie, Saint-Laurent, Qc., Éditions du Trécarré, 1984, p. 233.
8 AIM, Rapports des présidentes de sections, archives non organisées de Madeleine Morgan, 15 juin 1964.
9 Gaston Cholette, Au service du Québec. Souvenirs, Sillery, Qc., Septentrion, p. 110.
10 Voir le procès-verbal du congrès, page 225.
Articles sur les mêmes sujets