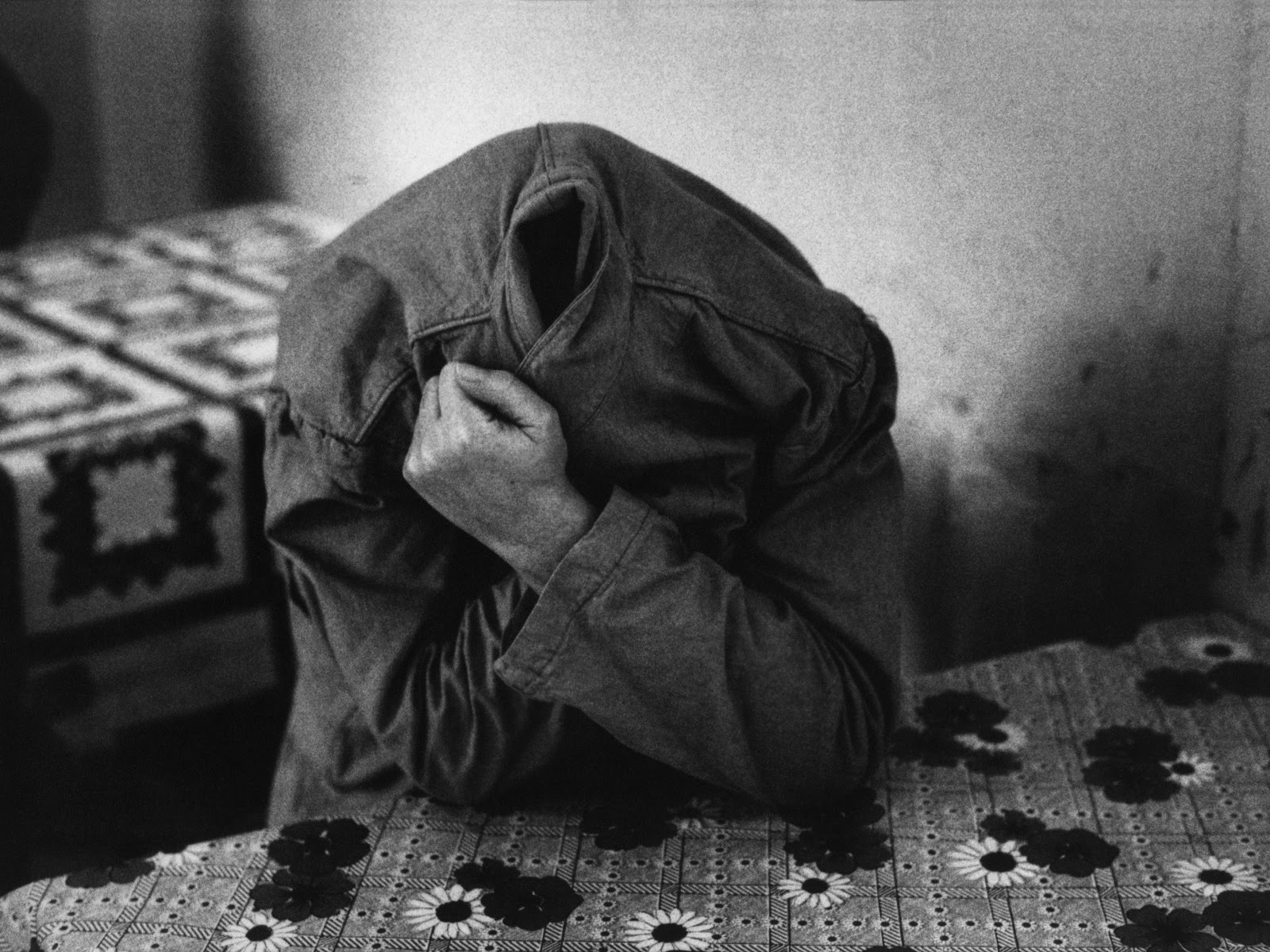La bataille de Saint-Léonard : des héros oubliés, des tensions toujours vivantes
Citer cet article
APA
Leclerc, J. (2025). La bataille de Saint-Léonard : des héros oubliés, des tensions toujours vivantes. Histoire Engagée. https://histoireengagee.ca/?p=13247Chicago
Leclerc Jean-François. "La bataille de Saint-Léonard : des héros oubliés, des tensions toujours vivantes." Histoire Engagée, 2025. https://histoireengagee.ca/?p=13247.Jean-François Leclerc, historien, muséologue et consultant

J’aime les documentaires d’histoire. Ils ont l’avantage de nous immerger dans le passé par la magie des images d’archives. Mais les documentaristes partagent avec le muséologue que je suis le même défi : faire revivre et comprendre le passé de manière accessible en allant au-delà des clichés historiques transmis par les médias et la mémoire populaire.
Si on en juge par la couverture de presse du documentaire La bataille de Saint-Léonard, il semble que le réalisateur Félix Rose ait gagné ce pari. Il ne faut pas s’en étonner. Même si ce documentaire a mis de nombreuses années avant d’arriver sur nos écrans, l’évènement sur lequel il se penche touche deux thèmes récurrents dans notre histoire, plus présents que jamais dans l’actualité québécoise : la défense de la langue française et l’immigration. En effet, les braises des crises linguistiques allumées dans les années 1960 ne se sont jamais tout à fait éteintes. Quant à notre relation ambivalente à l’immigration, elle remonte au 19e siècle, alors que l’afflux de personnes en provenance de l’Irlande, chassées par la famine, bouleversait le portrait démographique et linguistique des grandes villes du Bas-Canada.
Les évènements retracés par le réalisateur Félix Rose prennent place à la fin des années 1960, dans une banlieue montréalaise en émergence. Le Québec venait à peine de se réveiller un peu bougon de 1967 « où tout était beau. C’était l’année de l’amour, c’était l’année d’l’Expo », comme le chantait Beau dommage. De ce documentariste, fils du felquiste Paul Rose et membre d’une famille militante indépendantiste de gauche, on aurait pu s’attendre à un regard politiquement orienté. Mais ce trentenaire élevé dans un Laval multiculturel et ouvert sur le monde a réussi à prendre un pas de recul, remettant en scène ces évènements d’une manière nuancée et respectueuse des parties en présence, sans en refroidir l’intensité, pour le plus grand plaisir de l’auditoire.
Deux décisions ont mené à cette crise linguistique aux répercussions politiques majeures. À Saint-Léonard, la communauté immigrante italienne, qui s’était installée en grand nombre dans cette municipalité francophone depuis le début de la décennie 1960, préférait envoyer ses enfants dans les classes bilingues mises sur pied sous le gouvernement Lesage. Fondé par Victor Lavigne, un résident de longue date[1], et présidé par l’architecte et indépendantiste Raymond Lemieux, le Mouvement pour l’intégration scolaire (M.I.S) a fait élire sa représentation à l’élection scolaire de 1968, ce qui a amené la commission scolaire locale à mettre fin à cet accommodement linguistique. Peu après, pour économiser sur les frais de transport, la commission scolaire régionale a décidé de transférer ses élèves anglophones à l’école Aimé-Renaud, pourtant la seule de niveau secondaire accueillant les francophones du secteur. L’occupation subséquente de cette école par ses élèves francophones et une violente émeute sur la rue Jean-Talon en 1969 ont conféré à ce conflit local une dimension nationale. Des débats politiques et manifestations subséquentes qui ont suivi ont découlé les lois 63 (1969) et 22 (1974), vivement contestées, puis la Charte de la langue française, ou Loi 101, qui a été adoptée sous le gouvernement du Parti québécois en 1977.
Félix Rose nous présente un portrait sensible et humain des porte-paroles de visions opposées qui ont fait l’histoire. D’un côté de l’arène montréalaise de cette bataille, Mario Barone, d’origine italienne, est un farouche partisan du libre choix. Il est l’exemple type de l’immigrant ayant commencé sa vie nord-américaine comme modeste journalier avant de devenir un prospère entrepreneur en construction. Son histoire personnelle nous fait entrer dans une communauté italienne issue de la nouvelle vague d’immigration qui, à compter des années 1960, ne s’installe plus dans des quartiers ouvriers où se mêlent diverses populations, dont des francophones, mais dans les nouvelles banlieues avec ses propres commerces, institutions et lieux de culte. Pour Barone, comme pour ses compatriotes qui vivent à Saint-Léonard, l’anglais est vu comme un facteur de mobilité sociale, ce qui n’est pas le cas du français.[2]
De l’autre côté du ring, un résident à Saint-Léonard, l’architecte Raymond Lemieux, est quant à lui issu d’une famille franco-américaine en voie d’assimilation linguistique, où frères et sœurs parlent l’anglais à la maison, à cheval entre des identités qui fluctuent sans cesse. Il prend pourtant fait et cause pour le français langue commune, à l’époque où le nouveau bilinguisme officiel de l’État fédéral tente de mettre à jour l’image du nationalisme canadien. Devenu membre du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Lemieux incarne une génération « canadienne-française » en rupture avec les gens qui, comme son père, semblent considérer l’assimilation comme un des moyens de se libérer de l’infériorité culturelle et économique qui afflige ses compatriotes.
Comme l’ont noté les médias et le cinéaste lui-même, cette « bataille de Saint-Léonard » a été plus ou moins oubliée. Voilà peut-être pourquoi ce documentaire réussit à nous entrainer dans le suspense qu’a probablement vécu la population de l’époque. C’est d’ailleurs une des qualités de ce documentaire aux archives visuelles superbement utilisées, de prendre la forme d’une sorte de thriller historique, avec ses protagonistes aux profils bien dessinés et ses péripéties à l’issue incertaine. Tout en y mettant de l’adrénaline cinématographique, Félix Rose veille cependant à révéler l’humanité de Mario Barone et de Raymond Lemieux, porteurs de débats collectifs, à travers leur vie personnelle et familiale comme racontée par leurs proches. En ressort le portrait de personnages dont l’action se fonde sur des valeurs respectables, quoique diamétralement opposées, mais qui paieront personnellement le prix de leur engagement, l’un plus que l’autre.
J’aurais peut-être aimé que Félix Rose prête plus attention à la petite communauté canadienne-française de cette municipalité qui devient pendant quelques semaines le point chaud de l’actualité québécoise. Si par la famille de Mario Barone et par les évènements, on saisit bien la position de la communauté italienne locale, on apprend bien peu de choses sur celle de la population francophone de cette localité. Qu’a-t-elle vécu? Qu’en ont pensé les commissaires scolaires et les membres de la classe politique municipale de cette époque, dont un certain nombre appartenaient au groupe ayant fondé cette banlieue en émergence?
Ma famille en faisait partie, et mon père encore plus comme conseiller municipal entre 1960 et 1966, alors que la nouvelle ville mettait en place son plan d’urbanisme, ses services et ses infrastructures modernes. Mes parents, comme des dizaines d’autres familles ouvrières, de gens de métier et professionnelles, avaient choisi d’habiter à cet endroit à la faveur d’un projet immobilier coopératif, au moment où sévissait à Montréal une crise du logement. La Coopérative d’habitation de Montréal avait amorcé, dans les années 1950, l’urbanisation du très vieux village rural de Saint-Léonard-de-Port-Maurice, fondé au 18e siècle, en construisant de modestes maisons unifamiliales en brique rouge ou beige au nord de la nouvelle autoroute métropolitaine. La coopérative avait aussi créé une épicerie et une caisse populaire coopératives dans ce secteur alors relativement isolé[3]. Un parti politique formé d’une portion de ses membres, dont mon père, Jean Leclerc, remportera les élections municipales de 1960 sous la devise « Res non verba » (Des actes, pas des paroles). Il œuvrera jusqu’en 1966 à faire de cette municipalité encore rurale une banlieue typique de son époque.
Au cours des années 1960, autour de cette coopérative, un grand nombre de personnes immigrantes d’origine italienne viennent s’installer dans les plex souvent construits par des compatriotes. La cohabitation est pacifique, mais à la manière montréalaise, c’est-à-dire sans beaucoup de contacts. Cet éloignement est renforcé par la réaction un peu épidermique de la population francophone locale de voir des personnes nouvellement arrivées s’intégrer à la communauté anglophone, comme si, ce faisant, elles tournaient le dos à la société dans laquelle elles vivaient désormais. Alors que la réalité banlieusarde était encore nouvelle pour elle, la communauté francophone ignorait tout de l’ostracisme qu’avait pendant longtemps vécu la communauté italienne de même que la décision ancienne de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM), pour divers motifs, d’orienter les enfants de familles immigrantes catholiques vers son secteur anglophone[4]. Ces sentiments réciproques d’exclusion ne contribuaient certainement pas aux rapprochements.[5]
Une des révélations de ce documentaire est à mon avis le personnage de Raymond Lemieux. Si son adversaire Mario Barone se présente sous les traits d’un « héros » communautaire par sa bonhommie et ses propos, Lemieux se rapproche de ceux d’un « héros » de cinéma, tant par son style vestimentaire sobre et élégant, son verbe posé, et son charisme lymphatique, que par sa lutte tenace, sa résistance à la répression judiciaire et par le sacrifice de sa vie professionnelle et familiale pour un idéal. Il mérite certainement de retrouver sa place dans l’histoire nationale grâce à ce documentaire, tout autant que d’autres personnes liées à ce moment historique dont le souvenir a traversé le temps.
Voilà ce qu’on peut souhaiter à tous les documentaires d’histoire[6] : l’habileté à raconter le passé du Québec de manière à toucher un large public. Ce passé souvent méconnu, parfois dévalorisé ou ignoré par nombre de personnes, il reste encore à le décaper, à le décoincer et surtout, comme le fait La bataille de Saint-Léonard, à l’enrichir de la diversité des histoires et de ces gens de toutes origines qui ont, tant bien que mal, contribué à faire du Québec ce qu’il est… et ce qu’il sera!
[1] Stéphane Tessier, « La crise linguistique de Saint-Léonard », Est Média Montréal (11 décembre 2021), en ligne : https://estmediamontreal.com/la-crise-linguistique-de-saint-leonard.
[2] Les statistiques de l’époque démontrent l’infériorité économique des unilingues francophones au Canada. Voir le Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre 3 : Le monde du travail, Ottawa, 1969, p. 16, 17 et 23, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/bcp-pco/Z1-1963-1-5-3A-1-fra.pdf.
[3] Maude Bouchard-Dupont, « Saint-Léonard, projet coopératif d’habitation d’envergure », Encyclopédie du MEM ( 21 novembre 2021), en ligne : https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/saint-leonard-projet-cooperatif-dhabitation-denvergure. Voir aussi Stéphane Tessier, « Saint-Léonard : terre d’accueil de la plus grande coopérative d’habitation au Québec », Est Média Montréal (4 mars 2023), en ligne : https://estmediamontreal.com/saint-leonard-terre-accueil-plus-grande-coop-habitation-quebec/#:~:text=La%20Coopérative%20d’habitation%20de%20Montréal%20est%20à%20l’ origine,le%20plus%20grand%20au%20Québec.
[4] « Ce qui importe avant tout pour la Commission, c’est la préservation de la foi catholique, plutôt que de la langue française, chez les immigrants. Au fil du temps, le secteur anglo-catholique de la CECM, rempart contre la menace de l’apostasie, devient ni plus ni moins un secteur “ethnique” chargé de l’accueil et de l’intégration des immigrants catholiques. Cette politique a pour effet d’accélérer l’anglicisation des minorités ethniques et de retarder considérablement leur intégration à la communauté francophone. » Miguel Simao Andrade, La Commission des écoles catholiques de Montréal et l’intégration des immigrants et des minorités ethniques à l’école française de 1947 à 1977, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, no 4 (printemps 2007), p. 455-486, en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2007-v60-n4-haf1778/016527ar/.
[5] Ralph Mastromonaco, « La communauté italienne et la langue française », La Presse (17 avril 2024), en ligne : https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2024-04-17/la-communaute-italienne-et-la-langue-francaise.php.
[6] Cet automne marque aussi la sortie d’un autre magnifique documentaire, tout aussi prenant et pertinent pour notre époque, sous le titre de Johanne. Tout simplement. La réalisatrice Maryse Legagneur raconte le parcours hors du commun de la première mannequin noire québécoise et canadienne, Johanne Harelle.
Articles sur les mêmes sujets