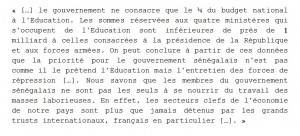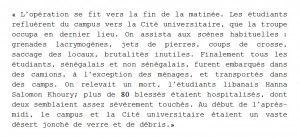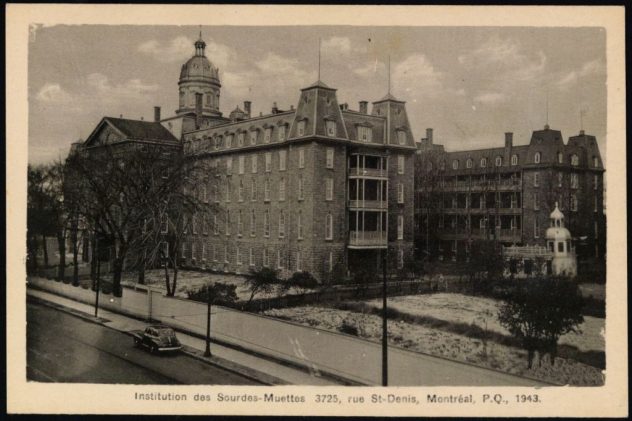Du « Mai 68 » dakarois au « Printemps érable » québécois. Quand l’engagement étudiant marque l’histoire
Citer cet article
APA
Scallon-Chouinard, P. (2013). Du « Mai 68 » dakarois au « Printemps érable » québécois. Quand l’engagement étudiant marque l'histoire. Histoire Engagée. https://histoireengagee.ca/?p=2871Chicago
Scallon-Chouinard Pascal. "Du « Mai 68 » dakarois au « Printemps érable » québécois. Quand l’engagement étudiant marque l'histoire." Histoire Engagée, 2013. https://histoireengagee.ca/?p=2871.Par Pascal Scallon-Chouinard, doctorant en histoire à l’Université de Sherbrooke et chargé de cours universitaire
Version PDF
Dans plusieurs pays du monde, les étudiants, surtout universitaires, occupent l’avant-scène de la vie politique, économique et sociale, soit par leurs écrits ou leurs manifestations parfois violentes. Si l’on s’interroge sur les mobiles de ces mouvements d’étudiants aussi bien dans un sens que dans un autre, il se dégage une caractéristique essentielle et universelle : c’est que les étudiants d’où qu’ils soient, commencent, dès leurs études à se sentir concernés par la vie politique, économique et sociale de la communauté nationale à laquelle ils appartiennent. Les études ont cessé d’être un vase clos, un milieu fermé, les étudiants ont cessé de former une caste dont les membres n’éprouvent le besoin de se regrouper et de manifester que pour défendre leurs privilèges. Ils témoignent une volonté ferme d’être intégrés dans la société des travailleurs, dès avant la fin de leurs études[1].
Cette assertion, au regard des événements qui ont marqué le Québec depuis le printemps 2012, semble d’actualité. Il n’aurait pas été surprenant, en effet, qu’elle soit tirée d’un communiqué de porte-paroles étudiants ou encore d’une analyse historique sur l’identité estudiantine et les mouvements sociaux. Elle rend compte d’une certaine volonté d’engagement, ou du moins d’un désir affirmé de participer à une réflexion collective et à la transformation de la société. Pourtant, ces propos ne sont ni d’ici ni de notre époque. Ils ont plutôt été prononcés par le président de l’Union nationale des étudiants du Burundi (U.N.E.B.A.) à l’occasion du troisième congrès de l’association tenu au mois d’août 1962. Le Burundi, ancienne colonie africaine de la Belgique, venait alors tout juste d’obtenir son indépendance, cause pour laquelle les membres de l’U.N.E.B.A. avaient milité avec ferveur depuis la création de l’association en 1959[2].
Ce qu’illustre cette citation, c’est une certaine similarité, dans le temps et l’espace, des processus menant à l’engagement et la politisation des étudiants. Le 27 mai prochain marquera le 45e anniversaire du début de la grève générale des étudiants de l’Université de Dakar au Sénégal. Une analyse historique des événements de 1968 permet justement de voir et de comprendre les liens qu’il peut y avoir entre différents cas de luttes étudiantes, non seulement en ce qui a trait au processus contestataire, mais également en ce qui concerne la critique et la répression auxquelles celui-ci doit bien souvent faire face.
Les regroupements étudiants qui investissent l’espace public pour faire entendre leur voix et leurs revendications partagent généralement des ressemblances et des connexions, et ce, malgré les contextes sociaux, politiques et économiques qui peuvent considérablement varier d’une époque à l’autre ou d’un endroit à l’autre. Les « échos » du « Mai 68 » dakarois ont-ils résonné jusqu’au « Printemps érable » québécois de 2012 ? Un retour sur le contexte sénégalais de 1968 et sur les événements générés par le mouvement étudiant dakarois peut sans aucun doute permettre d’établir des rapprochements entre les deux situations historiques.
À l’aube de la grève, le Sénégal postcolonial
Ancienne colonie française, c’est en 1960 que le Sénégal s’affranchit du joug colonial. Cette indépendance, qui devait permettre au pays de s’affirmer économiquement et de régler ses problèmes de sous-développement, s’est cependant avérée beaucoup plus difficile à gérer. Les premières années postcoloniales se démarquent en effet par d’importantes crises politiques, économiques et sociales.
Des divergences idéologiques qui opposent le Président de l’époque (Léopold Sédar Senghor)[3] à son Premier Ministre (Mamadou Dia), vont conduire à l’arrestation de ce dernier, à l’abolition de la gouvernance bicéphale (par la présidentialisation du pouvoir) et au renforcement de l’autoritarisme[4]. Le développement économique et social, quant à lui, tarde à se mettre en marche. La crise qui secoue le pays, entraînée notamment par la chute des cours mondiaux de l’arachide (alors la principale source d’exportation du Sénégal), l’augmentation drastique du chômage et la mise en place de politiques d’austérité (comme le blocage des salaires, dès 1963), suscite un mécontentement populaire et alimente les critiques provenant des milieux politiques et syndicaux[5]. Mais le processus de monopolisation du pouvoir tend toutefois à museler les potentielles formes de contestation en procédant, entre autres, à la dissolution des partis politiques d’opposition et à la mise sous tutelle des principales centrales syndicales du pays[6].
Cette mainmise sur le pouvoir et sur l’espace public conduira le Président Senghor à clamer haut et fort son assurance. « Quand je dis « nous sommes tous d’accord » », déclarait-il en janvier 1968, « je ne vise pas seulement les militants de l’UPS, mais la quasi unanimité des Sénégalais : des ouvriers aux étudiants[7]. » Or, cinq mois plus tard, les étudiants de l’Université de Dakar amorçaient une grève qui allait se transformer en un mouvement de contestation d’une ampleur sans précédent dans la jeune histoire du Sénégal postcolonial : « faute de pouvoir s’exprimer sur la scène politique et publique », explique en effet l’historien Patrick Dramé, « la contestation du Parti-État UPS investit les mouvements sociaux et estudiantins. La Rue et l’Université deviennent ainsi les uniques pôles de dissidences et de revendications par rapport à la toute puissance du Palais et de Senghor[8]. »
Contestations et revendications à l’Université de Dakar
À la veille de la crise de 1968, deux associations étudiantes (l’Union des étudiants de Dakar (UED) et l’Union des étudiants du Sénégal (UDES)) exercent une influence importante sur le campus universitaire et n’hésitent pas à prendre position sur les enjeux soulevés par l’actualité nationale et internationale. Depuis 1966, le mouvement étudiant se montre en effet déterminé à se battre, non seulement pour l’amélioration des conditions matérielles et sociales au sein de l’Université, mais aussi contre toute forme d’impérialisme et de néocolonialisme en Afrique et dans le reste du monde. C’est dans cette logique que des actions contestataires d’initiative étudiante sont constamment entreprises, telles que des manifestations et des rassemblements devant les ambassades américaines et européennes pour dénoncer l’ingérence occidentale en Afrique ou encore pour afficher un soutien aux Vietnamiens dans la situation de guerre au Viêtnam[9]. Qui plus est, puisque l’Université de Dakar représente alors, en quelque sorte, le pôle de la formation des jeunes élites de l’Afrique de l’Ouest, les étudiants sénégalais ne sont pas les seuls à se sentir concernés et à prendre part aux luttes menées. Le « bouillonnement » estudiantin se forme en effet d’une impulsion venant de jeunes issus de plusieurs anciennes colonies françaises (et même de l’ancienne métropole), ce qui crée un amalgame plutôt riche de revendications et de motivations.
Or, deux décisions du gouvernement, directement liées à la question de l’accessibilité aux études, enflammeront plus particulièrement les esprits et mèneront à une forme de consensus chez les étudiants africains. L’année précédente, le parti au pouvoir avait en effet décidé d’imposer un fractionnement de certaines bourses perçues par les étudiants et une réduction des mensualités de versements, les faisant passer de douze à dix mois. Les négociations portant sur ces décisions, entamées dès l’automne 1967, sont rompues le 15 mai 1968 lorsque les organisations étudiantes sénégalaises optent pour un changement de stratégie, évaluant que ces démarches ne mèneraient pas à la résolution du différend. Trois jours plus tard, le 18 mai, une grève temporaire des cours était organisée[10]. Par le biais d’un discours radiodiffusé, le gouvernement a toutefois réitéré, de façon virulente, son refus de revenir sur les décisions prises, allant même jusqu’à menacer d’exclusion les grévistes[11]. Devant cette intransigeance, les étudiants vont déclencher une grève illimitée et un boycottage des examens qui devait débuter le matin du 27 mai. Outre le désir de faire pression sur le gouvernement et sur ses politiques en éducation, les unions étudiantes vont chercher à dénoncer, notamment par le biais d’un mémorandum, la gabegie et le népotisme du gouvernement, qu’ils qualifient d’irresponsable dû à son caractère jugé réactionnaire et néocolonialiste[12]. On peut y voir non seulement une détermination à défendre la condition étudiante plus particulière, mais également une certaine volonté à prendre parole et position sur les questions sociales, politiques et économiques du pays.
Du mépris à la répression : le gouvernement devant la crise
La réaction du gouvernement quant aux critiques et à la contestation organisée des étudiants fut d’abord rhétorique. Souhaitant se montrer ferme, dans une logique du « tenir bon » et du « ne pas plier », le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Makhtar M’Bow, a d’abord cherché à stigmatiser l’action des étudiants en dénonçant leur attitude, puis en les caractérisant au passage de « privilégiés » menant une « vie dissolue » dans l’enceinte universitaire[13]. Plus tard, afin de minimiser l’importance du conflit, le président lui-même fera une allocution lors de laquelle il condamnera l’attitude des étudiants qui, selon lui, auraient simplement « attendu la révolte des étudiants de Paris pour faire la même chose que les toubabs [les Blancs], pour singer les étudiants français sans modifier une virgule[14]. » Il jugeait par ailleurs inacceptable que « sous couleur de revendications corporatives, une minorité prétende bloquer le fonctionnement de l’Éducation nationale en général, singulièrement de l’Université Sénégalaise[15]. »
Suite au déclenchement de la grève générale des étudiants de l’Université Dakar, le Président Senghor opte pour un durcissement de positions. « Devant l’agitation estudiantine et la mollesse des professeurs », indiquait-il à l’ambassadeur français Jean de Lagarde, il a expliqué sa volonté de « faire évacuer l’université, [de] mettre en prison les récalcitrants et, si les élèves refusaient de passer les examens, [de] faire fermer l’université pour un ou deux ans, quitte à la rebâtir sous une nouvelle formule[16]. » Le mouvement venait alors de faire « tache d’huile » en se répandant dans d’autres sphères de la société, notamment dans les établissements secondaires du pays et dans les milieux ouvriers. La tension a culminé dans l’après-midi du 28 mai 1968 : entre 20 000 et 30 000 personnes s’étaient alors réunies à l’Université de Dakar pour assister à une rencontre tenue par les étudiants grévistes, durant laquelle un cordon policier s’est mis en place afin d’isoler l’université du reste de la ville et pour filtrer les sorties (seuls les enfants des écoles primaires ont pu sortir du campus)[17]. Le lendemain matin, le Président Senghor ordonnait aux policiers et aux gardes de reprendre le contrôle de l’Université. L’action des forces de l’ordre a été percutante, voire brutale. Elle a résulté en de violentes confrontations avec la foule présente (grenades lacrymogènes, cocktails Molotov, jets de pierres, etc.), puis a mené à l’hospitalisation de plus de 80 blessés et à la mort d’un étudiant. En outre, c’est plus de 600 étudiants sénégalais qui seront détenus jusqu’au 9 juin dans un camp militaire, et quelques centaines d’étudiants étrangers qui vont être expulsés du pays[18].
Négociations et gestion d’après-crise
À la veille du mois de mai 1968, le comité directeur de l’Union des étudiants de Dakar s’était adressé aux travailleurs africains : « […] Notre lutte à nous étudiants n’a de sens que dans la mesure où elle aide à la prise de conscience de nos peuples, où elle renforce la lutte déjà entreprise. […] Nous gouvernements, pour la plupart, ont fait la preuve irréfutable de leur carence, de leur caractère réactionnaire et servile aux intérêts des monopoles étrangers[19]. » Près d’un mois plus tard, les grandes centrales syndicales répondent à l’appel et décident de rejoindre le mouvement qui gagne de l’ampleur chaque jour. Du 29 mai au 9 juin, affirme l’ancien contestataire étudiant et syndicaliste Abdoulaye Bathily, « la ville de Dakar et sa région ont vécu une ambiance d’émeute jamais connue dans le pays[20]. » En décrétant la fermeture des établissements scolaires et l’interdiction de manifestations ou de réunions publiques, le gouvernement démontre clairement sa volonté de fermeté, procédant du même coup à des arrestations de masse auprès des contestataires[21]. Quant à l’Université, il a été décidé qu’elle serait fermée pour la durée de l’été, avec une reprise des cours prévue à l’automne suivant, lorsque les tensions, croyait-on, se seraient résorbées. Ancré dans ses positions, le gouvernement a donc choisi de maintenir la ligne dure, espérant du même coup un essoufflement de la crise durant la période estivale. Mais devant la pression des milieux syndicaux et la contestation populaire grandissante, le tout dans un contexte d’élections, le gouvernement acceptera finalement d’entamer des négociations et procèdera à certains changements afin de démontrer sa « flexibilité » et sa « bonne volonté » apparentes.
Dans cette logique, le ministre de l’Éducation, qui était en poste lors des décisions du gouvernement en matière d’éducation supérieure et qui avait refusé, tout au long de la crise étudiante, de montrer une quelconque ouverture, est « sacrifié ». Démis de ses fonctions, il a dû céder sa place à un nouveau ministre, Assane Seck, jugé plus conciliant et mieux perçu par les étudiants[22]. Puis, au terme de longs pourparlers, une entente semble émerger le 13 septembre 1968. Parmi les points d’accord, on note la garantie offerte aux étudiants sénégalais et africains impliqués dans le conflit de poursuivre leur cheminement académique; le gouvernement s’engage également à payer les deux mensualités de bourse qu’il avait auparavant choisi de couper; enfin, le régime au pouvoir accepte de recevoir des délégations étudiantes dans un processus de dialogue et d’échanges qui devait permettre d’examiner plus en profondeur les options et les revendications estudiantines[23].
La grève étudiante et générale, de façon officielle, prenait ainsi fin. Faut-il y percevoir une « victoire » de la cause étudiante ? Oui et non. Oui, car dans un premier temps la grève des étudiants et son extension aux autres sphères de la société ont permis d’ébranler le pouvoir en place dans ses certitudes et dans son autorité affichée. « Poussé dans ses derniers retranchements et ayant frisé la chute », explique Patrick Dramé, « le pouvoir senghorien comprit la nécessité de faire des concessions aux syndicats par rapport à certains aspects de leurs revendications[24]. » En outre, le recul du gouvernement sur certaines coupures annoncées marque en soit une réussite pour le mouvement étudiant et ses revendications concernant l’accessibilité aux études supérieures. Parallèlement, le Palais présidentiel mettait toutefois en place des stratégies d’encadrement lui permettant d’avoir une mainmise sur les forces de contestation et sur la gestion universitaire. En avril 1969, à titre d’exemple, le Club nation et développement est créé. Celui-ci devait permettre un cadre de réflexion critique sur les politiques du gouvernement en place. Or, explique Abdoulaye Bathily, celui-ci s’est plutôt transformé en une sorte de « pépinière » utilisée par le parti au pouvoir afin de renouveler sa base militante et son électorat[25]. Par ailleurs, malgré ses concessions, le gouvernement ne s’est pas montré particulièrement pressé de respecter ses engagements pris lors de l’accord de septembre 1968. Enfin, une révision des statuts de l’université va s’opérer, permettant au gouvernement d’assurer un contrôle plus étroit de l’établissement. Une série de décrets sera de sorte mise en place, visant à restreindre les libertés universitaires ainsi que le droit d’association des étudiants. Le 19 juin 1969, soit un peu plus d’un an après le déclenchement de la grève générale des étudiants de l’Université de Dakar, la loi 69-33 est promulguée, introduisant plusieurs mesures de contrôle : les libertés d’association et d’expression doivent dès lors s’inspirer des « principes d’objectivité et de tolérance »; un dispositif antigrève est défini par l’instauration de mesures contre les atteintes à l’ordre public et au fonctionnement normal des institutions; des sanctions disciplinaires sont prévues contre les agitateurs; enfin, une circulaire publiée le 25 septembre 1969 est venue ajouter à ces dispositions la liberté, accordée aux forces policières, d’intervenir dans l’université sans avoir auparavant obtenu une autorisation judiciaire ou une demande formulée par les autorités universitaires[26].
45 ans plus tard…
Devant un gouvernement qui tarde à tenir ses promesses, il faudra peu de temps pour que la contestation reprenne, et ce, malgré les mesures autoritaires prises par Senghor au lendemain du conflit. En fait, et c’est peut-être là que se trouve la principale réalisation du mouvement de grève dakarois de mai 1968, c’est une réelle capacité de mobilisation et une « culture » de contestation qui, nées de ce mouvement sans précédent, se sont installées et ont continué de se manifester de façon périodique au Sénégal et dans l’Afrique de l’Ouest en général. À la grève 1968 se sont entre autres ajoutées, au fil des décennies, celles de 1969, de 1988, de 1993, de 2000 et de 2008. Marquées d’une part par une dégradation des possibilités et des conditions de travail chez les diplômés puis, d’autre part, par des politiques de restriction budgétaire dictées « par le triumvirat FMI-Banque mondiale-pays occidentaux », les années 1980 ont amené les unions étudiantes à se redéfinir et à se repositionner. De plus en plus, explique en effet Abdoulaye Bathily, « les étudiants se perçoivent comme rejetés par l’État, marginalisés par la société civile, ou bien comme de simples pions entre les mains de partis sur l’échiquier du jeu politique[27]. »
Passant, aux yeux de la société, d’un statut de « pourvoyeurs de modernité » à celui de « demandeurs d’assistance », les étudiants de Dakar ont dû mener, depuis cette époque, une lutte acharnée pour faire entendre leur voix et pour légitimer, aux yeux de tous, leurs revendications. Cette réalité exprime ni plus ni moins « l’évolution des couches intellectuelles du Tiers-Monde en général, qui perdent de plus en plus l’initiative dans une situation où leur rôle est remis en question par une formidable imbrication de la société civile et de la société politique[28]. » La « prise de parole » étudiante et la valorisation du travail intellectuel (qu’il s’agisse d’études universitaires, de recherche ou d’enseignement) demeurent, au Sénégal comme ailleurs, des acquis fragiles qu’il faut constamment défendre, et dont la préservation tend parfois à bousculer l’ordre établi et les consensus populaires. Ici encore, l’actualité sénégalaise fournit quelques exemples, alors que des étudiants dakarois ont dernièrement mené des actions-chocs afin de faire entendre leurs revendications.
En décembre 2012, par exemple, ceux-ci ont paralysé l’une des principales artères de la ville de Dakar en immobilisant quatre autobus et en menaçant d’y mettre le feu pour protester contre les retards considérables dans le versement des bourses d’études. Quelques mois plus tard, soit le 15 mars 2013, trois étudiants s’immolaient sur la place publique afin de dénoncer le refus de leur demande d’admission au programme de géographie de l’université. Plus récemment, une manifestation étudiante de grande ampleur a eu lieu dans les rues de la capitale sénégalaise. L’action visait à dénoncer et à contester le rapport général du Comité de pilotage de la Concertation nationale sur l’enseignement supérieur, qui réunissait des députés, des chefs syndicaux et des parents d’élèves. L’une des recommandations du rapport, qui prévoit une hausse vertigineuse des frais de scolarité (les faisant passer de 5000 à 150 000 francs CFA), a soulevé l’indignation chez une importante portion de la population estudiantine. C’est sur le président actuel, Macky Sall, que repose la décision de valider ou non les recommandations du rapport. « S’il valide ces consultations », prévient un étudiant de l’UCAD, « il verra que le pays sera mouvementé[29]. » La contestation étudiante est donc, au Sénégal, toujours d’actualité. Elle s’inscrit dans un long processus et en continuité avec les événements de 1968, ajoutant aux considérations de l’époque des enjeux bien contemporains et universels, tels que la privatisation du savoir, l’accessibilité et l’aide aux études.
Conclusion : du Sénégal au Québec
Que peut indiquer, au final, la grève des étudiants de l’Université de Dakar de 1968 sur la situation qu’a connue le Québec lors de son « printemps érable » ? Sans chercher à forcer les parallèles ou les liens entre des situations aux contextes très différents, force est d’admettre que dans le processus des contestations étudiantes, qu’il s’agisse du cheminement vers la grève, des revendications, des moyens mis en œuvre par les étudiants, ou encore des critiques, de la répression et des résultats concrets, des similitudes peuvent être observées.
La rhétorique employée par le gouvernement senghorien visant à réduire l’ampleur de la situation et à « dénigrer » l’action étudiante n’est évidemment pas unique au cas du « Mai 68 » sénégalais. À titre d’exemple, les déclarations du ministre de l’Éducation nationale, qui taxait les étudiants de « privilégiés », peuvent facilement trouver leur équivalence ici même au Québec, dans les représentations exprimées par différents acteurs et commentateurs des conflits étudiants. Durant la grève de 1958 notamment, la journaliste Renée Larochelle, dans une entrevue menée avec trois étudiants mandatés par leur association pour défendre les positions de ses membres auprès du Premier Ministre Duplessis, se questionnait sur la représentation qu’avait le public des étudiants : « Mais justement, est-ce que le public comprend bien la situation, c’est-à-dire que le public ne croit peut-être pas que les étudiants sont à plaindre, vous-mêmes vous n’avez pas l’air d’être trop mal en point, on voit beaucoup d’automobiles sur les campus[30]… » Près de 30 ans plus tard, l’équipe du « Bye Bye 1986 » consacrait quant à elle un sketch aux étudiants, qui y sont présentés comme de jeunes gâtés aux goûts luxueux se scandalisant d’une hausse des frais de scolarité de 20 dollars. Toutes les formules entendues au printemps 2012 à propos des étudiants et de leur consommation de bières, leurs iPhones, leurs voyages dans le Sud ou leur dégustation de sangria sur une terrasse à Outremont, rejoignent également cette image construite et alimentée au fil des décennies par les critiques des mouvements étudiants et les conceptions populaires. Les similitudes ne se limitent toutefois pas qu’aux paroles et aux discours. La radicalisation des positions et les actions répressives menées à l’encontre des mouvements étudiants sont d’autres facettes qu’il est possible d’observer et de comparer, à différentes échelles, dans les réactions et les décisions des autorités face aux contestations populaires.
La destitution du ministre de l’Éducation Amadou Makhtar M’Bow, à cet égard, n’est pas sans rappeler la démission de Line Beauchamp en mai 2012 et son remplacement par Michelle Courchesne qui, comme Assane Seck, laissait présager, aux yeux de certains – pas nécessairement les étudiants -, un peu plus d’ouverture dans les discussions et les négociations avec les représentants d’associations étudiantes. Et que dire des stratégies mises en place par le gouvernement sénégalais (fermeture de l’université pour la période estivale avec reprise en automne, mise en place de mesures limitant le droit à la manifestation et la liberté d’association, organisation de rencontres destinées à favoriser le dialogue sur la nature de l’éducation supérieure), qui peuvent sans doute rappeler la loi 12 (et actuellement le règlement P-6 à Montréal), le Sommet sur l’Éducation organisé par le Parti Québécois et toute la question entourant la légitimité des associations étudiantes et du processus de grève ?
Assurément, il ne faut pas voir les mouvements de contestation étudiants comme des réalités isolées et singulières, mais plutôt comme une mouvance dépassant les frontières et les époques; une lutte acharnée sur plusieurs générations et un désir constant d’être entendu, de s’engager et de faire porter une voix au-delà de l’enceinte universitaire.

« L’histoire n’est pas encore écrite ! » : banderole des étudiants de maîtrise et de doctorat en histoire de l’Université de Sherbrooke lors de la manifestation étudiante nationale du 22 mars 2012 à Montréal. Crédits : Pascal Scallon-Chouinard.
Pour en savoir plus
«?Extrait de l’allocution du président de l’Union nationale des étudiants barundi prononcée lors du 3e Congrès de l’U.N.E.B.A.?» Infor Burundi, no 33 (20 août 1962).
BATHILY, Abdoulaye, Mamadou DIOUF et Mohamed MBODJ. «?Le mouvement étudiant sénégalais, des origines à 1989?». Dans Hélène D’ALMEIDA-TOPOR, Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Odile GOERG et Françoise GUITART, dir. Les jeunes en Afrique. La politique et la vie. Tome 2. Paris, L’Harmattan, 1992, p. 282-310.
BATHILY, Abdoulaye. Mai 68 à Dakar, ou la révolte universitaire et la démocratie. Paris, Éditions Chaka, 1992, 191 p.
BIENVENUE, Louise. Quand la jeunesse entre en scène. L’action catholique avant la révolution tranquille. Montréal, Boréal, 2003, 291 p.
DRAMÉ, Patrick. «?Le palais, la rue et l’université en mai 1968 au Sénégal?». Dans Patrick DRAMÉ et Jean LAMARRE, dir. 1968. Des sociétés en crise : une perspective globale. Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 81-100.
GAHAMA, Joseph. «?L’Union nationale des étudiants barundi (U.N.E.B.A.) face à l’évolution politique du Burundi (1960-1967)?». Dans Hélène D’ALMEIDA-TOPOR et Odile GOERG, dir. Le mouvement associatif des jeunes en Afrique noire francophone au XXe siècle. Paris, L’Harmattan, 1989, coll. «?Groupe « Afrique noire »?», no 12, p. 91-105.
HÉBERT, Karine. Impatient d’être soi-même. Les étudiants montréalais 1895-1960. Montréal, PUQ, 2008, 290 p.
MESLI, Samy. «?La grève de mai-juin 1968 à l’université de Dakar?». Dans Patrick DRAMÉ et Jean LAMARRE, dir. 1968. Des sociétés en crise : une perspective globale. Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 101-119.
NEATBY, Nicole. Carabins ou activistes?? L’idéalisme et la radicalisation de la pensée étudiante à l’Université de Montréal au temps du Duplessisme. Montréal, McGill-Queen’s Press, 1999, 256 p.
SENGHOR, Léopold Sédar. Rapport de Politique Générale : «?Politique, Nation et Développement?». 6ème Congrès de l’U.P.S. (5-6-7 janvier 1968).
THIOUB, Ibrahima. «?Le mouvement étudiant de Dakar et la vie politique sénégalaise : la marche vers la crise de mai-juin 1968?». Dans Hélène D’ALMEIDA-TOPOR, Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Odile GOERG et Françoise GUITART, dir. Les jeunes en Afrique. La politique et la vie. Tome 2. Paris, L’Harmattan, 1992, p. 267-281.
[1] « Extrait de l’allocution du président de l’Union nationale des étudiants du Burundi prononcée lors du 3e Congrès de l’U.N.E.B.A. », Infor Burundi, no 33, 20 août 1962.
[2] Joseph Gahama, «?L’Union nationale des étudiants barundi (U.N.E.B.A.) face à l’évolution politique du Burundi (1960-1967), dans Hélène d’Almeida-Topor et Odile Goerg, dir., Le mouvement associatif des jeunes en Afrique noire francophone au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1989, coll. « Groupe « Afrique noire » », no 12, p. 91.
[3] Le Président peut alors compter sur l’appui d’une grande partie des milieux économiques, de la coopération française et des autorités musulmanes sénégalaises.
[4] Patrick Dramé, «?Le palais, la rue et l’université en mai 1968 au Sénégal?», dans Patrick Dramé et Jean Lamarre, dir, 1968. Des sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 83.
[5] Samy Mesli, «?La grève de mai-juin 1968 à l’université de Dakar?», dans Patrick Dramé et Jean Lamarre, dir, 1968. Des sociétés en…, p. 102.
[6] Ibrahima Thioub, «?Le mouvement étudiant de Dakar et la vie politique sénégalaise : la marche vers la crise de mai-juin 1968?», dans Hélène d’Almeida-Topor, Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg et Françoise Guitart, dir, Les jeunes en Afrique. La politique et la vie. Tome 2, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 269.
[7] Léopold Sédar Senghor, Rapport de Politique Générale : «?Politique, Nation et Développement?», 6ème Congrès de l’U.P.S., 5-6-7 janvier 1968, p. 9.
[8] Patrick Dramé, « Le palais, la… », p. 83.
[9] Abdoulaye Bathily, Mamadou Diouf et Mohamed Mbodj, «?Le mouvement étudiant sénégalais, des origines à 1989?», dans Hélène d’Almeida-Topor, Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg et Françoise Guitart, dir, Les jeunes en…, p. 300-302.
[10] Ibrahima Thioub, « Le mouvement étudiant… », p. 276.
[11] Samy Mesli, « La grève de mai-juin… », p. 106.
[12] Patrick Dramé, « Le palais, la… », p. 89.
[13] Ibid., p. 90.
[14] Allocution du Président Senghor, Dakar Matin, 30 mai 1968.
[15] Idem.
[16] Télégramme de Jean de Lagarde au ministère des Affaires étrangères, cité dans Samy Mesli, «?La grève de mai-juin…?», p. 107.
[17] Ibrahima Thioub, « Le mouvement étudiant… », p. 277.
[18] Samy Mesli, « La grève de mai-juin… », p. 109-110.
[19] Tract du 30 avril 1968, cité dans Ibrahima Thioub, «?Le mouvement étudiant…?», p. 274.
[20] Abdoulaye Bathily, Mai 68 à Dakar, ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Éditions Chaka, 1992, p. 85.
[21] Patrick Dramé, « Le palais, la… », p. 91.
[22] Ibid., p. 94.
[23] Abdoulaye Bathily, Mai 68 à…, p. 110-111.
[24] Patrick Dramé, « Le palais, la… », p. 95.
[25] Ibid., p. 96.
[26]Samy Mesli, « La grève de mai-juin… », p. 117.
[27] Abdoulaye Bathily, Mamadou Diouf et Mohamed Mbodj, «?Le mouvement étudiant…?», p. 305.
[28] Ibid., p. 309.
[29] «?Sénégal : manifestations étudiantes contre la hausse annoncée des frais de scolarité », RFI, 10 avril 2013, en ligne.
[30] Citation de Renée Larochelle tirée du film Histoire des Trois (1991) de Jean-Claude Labrecque, disponible sur le site de l’ONF.
Articles sur les mêmes sujets