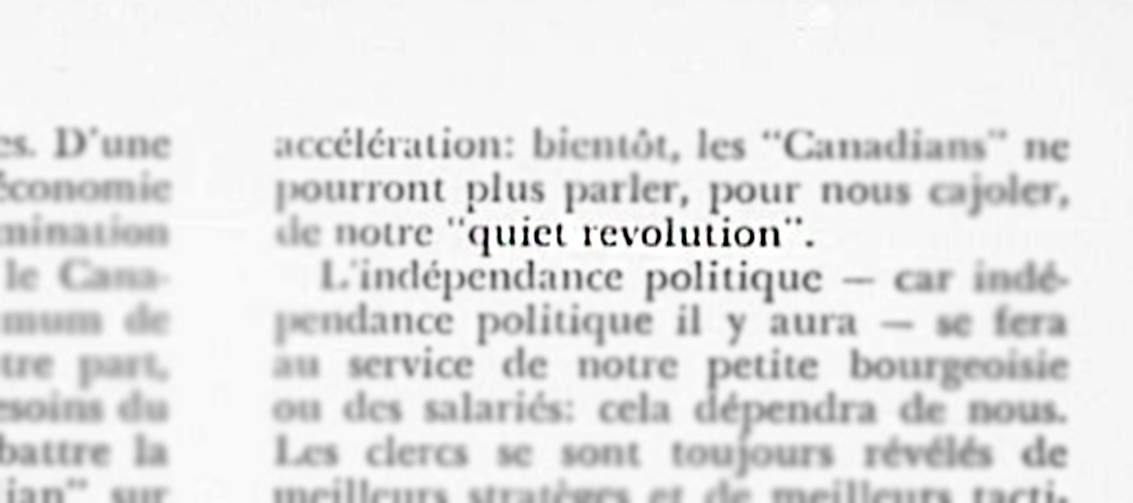Faire (de) l’histoire. Entrevue avec le sociologue Jean-Philippe Warren sur la notion d’engagement
Citer cet article
APA
Warren, J. et Savard, S. (2010). Faire (de) l'histoire. Entrevue avec le sociologue Jean-Philippe Warren sur la notion d'engagement. Histoire Engagée. https://histoireengagee.ca/?p=326Chicago
Warren Jean-Philippe et Stéphane Savard. "Faire (de) l'histoire. Entrevue avec le sociologue Jean-Philippe Warren sur la notion d'engagement." Histoire Engagée, 2010. https://histoireengagee.ca/?p=326.Par Stéphane Savard, stagiaire postdoctoral à l’Université Concordia et au CIRST
Version PDF
Stéphane Savard : Nous avons le privilège aujourd’hui de rencontrer Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie à l’Université Concordia et titulaire d’une Chaire d’études sur le Québec. Pour commencer, monsieur Warren, j’aimerais que vous nous racontiez en quelques mots votre parcours universitaire.
Jean-Philippe Warren : Je suis content de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions même si la première est embêtante! Elle a l’air anodine, mais elle ouvre sur plusieurs décisions que j’ai prises au cours de ma carrière, décisions qui m’ont à la fois rapproché et éloigné de la discipline historique. Lorsque j’ai fait le choix de m’inscrire en sociologie au baccalauréat à l’Université Laval — c’était en 1991 —, je souhaitais ardemment poursuivre des études en histoire. En même temps, j’étais très tenté par la philosophie. Or, j’avais l’impression à ce moment-là que la sociologie pouvait me donner la chance de combiner les réflexions — on va dire les plus ésotériques, les plus abstraites — de la philosophie, et les explorations plus concrètes du passé que me fournissait la méthode historique. Hésitant entre l’histoire et la philosophie, j’ai abouti en sociologie où j’ai constamment oscillé entre les deux pôles, mais en me rapprochant quand même, surtout ces dernières années, de mes collègues en histoire.
Stéphane Savard : À votre avis, monsieur Warren, est-ce que l’historien, le sociologue, l’anthropologue, bref le chercheur universitaire, devrait s’abstenir d’une trop grande implication avec les organisations communautaires, les groupes de pression, les politiciens, les médias, les musées et autres, ou est-ce que le chercheur devrait tenter de renforcer les liens avec ces derniers, de sortir de sa tour d’ivoire?
Jean-Philippe Warren : Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu’avant même de choisir un sujet de recherche, l’historien est animé par toutes sortes d’idéaux et de valeurs. Weber soulignait que le choix d’un champ de recherche ou d’un objet d’études n’est jamais imperméable aux croyances, aux dispositions personnelles, aux sensibilités d’un chercheur universitaire. Par exemple, au Québec, on sait que la plupart des gens qui étudient les mouvements de droite sont des gens qui penchent vers une option politique de droite et que, à l’inverse, la plupart des gens qui étudient des groupes syndicalistes, des associations anarchistes ou des groupuscules marxistes, sont des gens favorables aux idées de la gauche. C’est normal. Lorsque l’on fait de l’histoire et qu’on navigue à l’intérieur de ce fabuleux univers, notre regard est davantage porté à s’arrêter sur des terrains ou des thématiques qui rejoignent nos propres préoccupations citoyennes. Il y a donc, c’est trop de dire une symbiose, mais disons une proximité entre ce que fait l’historien, d’un côté, en tant que scientifique et, de l’autre côté, ce qu’il fait en tant que personne animée par des idéaux politiques et sociaux.
Cependant, une fois que l’historien sort de l’université et devient un citoyen engagé dans la Cité, rien ne le distingue, du point de vue de sa responsabilité civique, des autres membres de sa société. En démocratie, tout le monde a le devoir moral d’être averti des grands enjeux, des grands défis du monde dans lequel on vit. Et cela, non seulement parce que chaque adulte doit, tous les quatre ou cinq ans, choisir le gouvernement, mais aussi parce que, entre ces dates fatidiques des élections, chaque électeur est constamment sollicité par la politique. À cet égard, l’historien devenu simple citoyen ne se distingue pas de ses compatriotes.
Ceci dit, il est utile, pour notre discussion, de rappeler deux définitions classiques de l’intellectuel. Ces définitions distinguent l’intellectuel qu’on appelle «organique» (je préfère ce terme à «universel» que lui donnait Foucault même si je sais que je trahis, pour les besoins de mon exposé, la conception que s’en faisait Gramsci) et l’intellectuel qu’on appelle «spécifique». L’intellectuel organique, selon la définition que j’en propose ici, c’est celui qui se met au service d’une cause, d’un mouvement social, d’un parti politique, et qui va devenir le traducteur de l’idéologie dans laquelle s’inscrivent (historiquement, bien entendu, mais aussi sociologiquement) les classes dominées ou dominantes. L’intellectuel spécifique, c’est celui qui, au contraire, choisit d’élever une connaissance critique de la société sur la base d’un savoir qui, lui, demeure circonscrit. Si jamais, pour donner un exemple, vous avez étudié l’histoire de la prison au Canada au 19e siècle, vous pouvez vous prononcer sur des questions qui concernent le système pénal en 2010 à partir de réflexions qui sont informées, qui sont nourries par toutes les recherches que vous avez faites.
Moi, je suis un de ceux qui croient fermement que l’on doit toujours bien séparer le savant du politique, pour reprendre les catégories de Max Weber. Dans les débats qui agitent la société canadienne ou québécoise, il n’est pas question de se croire davantage privilégié à prendre la parole sur des questions extrêmement larges de société parce qu’on a un diplôme, parce qu’on est universitaire, parce qu’on a publié dans des revues savantes, parce qu’on est professeur. Il y a plusieurs intellectuels qui pensent qu’ils devraient être les «grands prêtres modernes» d’une société ayant perdu son Église. Ils s’imaginent que le discours qu’ils peuvent formuler sur le monde est plus valide, est plus vrai, est plus adapté, est davantage inscrit dans le cours des choses, parce qu’ils ont potassé Hegel. Je ne crois pas cela. Je crois au contraire qu’en démocratie, toutes les paroles sont égales, ou au moins potentiellement égales : c’est seulement la vaste discussion que la société entretient toujours avec elle-même qui fait en sorte qu’au bout du compte la «force intrinsèque de l’idée vraie» (pour emprunter cette fois une expression à Spinoza) va finir (on l’espère!) par triompher. On a eu trop d’exemples dans l’histoire où même de brillants intellectuels se sont trompés pour avoir maintenant une foi aveugle dans ce que ceux d’aujourd’hui proclament. Je me souviendrai toujours qu’Hannah Arendt affirmait que l’intelligence pouvait faire triompher le bien et la justice dans le monde. Or, la personne la plus intelligente qu’elle disait avoir croisée dans sa vie, c’était Martin Heidegger. Quand on connaît les actions et compromissions de Martin Heideigger sous le régime nazi, on se met à douter que l’intelligence peut vraiment être le remède à tous les maux, la panacée à la misère du monde!
Je me méfie donc de la position de l’intellectuel organique. Non seulement je m’en méfie, mais je la récuse. Cependant, je crois que l’intellectuel spécifique a sa place dans la société. Lorsque les intellectuels sont appelés à commenter les événements, à la télévision, à la radio, dans les médias écrits, ils sont souvent capables de faire voir les choses autrement, d’ouvrir le débat public sur des points inexplorés, de rendre compte de la marche d’une société à partir d’un angle peu usité et de le faire à partir de leur spécialisation. Il y a ici une responsabilité de l’intellectuel, une responsabilité du chercheur qui n’est pas facile à assumer : pour accomplir la tâche de l’intellectuel spécifique, il faut être capable d’universaliser la portée de l’objet sur lequel on travaille. Pour reprendre l’exemple de tout à l’heure, un chercheur peut démontrer que l’histoire de la prison au 19e siècle a eu une influence sur l’élaboration des pratiques carcérales contemporaines. Il peut toutefois pousser beaucoup plus loin s’il est en mesure d’universaliser l’histoire des prisons au 19e siècle. Ainsi seulement peut-il se prononcer sur des choses très éloignées de son objet immédiat : ça peut être des questions qui touchent à l’administration de justice, ou qui touchent aux phénomènes de déviance, ou qui débouchent sur des tendances de stratifications sociales.
Pour réussir à universaliser notre connaissance limitée du monde historique (parce que l’on se spécialise toujours en histoire, c’est incontournable), il faut savoir garder indépendant le souci de notre «objet» de recherche et le taraudage des questions qui proviennent de notre «sujet» de recherche. Notre «objet» de recherche peut être (je continue, si vous le permettez, sur le même exemple) la prison au 19e siècle au Bas-Canada. Mais notre «sujet» de recherche, quant à lui, peut être plutôt la question des transformations sociales, la question du pouvoir, la question de la répression ou la question de la violence. En tâchant de continuellement nourrir notre «sujet» de recherche de la connaissance précise et empirique de notre «objet» de recherche, on peut acquérir une vue assez large pour commenter de manière informée, précise et nuancée les faits de l’actualité les plus divers. Un de ceux qui a réussi le mieux, dans sa carrière, cette traduction ou translation, c’est bien sûr Fernand Dumont. Dumont avait une connaissance précise de maints sujets, mais, à partir de ces savoirs ponctuels et circonscrits, il était capable de se prononcer sur la Crise d’octobre, la médicalisation de la société canadienne, la question nationale, les défections religieuses, la société de consommation, etc. À cet égard, il représente un modèle.
Stéphane Savard : Sur la même question, en quoi selon vous une telle implication du chercheur, selon votre deuxième définition de l’intellectuel engagé spécifique, en quoi une telle implication est-elle profitable sur les plans scientifiques et humains, non seulement pour le chercheur universitaire, mais profitable aussi pour la société.
Jean-Philippe Warren : Je vais répondre de manière peut-être un peu abstraite — parce qu’il est évident, pour donner une réponse banale et facile à votre question, qu’une société qui est davantage avertie de son passé possède une réflexivité plus grande, a aussi une capacité de recul plus importante pour affronter les défis qui se présentent à elle. Il est manifeste, réciproquement, qu’un chercheur qui est habité par les grands enjeux de sa société est davantage éveillé à des dimensions de l’expérience humaine qui existaient dans le passé et qui existent toujours aujourd’hui. Cette réponse est évidente à mes yeux.
Je vais donc répondre de manière un peu plus abstraite. Je commencerai par dire que, selon moi, la méthode scientifique ne relève pas de la fiction. Il y a des savants qui prétendent être «contre la méthode», qui affirment ne pas croire à la science. Un professeur de sociologie interviewé dans les années 80, désabusé par rapport aux institutions universitaires, avait à peu près répondu à la question «à quoi sert la sociologie» : «la sociologie ça sert à rien, sinon à donner une bonne job». Pour ma part, je pense que la sociologie a vraiment un rôle à jouer, comme l’histoire a un rôle à jouer, et que ce rôle s’appuie sur une méthode qui garantit de manière précaire, certes, mais garantit quand même une certaine consistance et cohérence des connaissances produites.
On sait par ailleurs que cette démarche s’exerce à l’intérieur d’une praxis (Michel Freitag appelait cela un «mode de production sociétal»), c’est-à-dire à travers une structuration sociale des choses, des idées, des valeurs, des idéologies et des discours. Par exemple, à un moment donné, la discipline historique s’est préoccupée de la question de l’identité. Un paquet de monde s’est mis à travailler sur l’identité. Quelques années auparavant, c’était plutôt les classes sociales, et quelques années auparavant encore, c’était la pratique religieuse. Je n’ai pas besoin d’insister. On sait que les sociétés se braquent sur des dimensions particulières de leurs pratiques et que la discipline historienne suit ces modes en essayant de montrer comment ces dimensions-là, soudain populaires et sinon discutées, ont une certaine pérennité.
Observant ces tendances sociales qui se traduisent en modes scientifiques, des critiques ont pu avancer que l’histoire est subjective, qu’elle est transitoire, qu’elle est idéologique, et qu’elle a donc peu de valeur. Je réponds à ces critiques que ce n’est pas pour rien qu’une société, à un moment donné, va décider d’élever au-dessus des autres une facette de sa pratique et d’en faire le modus operandi de son organisation sociale, d’en faire une des pièces fondamentales de son édifice social. C’est parce que cette pratique révèle quelque chose d’effectivement fondamental. Il y a un exemple que j’aime donner. Lorsque Marx étudie le travail, il cherche à démontrer que le travail n’est pas une catégorie sociale ayant toujours existé. Le travail, pour Marx, est une création récente de la société capitaliste. Avant la société capitaliste, les gens faisaient des choses, bien entendu : ils avaient des activités professionnelles, ils labouraient les champs, ils allaient à la chasse; néanmoins, ils ne travaillaient pas comme on le fait lorsque les occupations qui se déroulent entre 9 h et 17 h sont devenues salariées. Le fait que le travail a été inventé il y a quelques siècles relativise cette notion mais ne la rend pas inopérante. Bien au contraire. On peut dire que le travail est devenu la «vérité» de «la» société capitaliste. Et étudiant la catégorie transitoire et éphémère du travail, on peut cerner quelque chose de très profond, quelque chose qui exprime la réalité d’une société. Or, et c’est là-dessus que je voudrais insister, cette réalité est objective. Cet exemple permet de mieux comprendre que les sociétés humaines — et pas seulement la science! — produisent elles aussi de l’objectivité.
Ce qui est fascinant de l’histoire, pour revenir à votre question, c’est qu’en retournant vers les époques reculées, les historiens sont capables de suivre l’évolution de la construction d’une société mais aussi de mieux mettre en perspective les différentes formes de société qui ont existé, non seulement pour les relativiser les unes par rapport aux autres, mais aussi pour éprouver la forme de société que les contemporains se sont donnée. Prenons le cas de la démocratie. Les démocraties des 17e, 18e, 19e et 20e siècles (et pourquoi pas aussi la démocratie grecque), toutes ces formes de démocratie nous renvoient une image de la démocratie différente de celle que l’on obtient à braquer notre regard seulement sur ce qui se passe aujourd’hui. On est ainsi capable d’objectiver les différentes objectivations du fait humain! On pourrait appliquer la question de l’universalisation de l’expérience singulière dont je parlais précédemment à la société humaine elle-même. À sa manière, la société universalise l’expérience historique singulière. La société moderne a décidé d’universaliser, à l’intérieur d’un cadre bien précis (temporel et géographique) l’expérience qui est celle du travail, qui était à peu près inconnue aux autres sociétés avant elle. Elle a ainsi produit une connaissance de l’homme qui est généralisable (à preuve, toutes les sociétés de la planète sont en train de succomber à la globalisation néolibérale) à partir d’une expérience infinitésimale de l’humain.
En ce sens-là, l’histoire, en tant que discipline du passé, m’apparaît fondamentale. Elle a une tâche citoyenne, une tâche d’éclaircissement, d’explicitation, de compréhension des mécanismes «qui ont fait qui l’on est». Que cela soit formé, et informé par les réifications des constructions sociales dans des modes d’être qui s’appellent le système féodal ou la société moderne, ce n’est pas à mes yeux capital : parce que, même-là, on a la possibilité d’explorer une facette qui relève d’une expérience humaine.
Stéphane Savard : J’aimerais revenir sur la notion d’histoire engagée. La revue HistoireEngagee.ca met beaucoup l’accent sur un engagement du chercheur universitaire à diffuser les résultats de ses recherches et réflexions. Il n’est pas rare de voir que les données de plusieurs recherches restent dans les revues savantes, donc restent à l’intérieur même de cette tour d’ivoire. Dans ces cas-ci, elles ne sont jamais vraiment diffusées dans la société ou, si elles le sont, il n’est pas rare de voir que ce n’est pas le chercheur lui-même mais plutôt d’autres acteurs, comme les journalistes et groupements sociaux, qui reprennent l’information et qui la transmettre selon leurs propres normes et intérêts. J’en arrive à ma question : est-ce que, dans les universités qui sont devenues une tour d’ivoire, est-ce que l’historien n’a pas, ne doit-il pas sentir le besoin de sortir du champ scientifique, de diffuser lui-même le résultat de ses travaux devant les autres membres de la société et, donc, de s’engager, ce qui est peut-être ici une autre forme d’engagement que les deux précédemment évoquées, de s’engager dans la cause qui est celle d’améliorer les connaissances générales de la société?
Jean-Philippe Warren : Je crois que tout chercheur qui se respecte a l’obligation de faire connaître ses résultats. De faire connaître ses résultats à ses pairs, cela va de soi, mais aussi, si le besoin s’en fait sentir, à la société plus large. Néanmoins, il faut faire attention. L’autonomie du champ scientifique s’est gagnée après des luttes très dures. Il ne faut pas s’imaginer, de manière naïve, que si jamais on ouvre l’université et que l’on va vers les autres, que les autres ne voudront pas entrer par la même porte à travers laquelle nous sommes sortis et faire la même chose avec nous. Les historiens sont en général très favorables à l’idée que l’historien visite la grande entreprise, le parlement, les locaux des mouvements sociaux et des groupes populaires, et parle de ses recherches. Cependant, ces mêmes historiens ne voient pas d’un bon œil que le patron de la grande entreprise, le député de l’Assemblée ou le militant écologiste vienne faire son tour à l’université et commence à prononcer des discours au bénéfice de la communauté académique. Ils s’indigneraient si un politicien osait arriver avec ses gros sabots dans une réunion départementale et déclarer : «vous savez, chers amis historiens, vous travaillez un peu trop sur les questions d’identité, il faudrait quand même travailler aussi sur la thématique de la dette». Lorsque ça se fait, parce qu’il y a quand même des grands axes stratégiques qui sont élaborés par les gouvernements pour essayer d’aiguiller un peu la recherche, lorsque ça se fait, dis-je, les universitaires poussent des hauts cris. Scandalisés, ils protestent qu’il s’agit là d’une atteinte à la liberté académique. En bref, les universitaires sont très prompts à proclamer que la société devrait les entendre, mais n’acceptent guère que la société puisse avoir un mot à dire sur ce qu’ils font. Ils défendent leur liberté académique bec et ongles. Par contre, ils ne se formaliseraient pas si leurs travaux étaient distribués gracieusement dans les foyers du Canada et du Québec.
Je me répète : il faut faire attention. L’autonomie universitaire représente une conquête névralgique. Dit aussi simplement que possible : que l’université puisse tendre à être une «tour d’ivoire» (ce qu’elle n’a jamais été dans les faits), c’est une bonne chose, ce n’est pas une mauvaise chose. Cela étant posé, il faut quand même essayer de trouver des moyens de faire du «transfert de connaissances», selon l’expression à la mode. Il faut que les connaissances historiennes produites, peut-être pas en vase clos, mais à l’écart du reste de la société, puissent percoler de quelque manière vers les médias, vers les groupes populaires, vers les politiques publiques, vers les forums sociaux. On cherche en ce moment toutes sortes de médiations qui permettraient ça.
Je pense que l’historien et l’historienne ont ici une part de responsabilité. Il est relativement facile pour les professeurs d’université de se replier sur soi. Ce quant à soi permet d’éviter la critique que des groupes sociaux pourraient faire de leurs travaux. D’ailleurs, dans sa forme la plus lapidaire, cette critique, on la connaît : c’est un je-m’en-foutisme généralisé. Si jamais j’avais à demander par référendum la continuation de mes subventions de recherche, la population québécoise s’objecterait sans doute à m’accorder beaucoup d’argent alors qu’il faut réparer les routes et financer les soins de santé. Les savants en sciences humaines et en humanités savent en leur âme et conscience que «l’épreuve de la pertinence sociale» est difficile. Nous, on croit tous que ce qu’on fait est admirable, extraordinaire, excellent. Pourtant, juste auprès de notre famille, c’est difficile de convaincre nos frères et sœurs, nos mères et nos pères que ce que l’on fait est intéressant! Alors imaginez auprès de nos voisins! Si un historien ou une historienne s’avisait de partir avec ses articles sous un bras et ses livres sous l’autre, et d’aller à la rencontre des gens qui passent sur le trottoir afin de les interpeller et de leur parler de ses recherches, il ou elle aurait, je le crains, une mauvaise surprise.
Je me résume. Il faut être conscient de deux choses. Premièrement, que l’intérêt pour ce qu’on fait doit toujours tendre à l’universalité. Nos analyses ne doivent pas s’en tenir à une description sèche de notre «objet» de recherche, mais chercher, par un approfondissement de notre «sujet» de recherche, à dégager un horizon général de questions et de réflexions. Deuxièmement, que si les autres devaient s’ouvrir à ce que vous faites, vous devriez aussi vous ouvrir à ce que font les autres. Les professeurs d’université sont en général (il ne faut toutefois pas trop les mettre dans un même panier; je connais maintes exceptions à cette règle) réticents à pratiquer une telle ouverture. Ils sont en faveur d’une plus large diffusion de leurs travaux, mais ils refusent à ce que la société (sous la forme d’individus, de personnes, de personnalités morales, de groupements, d’associations, etc.) vienne dans leur bureau et fasse part de leurs intérêts et de leurs préoccupations.
Stéphane Savard : Concentrons-nous maintenant sur vos champs de recherche précis. Si on se réfère à vos monographies consacrées à 1968 et au mouvement marxiste-léniniste au Québec, recense-t-on l’implication de certains historiens universitaires et d’historiens patentés? À cette époque, comment la mise en récit du passé s’est-elle inscrite dans les causes des mouvements sociaux, comment l’histoire a-t-elle été instrumentalisée si ces historiens patentés et universitaires n’ont pas réussi à orienter le mouvement?
Jean-Philippe Warren : Certaines révolutions sociales, on le sait, ont un impact sur la recherche universitaire. Lorsqu’on se rapporte, mettons aux années 1950 et 1960, on voit bien qu’une façon de faire de l’histoire au Québec était devenue caduque, qu’elle était remplacée par un autre paradigme. La tâche des historiens/sociologues en 1955 était relativement simple : c’était de montrer que la manière que l’on avait alors de faire l’histoire au Québec et de décrire la société québécoise était dépassée. On ne critiquait pas d’abord les sources, ni réellement la méthodologie. On réfutait de manière globale l’histoire dite «traditionnelle». Cette critique s’appuyait sur le fait que l’histoire «traditionnelle» était mythique, fantasmagorique. On comparait le discours (historien) à la réalité (historique) : le discours exprimait une chose et la réalité montrait autre chose. Ce fossé-là (entre le discours et la réalité) constituait la preuve la plus manifeste, aux yeux des intellectuels des années 1950, que les récits historiques qui tenaient lieu de conscience de soi à la société canadienne-française appartenaient aux «poubelles de l’histoire».
Sans doute parce qu’on ne s’est pas retrouvé dans une révolution sociale d’une magnitude semblable à celle qui a bouleversé le Québec dans les années 1950 et 1960, les jeunes historiens d’aujourd’hui n’ont pas été confrontés à la nécessité de réaménager l’histoire de fond en comble. Ceux-ci ne sont pas en position de contradiction totale avec l’histoire qui leur est léguée. Personnellement, je me sens relativement à l’aise avec ce qui a été écrit depuis 30 ans. Bien entendu, de temps à autre, on apporte un éclairage différent, on réhabilite certains personnages, on critique le fait qu’on a peut-être un peu trop insisté sur certaines dimensions et pas assez sur telles autres, qu’on a pas pris assez en compte telle institution, ou telle idéologie, ou tel mouvement social. Mais, en général, ce qui a été écrit depuis 30 ans en histoire est de bonne facture. Je ne sens pas, chez mes collègues plus jeunes, la volonté de renvoyer le plus rapidement possible les professeurs d’histoire actuels et de les remplacer par des gens qui soient des véritables scientifiques.
Cette histoire produite pendant et après la Révolution tranquille a prétendu à la scientificité en adoptant une écriture souvent aride. Autant la sociologie a pu être jargonneuse jusqu’à l’illisibilité, autant la science historienne d’une certaine période a pu être d’une sécheresse, d’une platitude épouvantable! Mais aussi sèche qu’elle a pu être, elle était quand même bien faite, et aussi rébarbative qu’elle a pu être, elle était quand même engagée dans les débats de société. Rares sont les historiens qui ont complètement échappé, d’une manière ou d’une autre, à l’engagement citoyen. Que ce soit parce que, comme individus habitant une société démocratique, ils se sont prononcés à plusieurs reprises sur toutes sortes d’enjeux (ils ont signé des pétitions, ils ont marché dans la rue, ils ont crié des slogans, ils ont brandi des pancartes). Soit encore parce que les sujets qu’ils ont abordés dans leurs travaux savants reflétaient, comme dans un miroir, certains soucis, certains défis, certaines préoccupations, certains questionnements partagés par la société plus large (d’ailleurs, disons-le, dans une société emportée par une forte vague nationaliste, la tâche de «faire de l’histoire» est la plupart du temps immédiatement mobilisée dans un idéal de «faire l’histoire»). Sur ces deux points, je me sens proche de mes devanciers immédiats : du point de vue de la connaissance qu’ils ont produite et du point de vue de la position critique qui était la leur.
Si on se reporte il y a 75 ans, on constate que l’histoire était pratiquée de manière différente. Ce n’était pas nécessairement une manière moins bonne. Mais c’est manifestement une manière dans laquelle on ne se reconnaît plus. Ce qui ne veut pas dire qu’elle soit complètement discréditée. Elle est souvent d’assez bonne tenue : les recherches en archives sont assez bien faites. Moi, je lis encore des travaux de Garneau du 19e siècle, de Lionel Groulx de 1920. Il y a encore des choses là-dedans qui sont parfaitement valables et valides.
La situation est différente dans d’autres disciplines. En sociologie, l’écart avec nos devanciers, ceux des années 1930, est particulièrement frappant. Les sociologues de l’Entre-Deux-Guerres se situaient dans la tradition de la sociologie catholique. Évidemment, aujourd’hui, plus personne ne se réclame de cette tradition doctrinale – dont le principal objectif était d’appliquer au Québec les encycliques pontificales. Le sociologue qui voudrait reprendre un tel programme en 2010 ferait rire de lui!
Stéphane Savard : Reprenez le chapeau du sociologue et parlez-nous un peu de votre ouvrage «L’engagement sociologique : la tradition sociologique du Québec francophone, 1886 à 1955». Pouvez-nous nous décrire un peu le rôle joué par les sociologues dans la modernisation de la société québécoise, non seulement pour les années 1950 mais pourquoi pas jusqu’à aujourd’hui?
Jean-Philippe Warren : Avant de répondre à cette question, je vais répondre, si vous le voulez bien, à une autre question que je vais formuler moi-même : Pourquoi j’ai écrit un livre sur l’histoire de la sociologie québécoise qui s’intitule : «L’engagement sociologique». Pourquoi fallait-il que le mot «engagement» soit présent dans le titre? Pourquoi n’avoir pas choisi d’étudier l’histoire de la sociologie québécoise, tout simplement? C’est que si j’avais voulu m’intéresser aux concepts, aux méthodologies, aux théories, aux approches, aux perspectives de la science sociologique, me tourner vers le cas québécois m’aurait paru malheureux. Un étudiant qui aspire vraiment à prendre à bras le corps cette discipline qu’est la sociologie et à en tirer le maximum possible serait mieux d’aller lire Durkheim, de plonger dans Tocqueville ou de consulter Weber, plutôt que de se pencher sur les travaux des sociologues québécois. La sociologie québécoise, du point de vue de la méthode, du point de vue de la théorie, n’a presque rien à dire, ou si peu, aux sociologues contemporains. Mais du point de vue de l’histoire de l’engagement, histoire qui est toujours incarnée, qui est toujours d’un lieu spécifique (la science conserve une prétention universelle, mais l’engagement est toujours un engagement spécifique, un engagement donné), la sociologie québécoise me semblait avoir énormément à raconter. Ses enseignements me semblaient aussi avoir une portée universelle. Quand je dis «universelle», je ne veux pas dire que ses enseignements étaient bons pour tous et toujours. Je veux simplement dire que quelqu’un pouvait se les approprier, quelque part, à un moment donné, et qu’ils pouvaient aussi bien éveiller quelque chose chez un Chinois ou un Brésilien. L’histoire de la sociologie québécoise est, je le pense, grosse de leçons pour d’autres sociétés et pour d’autres traditions scientifiques.
Maintenant, je vais tâcher de répondre à votre question. Les sociologues d’avant 1960 étaient convaincus que la science devait être au service de la société québécoise. Léon Gérin, le «père» de la sociologie québécoise, a écrit une lettre à son frère lorsqu’il était à Paris, c’est-à-dire au moment où il découvre la science sociale. Il est alors confondu par les possibilités extraordinaires de cette nouvelle discipline dont il n’avait jamais entendu parler auparavant. Il se met à son école, il va suivre des cours, il devient un passionné de la méthode qu’on appelle la méthode de Le Play — c’est une méthode d’analyse des familles. Il écrit donc à son frère, en 1886, pour lui annoncer qu’il a découvert une discipline scientifique fabuleuse. Et il finit sa lettre en disant : «Diffusons la science sociale au Canada et la science sociale nous sauvera».
Cette ambition prométhéenne, cette certitude d’avoir trouvé le feu des dieux et de pouvoir l’apporter sur la terre du Québec, elle a habité les sociologues québécois de 1886 jusqu’à tout récemment. D’abord sous la forme le playsienne. Le Play proposait une vision téléologique de l’histoire. Il était convaincu de la marche univoque des sociétés. En ces temps de colonialisme, l’idéologie du progrès dominait la conscience occidentale : il y avait des sociétés arriérées — c’était le Canada français malheureusement — et il y avait des sociétés qui étaient progressistes et avancées — c’était, pour les disciples de Le Play, le monde britannique. Ça tombait bien, on était dans une colonie britannique! Il fallait par conséquent appliquer le modèle de la famille britannique à la famille canadienne-française et ainsi permettre l’éclosion au Québec de tous les talents et de toutes les possibilités.
L’ambition de joindre la science et l’engagement a ensuite pris la forme de la sociologie catholique, dont je parlais tout à l’heure. Cette sociologie était tout aussi convaincue que la sociologie le playsienne de la vérité d’un sens de l’histoire. Les sociologues de cette École s’appuyaient sur les encycliques pontificales. Le pape étant infaillible, l’engagement ne pouvait pas errer! Autant Léon Gérin s’appuyait sur l’idéologie libérale du progrès afin de convaincre ses lecteurs que ce qu’il disait était la «vérité», autant les catholiques prétendaient la même chose mais, cette fois, en s’appuyant sur le Pape.
Une troisième École sociologique va émerger dans les années cinquante. Jean-Charles Falardeau et d’autres professeurs de «l’École de Laval» vont adhérer à la science positive américaine, en particulier celle pratiquée à l’École de Chicago (où Falardeau avait été formé). Ces professeurs vont s’imaginer que la science est infaillible à cause de sa méthode. Fernand Dumont va confier plus tard avoir étudié à la Faculté des sciences sociales «comme dans un vide idéologique». On croyait alors qu’on pouvait se passer de l’idéologie, que la science par elle-même allait découvrir le fondement de l’histoire, la vérité éternelle des relations humaines, etc.
Enfin, une quatrième École a pris corps dans les années soixante, et surtout soixante-dix : le marxisme. Le marxisme aussi était convaincu qu’il y avait une science du passé et qu’à travers la méthode infaillible non pas de Le Play, non pas du Pape, non pas de l’École de Chicago, mais de Karl Marx, il était possible de déployer le sens de l’histoire et montrer comment l’humanité était en marche, depuis l’aube de l’humanité, vers un but ultime qui s’appelait la société communiste.
Dans les années 1980, ces grands récitatifs, selon l’expression de Lyotard, se sont effondrés. Ces croyances ont été ébranlées. Le monde actuel est davantage fait d’indécisions. C’est à ce moment-là qu’on a eu l’impression que l’engagement était forcément compromis. Dans la tradition de Le Play ou des autres Écoles de pensée, les chercheurs n’avaient pas à se soucier de leur engagement; ils n’avaient pas à se poser la question de leur tâche critique comme scientifiques. Ils n’avaient qu’à embarquer dans le train en marche de l’histoire et, pour ainsi dire, pelleter du charbon dans la fournaise pour que ça avance plus vite! Dans les années 1980, cette confiance en l’avenir s’efface. On commence à se poser beaucoup de questions autour de l’engagement.
Personnellement, je pense que ce flottement est une bonne chose. Je ne regrette aucunement que la question de l’engagement soit désormais divorcée des conceptions non seulement manichéennes mais eschatologiques de l’histoire qui ont eu cours au XXe siècle. Je n’ai aucune envie de revenir à ces époques que certains de mes collègues évoquent avec nostalgie, époques où l’activisme et le militantisme étaient facilités par des convictions de type absolu. Je connais des gens qui se tournent vers les années 1960, vers les années 1970, vers ce qu’ils appellent «l’âge d’or» de la sociologie, et qui regrettent que l’on ne puisse plus, comme alors, combiner de manière automatique la science, d’un côté, et le devoir social, de l’autre. Moi je me dis : «tant mieux!» La science est enfin renvoyée, ce qu’elle aurait toujours dû accepter, à l’incertitude démocratique.
Cependant, cet abandon — que je juge nécessaire — de l’eschatologie historique, c’est-à-dire de la croyance dans la capacité de lire les signes de la fin des temps dans la trame du passé, est lié à un phénomène plus global, phénomène qui menace de manière inquiétante le devenir des sociétés humaines. Pour que l’histoire ait un sens (signification) il faut qu’elle aille un sens (direction). Or, depuis que des fonctions déterminent l’organisation des «systèmes sociaux» contemporains, il est de moins en moins besoin de récit pour réguler leurs flux, relations et opérations. La narration historique est ainsi évacuée peu à peu de l’espace public. On aime encore se conter des histoires, bien sûr, mais l’histoire perd progressivement sa place comme conscience de soi des sociétés humaines. C’est peut-être de là que nous aurions dû commencer notre entretien : du sentiment que la fin de l’histoire (l’humanité ayant supposément atteint le terme de son évolution sociale dans le libéralisme économique et politique) annoncerait aussi la fin de l’histoire (des historiens, cette fois, confrontés à l’inutilité de raconter un passé à une société à jamais installée dans son présent). Mais cela nous aurait sans doute menés trop loin…
Stéphane Savard : J’aurais le goût de poser une dernière question. Selon vous, à titre de sociologue ou d’historien, vous nous le direz, en quoi les historiens devraient-ils s’inspirer de cet engagement sociologique?
Jean-Philippe Warren : J’ai envie de vous répondre en flattant l’égo des historiens plus que celui des sociologues. Je pense que, par le passé, les sociologues ont davantage appris de l’humilité des historiens. Je pense que les historiens, en étant davantage avertis des nuances de chaque époque, en étant sensibles aux transitions, aux passages, aux géographies, aux variétés non seulement de comportements mais d’expériences humaines, en étant aussi avertis de la nécessité de vérifier chacun des faits et d’hésiter avant de généraliser outrancièrement une expérience ou un phénomène, je pense, dis-je, que les historiens ont tiré des leçons bien avant les sociologues du piège de lier trop intimement la science et l’engagement, piège dont je parlais justement dans la question précédente. Les savants doivent se rappeler toujours que leur parole scientifique est une chose, mais qu’une fois que celle-ci est lancée comme une bouteille à la mer dans la société, elle devient une parole parmi d’autres. Elle ne peut prétendre à la préséance sur la parole du plombier, ou la parole du secrétaire, ou la parole d’un infirmier. Dans le vaste débat des sociétés démocratiques, tout le monde a droit à nommer les choses telles que chacun les voit et à se prononcer sur les grandes politiques publiques. C’est sans doute ce qu’il faut regretter en ce moment : il n’y a pas assez de démocratisation de la démocratie, le jeu parlementaire se déroulant à l’écart du plébiscite populaire.
Je ne dirais donc pas que les historiens doivent s’inspirer des sociologues. Pourquoi les historiens ont-ils appris avant les sociologues à se méfier d’une transposition trop rapide de la science en engagement? Je le disais tout à l’heure, à cause justement de leur objet d’étude, à cause aussi de leur pratique professionnelle, parce qu’ils se retrouvent bien souvent en archives, ils se retrouvent confrontés aux documents, tandis que les sociologues, eux, ont un objet de recherche un peu plus flou, un peu moins tangible. Une autre raison ayant rendu les historiens plus humbles dans leurs tentatives d’expliquer l’histoire, c’est que la volonté de caser les siècles dans des formules, volonté qui a eu cours au 19e siècle en histoire (voir par exemple les publications de Guizot, ou Michelet, ou Karl Marx) a été assez vite confrontée au test des faits et a failli à remplir ses promesses. En sociologie, cette ambition s’est étirée plus longtemps. Je dirais que la sociologie a été plus happée par l’utopie moderne — quand je dis moderne, je parle de l’époque dite «moderne» du 18 et 19e siècles — de traiter les faits humains comme on peut traiter des objets inanimés. C’est pour ça que ça s’est poursuivi jusqu’à récemment. Dans certaines disciplines ça se poursuit d’ailleurs encore : je pense ici entre autres à la science économique qui demeure convaincue qu’il est possible de traiter les humains comme des agents purement rationnels, et qui aspire avec arrogance à réguler les conduites humaines.
Stéphane Savard : Merci beaucoup monsieur Warren, ce fut très agréable de faire l’entrevue avec vous, les réponses ont été très enrichissantes. Nous vous sommes reconnaissants pour votre grande disponibilité, l’entretien ayant duré un peu plus d’une heure. Au nom du comité de rédaction de la Revue HistoireEngagée.ca, nous vous remercions chaleureusement.
Jean-Philippe Warren : Merci à vous, ce fut un véritable plaisir.
Pour en savoir plus
DUMONT, Fernand. «L’intellectuel et le citoyen». Possibles, vol. 17, no 3-4 (1993), p. 319-333.
FREITAG, Michel. «La crise des sciences sociales. Entre épistémologie et idéologie, la place de la question de la normativité dans le développement de la connaissance de la société». Société, no 1 (automne 1987), p. 83-151.
FREITAG, Michel. L’oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité. Québec et Rennes, Presses de l’Université Laval et Presses Universitaires de Rennes, 2002, 327 p.
GINGRAS, Yves. « Following Scientists Through Society -Yes, But at Arm’s Length! ». Dans BUCHWALD, Jed Z., dir. Scientific Practice. Theories and Stories of Doing Physics. Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 123-148.
WARREN, Jean-Philippe. L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone. Montréal, Boréal, 2003, 447 p.
WARREN, Jean-Philippe. «?Le non-lieu des intellectuels?». Liberté, vol. 47, no 2 (mai 2005), p. 20-34.
Articles sur les mêmes sujets