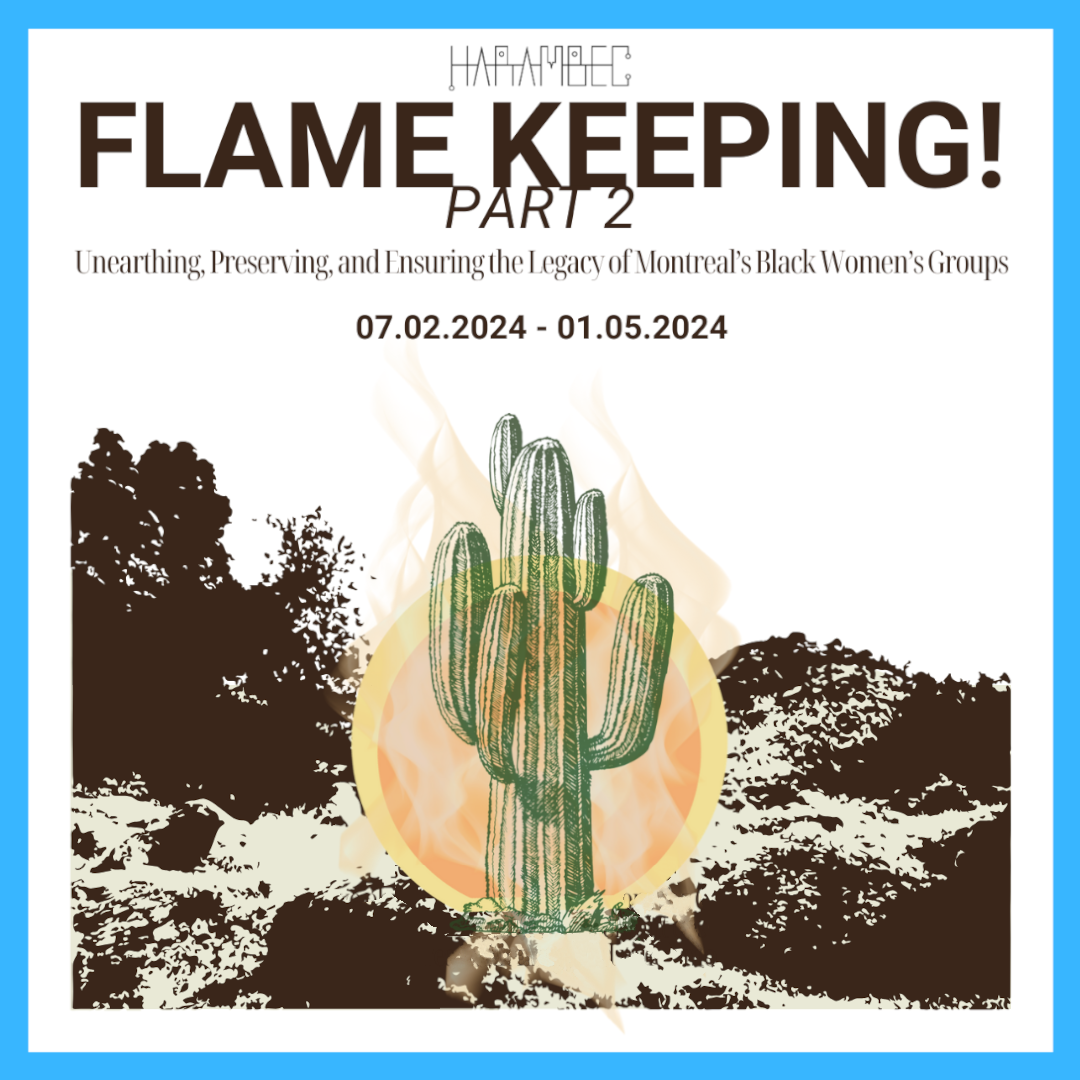L’antisémitisme et le colonialisme ne sont pas des « mystères » historiques
6 min
Collectif de signataires
Mercredi dernier, l’ancien ministre des Affaires culturelles et fondateur des éditions du Septentrion, Denis Vaugeois, était invité à l’émission Plus on est de fous, plus on lit! pour souligner la parution d’entretiens menés avec Stéphane Savard. Formé en histoire et ayant publié plusieurs ouvrages et manuels scolaires, Vaugeois s’est également prononcé sur sa vision de l’histoire québécoise.
À la suite de cette entrevue, plusieurs de ses déclarations ont été invalidées, notamment par des intervenantes et intervenants issus des communautés autochtones ou des milieux de la recherche. En début de semaine, les historiens Jean-François Nadeau et Éric Bédard ont publié des répliques divergentes. Au-delà de la fausseté de certains propos de Denis Vaugeois, notamment concernant les pensionnats autochtones, l’ancien ministre péquiste semble véhiculer une vision édulcorée de l’histoire, dans laquelle le passé est « nettoyé » du colonialisme, de l’antisémitisme et du racisme.
Questionné par Marie-Louise Arsenault au sujet de l’antisémitisme au Québec, Vaugeois affirme que l’intolérance envers la communauté juive ne se serait développée qu’au 20e siècle. En fait, dès 1627 en Nouvelle-France, les Juifs et les Juives se trouvaient interdits de territoire, et ce jusqu’à la Conquête britannique. Pour la période de l’entre-deux-guerres, il soutient ensuite que c’était surtout la communauté canadienne-anglaise, plutôt que canadienne-française, qui faisait preuve d’antisémitisme. Plusieurs recherches et sources confirment le contraire pour les décennies 1930 et 1940 : les déclarations antisémites dans la presse québécoise sont courantes, un parti politique ouvertement nazi est fondé par Adrien Arcand, de nombreux parlementaires francophones s’opposent à l’accueil de réfugiés juifs, une pétition de plus de 127 000 signatures contre l’immigration juive est déposée par la Société Saint-Jean-Baptiste, plusieurs actes antisémites se produisent dans des villages canadiens-français et la synagogue de Québec est la cible d’un incendie criminel. Nous ne croyons pas, comme Vaugeois, que « ce qui arrive aux Juifs, c’est un mystère » et que se risquer à une analyse serait « dangereux » : ces phénomènes doivent être expliqués et pris en compte dans le récit historique.
En laissant entendre que la colonisation française au Canada et au Québec se serait déroulée plutôt facilement, sans « brimer les Indiens », pour reprendre ses termes, Denis Vaugeois tient un discours problématique sur le colonialisme envers les Autochtones. Pour lui, c’est « une histoire dans les deux sens. Les Blancs ont beaucoup appris des Indiens et les Indiens ont beaucoup appris des Blancs ». Il martèle ainsi le même discours qu’on retrouve dans ses manuels d’histoire produits en collaboration avec Jacques Lacoursière au cours des cinquante dernières années (les Boréal Express, l’Histoire 1534-1968, et les Canada-Québec. Synthèse historique). Ce faisant, il perpétue le mythe d’une colonisation « douce », « à la française », qui vient s’opposer à celle « à l’anglaise », plus brutale, « véritable ».
Cette présentation différenciée de la colonisation accorde le beau rôle aux Canadiens français et permet de reproduire le mythe identitaire niant leur figure et leur posture de colonisateurs. De plus, l’argument microbien utilisé par Vaugeois, pour expliquer la diminution draconienne des populations autochtones en raison des épidémies, occulte les conséquences culturelles et sociales du colonialisme, dont des politiques d’assimilation et d’anéantissement promues par les Européens. Finalement, les propos de Vaugeois rendent compte d’une représentation stéréotypée et condescendante des Premières Nations et des Inuit lorsqu’il soutient que ceux-ci étaient « désorganisés » à l’arrivée des colons. Ce discours, profondément occidentalocentriste, catégorise les sociétés autochtones comme « primitives » et sert à légitimer l’appareil colonial qui permet à la nouvelle société nationale de s’établir. Et ce discours, contrairement à ce que Vaugeois semble croire, continue à être largement diffusé.
Comme le remarque l’historien Brian Gettler, l’histoire nationale des pays issus du colonialisme présente généralement les sociétés autochtones comme un point de départ sans importance, tout en dissimulant la dépossession territoriale. Cette vision limite la colonisation au moment de l’arrivée des Européens, occultant la continuité de ce processus durant plusieurs siècles et jusqu’à aujourd’hui. Le peuplement des régions, l’exploitation minière, forestière, hydroélectrique ou pétrolière, les traitements subis de la part des corps policiers ainsi que les actions de plusieurs institutions d’éducation, de santé, de services sociaux ou carcérales à l’égard des Autochtones perpétuent les rapports coloniaux bien au-delà des 17e et 18e siècles.
Nous ne croyons pas, comme Denis Vaugeois, qu’il suffise de « laisser passer la tempête ». Tenir compte du colonialisme, de l’antisémitisme, du racisme, ou même du sexisme, ne relève pas d’un révisionnisme passager ou d’une posture « subjective », mais du développement des recherches en histoire et de notre responsabilité en tant que chercheurs et chercheuses. Nous ne pouvons plus plaider l’ignorance.
Signataires :
Christine Chevalier-Caron, doctorante en histoire, Université du Québec à Montréal
Adèle Clapperton-Richard, candidate à la maîtrise en histoire, Université du Québec à Montréal
Camille Robert, doctorante et chargée de cours en histoire, Université du Québec à Montréal
Marilou Tanguay, doctorante en histoire, Université du Québec à Montréal
Yolande Cohen, professeure en histoire, Université du Québec à Montréal
Daniel Ross, professeur en histoire, Université du Québec à Montréal
Catherine Larochelle, professeure en histoire, Université de Montréal
Andrée Lévesque, professeure émérite en histoire, Université McGill
Isabelle Bouchard, professeure en histoire, Université du Québec à Trois-Rivières
René Lemieux, professeur en traduction et traductologie, Université de Sherbrooke
Marie-Hélène Brunet, professeure à la Faculté d’éducation, Université d’Ottawa
Brian Gettler, professeur en histoire, Université de Toronto
Helga E. Bories-Sawala, professeure émérite d’histoire et de civilisation françaises et francophones, Université de Brême
Articles sur les mêmes sujets